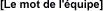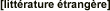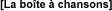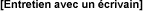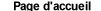|
Quand elle vous souriait, |
|
|
Elle souriait souvent au vent, aux odeurs, aux fleurs, même à ce petit brin d'herbe qui se tordait le cou dans une crevasse du béton. Elle souriait aussi au chauffeur qui presque chaque matin, de pluie ou de soleil, de neige et de tempête, la déposait à l'angle des rues Cooko et Chénier. On raconte même dans le pays que des travailleurs de la C.I.P. allongeaient leur parcours parfois, juste pour le plaisir de cueillir son sourire. Vêtue de son sarreau blanc, non elle n'était pas vampire et jamais ne touchait une aiguille. Elle vous promenait dans les corridors, d'une étage à l'autre et devant la porte de l'ascenseur, vous injectait son sourire qui faisait l'effet d'un calmant et coulait si doucement en vous que vous étiez presque heureux de ce petit malaise, cette nausée, ce pied enflé qui vous avait traîné dans ces lieux. Toujours sous son magnétisme, vous entriez confiant, vêtu d'une jaquette bleue avec cette fente dans le dos, dans la salle sombre, histoire d'immortaliser un peu de votre anatomie dans les archives de cet hôpital. Puis elle vous conduisait dans l'attente de cette autre salle où trois fois par semaine, sans même vous interpeller , elle vous offrait son sourire que chacun suivait allégrement. Ce sourire , d'une douceur presque mystérieuse vous énergisait . Ainsi , assis en face de cette dame en blanc, je m'abandonnais à
ce traitement un peu étrange, qui pour me guérir, perturbait l'ordre
de mes réactions cellulaires et me dépouillait l'os cérébral. Puis un beau matin d'été, elle n'était pas au rendez-vous. Un écriteau
me dévisageait, l'air de me dire: mais que fais-tu là pauvre imbécile,
ne me dévore pas comme ça. Sors tes lorgnons et suis les instructions.
J'étais si désemparé, presqu'au bord des larmes, vers la sortie mes pas ont courus . J'ai marché tout l'après-midi sur la plage et la mer m'a raconté l'étrange raz de marée qui avait balayé le système de santé. J'étais si triste et si seule que je me suis endormi. Une lueur montait des bas fonds marins et colorait doucement la grève. Je vis le dôme d'un sous-marin immergé de l'eau, une coupole rosée se dessiner , puis un ballon rouge flotta sur la ligne d'horizon . Je pensais rêver, j'écarquillai les yeux . Elle se tenait assise, les genoux repliés, les pieds enfoncés dans le sable. Immobile, un peu triste, elle se laissait imprégner de cette harmonie d'un nouveau jour naissant. Un sourire pâle illuminait la plage déserte. Puis le jour reprit son train-train quotidien. Le souffle du vent gonflait la mer qui dans son mouvement d'une patience insaississable , tentait de rejoindre la plage pour effacer les vomissures d'une nuit trop agitée. Lavé de toutes souillures, le sable blanc donnait une lumière trop cru qui blessait l'oeil. Elle tourna le dos au soleil et remonta vers le village . Elle s'installa à une table sur la terrasse comme elle faisait tous les matins depuis que les bureaucrates assoiffés d'argent lui avaient enlevé son sarreau blanc. Non, elle ne s'ennuyait pas mais la lueur du jour n'enflammait plus son regard. Elle commanda un café et alluma une cigarette au menthol. Elle suivait les spirales de fumée qui l'emmenait loin dans des réflexions parfois bien étranges. Elle n'avait jamais connu la guerre bien qu'elle en connaissait tous les ravages que les média nous crachaient au visage. Et pourtant , seule sur cette terrasse, elle se sentait un peu comme un prisonnier de guerre ou un déserteur, un combattant exilé dans son propre univers . Un pays en devenir qui ne comptait pas les morts mais des milliers de cadavres déambulaient dans les rues et laissaient une odeur bizarre comme la putréfaction d'un devenir. Une guerre bureaucratique attaquait sans droit de riposte les travailleurs
de cette époque. Comme une nuée de sauterelles dans un champs de blé,
cette armée faisait bien du ravage. Elle, toujours assise à cette terrasse, le regard au loin, scrute le mur de cet édifice que le soleil a adopté pour ses ébats colorés de fin de journée. Un mur comme un regard sur la ville, une présence invisible sur la peau d'un absurde branle-bas. Tout s'est écroulé, seul le mur est resté comme un monument froid , témoin d'une société déshumanisée. Elle allume une dernière cigarette et suit encore plus attentivement les spirales de fumée comme une bouée de sauvetage qui la sauverait de son naufrage. Et si vous vous promenez dans les rues de ce pays, vous découvrirez
, à votre grande surprise, qu'ils sont des milliers supendus dans
le temps, presqu'immobiles : trop vieux pour le boulot, trop jeune
pour bercer les souvenirs. Elle éteint sa cigarette, se lève lentement, oublie son sourire sur le dossier de la chaise et embarque dans le premier train vers une destination certaine. |
|
|
Gertrude MILLAIRE
|
|
|