DISCOURS PRONONCÉ
par
WILFRIL LAURIER
le 7 mars 1911
devant la
CHAMBRE DES COMMUNES
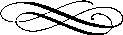
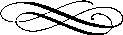
Le très hon. sir WILFRID LAURIER (premier ministre) :
Monsieur le président, voilà un mois et davantage
que mon honorable ami le ministre des Finances (M. Fielding)
a déposé sur le bureau de la Chambre le texte de
la convention que lui et mon honorable ami et collègue
le ministre des Douanes (M. Paterson) avaient conclue avec le
président des États-Unis, en vue de la modification
du régime des échanges en vigueur depuis de longues
années entre nous et nos voisins. Depuis lors, cette convention
a été examinée, discutée et annoncée
dans la presse canadienne, dans des réunions de corps publics
et au Parlement ; et si je ne me méprend du tout au
tout sur le sens de l'opinion publique, si je sais interpréter
les augures, le programme impliqué dans cette entente a
reçu l'approbation, je dirai même l'approbation enthousiaste
d'une majorité du peuple canadien. (Exclamations diverses).
Si je ne me trompe, ce que je viens de dire soulève certaines
protestations. Je ne m'arrêterai pas, monsieur le président,
à discuter la valeur intrinsèque de nos opinions
en comparaison de celle des honorables députés de
la gauche sur ce point. Rien de ce que je pourrais dire ne changerait
leurs vues, j'en suis persuadé, et je me rends parfaitement
compte qu'ils vont persister dans cette voie jusqu'au soir de
la prochaine élection générale. Je sais bien
que ce programme n'a pas été universellement accepté,
qu'il a été dans certains quartiers, et je dirai
même où l'on s'y serait le moins attendu, l'objet
d'une opposition persistante. Il est bien connu qu'il s'est formé
dans les villes de Montréal et de Toronto une association
dont le but est de faire rejeter cette entente. Je ne saurais
m'en plaindre ; ceux qui agissent de la sorte sont parfaitement
dans leur droit. Je ne chercherai pas davantage à dissimuler
la portée d'un tel mouvement ni l'importance de ceux qui
l'ont lancé. Mais même en faisant très large
la part de ce double facteur, je persiste à croire qu'il
n'y a pas lieu de s'alarmer. Le général Grant raconta
dans ses mémoires que, durant la guerre du Mexique, alors
qu'il était jeune lieutenant dans l'armée des États-Unis,
il se dirigeait un jour à cheval, en compagnie d'un ami,
vers la scène des hostilités, quand soudain ils
entendirent le plus effroyable hurlement de loups. Son ami lui
demanda combien il pensait qu'il s'en trouvait dans la bande,
et Grant pour ne pas exagérer fixa approximativement le
nombre à vingt. Son ami sourit sans rien dire. Quelques
instants après, ils arrivèrent en vue des loups ;
ils n'étaient que deux pour faire tout ce bruit. Le général
Grant observe qu'il s'est rappelé cet incident plus tard
lorsque dans le cours de sa vie il a été témoin
du tapage fait par des gens désappointés :
jusqu'à ce qu'on eut pris la peine de les compter, ils
faisaient toujours l'effet d'être plus nombreux qu'ils n'étaient
en réalité. Je crois que ce qui est vrai des États-Unis
l'est aussi de notre pays. Des objections que nous avons entendu
formuler contre cette convention, les unes me paraissent manquer
singulièrement de force ou d'à-propos ; d'autres,
au contraire, seraient dignes d'attention, si elles ne se fondaient
sur une étrange autant que fausse conception de ce que
seront les conséquences de l'établissement d'un
tel régime.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pu se produire une opposition
quelconque. Qui niera que, dans nos relations avec nos voisins,
nous ayons atteint ce que tous les partis dans cette Chambre ont
cherché depuis quarante ans ? Qui niera que si il
y a quarante ans, aux premiers jours de cette Confédération,
il y a trente ans, vingt ans ou même quatorze ans, lorsque
nous avons pris les rênes de l'administration, il eût
été possible d'obtenir un abaissement du tarif américain
comme le comporte cette convention, il y aurait eu dans tout le
pays beaucoup de joie ? Cela ne se peut nier, monsieur le
président ; et la preuve en est que divisés
sur toutes les autres questions, les deux partis qui représentent
la population de ce pays se sont toujours accordés à
penser que les relations qui existaient entre nous et nos voisins
faisaient tache sur notre commune civilisation. Il y a cette autre
preuve que l'un et l'autre partis ont successivement voyagé
dans la poussière des routes qui mènent d'Ottawa
à Washington, en vue d'obtenir, s'il était possible,
une amélioration de ces rapports. Une meilleure preuve
encore, c'est que, en 1878, sir John Macdonald proposant à
cette Chambre sa politique nationale, la proposait comme un moyen
d'atteindre un but, et ce but c'était d'obtenir tôt
ou tard la réciprocité commerciale avec nos voisins.
J'ai entendu l'autre jour avec plaisir mon honorable ami le député
de Peel (M. Blain) nous dire comment la Politique nationale avait
pris naissance. Il a abondamment parlé de tout ; il
a tout dit, excepté cette chose, la dernière de
toutes, que, dans la pensé de sir John Macdonald, c'était
là un moyen tendant à obtenir cette réciprocité
de commerce qui jusque-là nous avait été
refusée. La mémoire fait défaut à
mon honorable ami ; elle fait défaut à ses
amis également, et peut-être ne serait-il pas mauvais
que je leur rappelle, à eux et à lui la motion de
sir John Macdonald, ne serait-ce que pour leur faire voir l'énorme
distance qui les sépare aujourd'hui, lui, son parti et
se chefs, de ce même parti et des chefs qui le dirigeait
alors. Voici quelle a été la motion de sir John
Macdonald :
Cette chambre est d'opinion que la prospérité du
Canada requiert l'adoption d'une politique nationale qui, par
un remaniement judicieux du tarif, favorisera et encouragera les
intérêts agricoles, miniers, manufacturiers et autres
du Canada ; que cette politique gardera au Canada des milliers
de nos compatriotes qui sont maintenant obligés de s'expatrier
pour trouver le travail qui leur manque dans leur patrie, rendra
la prospérité à nos industries qui luttent
et souffrent si péniblement, empêchera la Canada
d'être un marché à sacrifice, encouragera,
développera et activera notre commerce interprovincial
et, tendant à la réciprocité de tarif avec
nos voisins dans la mesure requise par le intérêts
variés du Canada, aura grandement pour effet de procurer
éventuellement à ce pays une réciprocité
commerciale.
Telle a été la politique proposée par le
parti en 1878 et mise à exécution l'année
suivante, en 1879, lorsque le parti conservateur est arrivé
au pouvoir à l'aide de cette même politique approuvée
par les électeurs. Dans la loi qui donne effet à
cette politique, et qui est la loi des douanes de 1879, on trouve,
à l'article 6, une offre permanente de réciprocité,
ainsi exprimée :
Tous les articles suivants, savoir : les animaux de toute
espèce, les fruits verts, le foin, la paille, le son,
les graines de toutes sortes, les légumes (y compris les
pommes de terre et autres racines), les plantes, arbres et arbrisseau,
la houille et le coke, le sel, le houblon, le blé, les
pois et fèves, l'orge, le seigle, l'avoine, le maïs,
le sarrasin, et tous autres grains, et les farines de blé,
de seigle, de maïs et d'avoine, et la farine de tous autres
grains, le beurre, le fromage, le poisson (salé ou fumé),
le saindoux, le suif, les viandes (fraîches, salées
ou fumées), et le bois de service, pourront être
importés en Canada francs de droit, ou à un taux
de droit moindre que celui prescrit par le présent acte,
sur proclamation du gouverneur en conseil, qui pourra être
promulguée lorsqu'il apparaîtra à sa satisfaction
que les articles identiques du Canada peuvent être importés
en franchise aux États-Unis.
Cela se passait en 1879, et nous sommes aujourd'hui en 1911.
Ce que l'on recherchait en 1879, voici que nous pouvons l'avoir,
et, cependant, il en est qui doutent, qui hésitent, qui
vacillent et voudraient biffer de notre histoire trente années
d'expectative. On pourrait citer des pages et des pages de discours
prononcés par des membres du parti conservateur, dans lesquels
le tarif américain a été dénoncé
comme injuste, comme déloyal, comme hostile, et aujourd'hui
qu'il est en notre pouvoir de mettre fin à cette injustice,
à cette déloyauté, à cette hostilité,
il se trouve des hommes qui se lèvent contre nous et nous
disent : S'il vous plaît, arrêtez-vous et n'allez
pas plus loin ; laissez l'injustice se perpétuer,
laissez se perpétuer l'hostilité, car c'est de cette
injustice et de cette hostilité que dépend l'existence
même de la Confédération canadienne....
... Mais je pose de nouveau la question : quelle est la cause
du changement d'attitude constaté chez les députés
de la gauche ? Cette cause ne saurait être que flatteuse
pour le Gouvernement. La raison alléguée, c'est
qu'aujourd'hui le Canada est plus prospère que jamais.
Si le Canada était encore dans la situation où nous
le trouvâmes à notre avènement au pouvoir
en 1896, alors que ses vastes territoires de terres domaniales
étaient encore inoccupés et incultes, ses moyens
de transport dans l'état le plus rudimentaire, l'industrie
dans le marasme, l'agriculture peu lucrative ; si le Canada,
dis-je, était encore en pareille situation, on ferait sans
doute un cordial accueil à la mesure que nous proposons
et l'air retentirait de chants d'allégresse. Mais au lieu
de se trouver en pareille posture, le pays est prospère ;
de fait, il y règne une merveilleuse prospérité
et les députés de la gauche de s'écrier :
``N'allez pas plus loin, croisez-vous les bras et rappelez-vous
que le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien ! dans quel pays
vivons-nous donc ? Que sommes-nous ?...
... Mais nous irons de l'avant avec notre politique. ``Avançons``.
Voilà notre politique ; et si elle est mauvaise nous
la soumettrons volontiers au jugement du peuple canadien et nous
l'exposerons au châtiment qui devrait être réservé
à tout homme qui en propose une mauvaise. Notre politique
a été, est et sera, aussi longtemps que les électeurs
du Canada continueront de nous accorder la confiance qu'ils nous
ont témoignée durant quinze ans, de chercher des
marchés partout où il est possible d'en trouver.
Avant tout nous sommes un peuple agricole, notre richesse principale
est la culture des produits de la zone tempérée,
les fruits, les céréales et les légumes,
et notre gloire - non pas une vaine gloire, mais une gloire qui
s'appuie sur une véritable expérience - est, qu'en
fait de céréales, de légumes et de fruits
nous pouvons, sans exagération, l'emporter sur tout le
monde.
A l'extrémité septentrionale de la zone tempérée,
nos céréales ont plus de vigueur, nos fruits ont
un meilleur parfum, nos légumes sont plus délicats
que les produits analogues des autres parties du monde, et quand
la concurrence sera libre, quand elle ne sera pas entravée
par le tarif, ils remplaceront tous les autres produits sur les
tables des gens riches.
Notre but aujourd'hui est d'ouvrir la porte du marché américain,
d'ouvrir la porte d'une nation de 90,000,000 d'habitants, qui
nous a été fermée pendant cinquante ans,
et quand nous sommes submergés par une abondance de sophismes ;
on nous dit que si cette convention est appliquée, et
si les légumes, les céréales et les fruits
du Canada peuvent traverser la frontière et être
consommés en franchise par les Américains, ce sera
la fin de la Confédération canadienne et que même
l'empire britannique chancellera et s'écroulera sur ses
bases. ...
... J'ai dit il y a un instant que la convention que nous avons
faite a simplement pour but d'obtenir de meilleurs prix pour les
produits des agriculteurs du Canada. C'est une proposition si
facile à comprendre que je suis surpris de ne pas l'avoir
vue mieux accueillie par nos honorables amis de l'opposition.
Mais les objections qui sont faites à cette convention
ne découlent pas de ce qu'elle renferme ; elles reposent
toutes sur des motifs qui y sont étrangers. Le partie conservateur
est opposé à cette convention, parce que, nous dit-il,
elle produira des conséquences désastreuses pour
le pays. J'ai écouté avec soin presque tous les
discours qui ont été prononcés dans la Chambre
sur cette question et j'ai lu avec une égale attention
ceux que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ; aussi je
crois pouvoir dire avec raison que les objections qui ont été
faites à cette convention peuvent se résumer à
quatre. La première est que le commerce abandonnera les
voies canadiennes pour suivre les voies américaines. La
seconde est que nos ressources naturelles seront détruites.
La troisième est que nos industries seront mises en péril,
et la quatrième - certainement pas la moindre - c'est que
notre autonomie sera perdue et que finalement nous serons absorbés
par la république américaine. Je crois avoir assez
bien exposé les objections des honorables députés
de l'opposition, et la Chambre me permettra sans doute de les
discuter.
Prenons la première : l'objection que cette convention
va détourner le commerce de voies canadiennes pour le diriger
vers les voies américaines. Cette question il faut la discuter
en se plaçant à deux points de vue : d'abord
à celui des marchandises qui sont expédiées
du Canada aux États-Unis pour être transportées
en Angleterre, et en second lieu au point de vue des marchandises
envoyées du Canada aux États-Unis pour être
consommées aux États-Unis. En examinant le premier
point qui a trait aux marchandises expédiées du
Canada aux États-Unis pour être transportées
en Angleterre, en quoi voit-on que la convention puisse nuire
au système actuellement en vigueur ? Elle ne le modifie
pas d'un iota. Actuellement les marchandises partent du Canada
pour être expédiées à Boston, New-York
ou un port quelconque d'Amérique sans payer de droits.
Les marchandises américaines viennent de la même
façon au Canada pour être expédiées
à Montréal, Halifax ou Saint-Jean, sans payer de
droit. Un chargement de blé peut quitter Winnipeg pour
New-York, y être déchargé et transbordé
sans qu'il soit exigé de droit. Un chargement de grain
peut quitter Minneapolis pour Montréal et être expédié
de notre port sans payer de droit. Ceci se passe en vertu des
traités de transit qui ont été accordées
par un gouvernement à l'autre, et réciproquement,
afin de faciliter le transport. Cet état de choses existe
depuis environ soixante ans et je n'ai jamais entendu de plaintes
alléguant que c'était injuste pour l'un ou l'autre
pays. Il fut un temps ou j'étais agacé quand je
réfléchissais que cette faculté de transit
n'était qu'on acte de bonne volonté de la part des
Américains à notre égard. C'est au moment
où nous n'avions pas de voies de communication pour atteindre
l'océan. Mais maintenant que nous avons une communication
non interrompue d'un océan à l'autre, sur le territoire
canadien, nous pensons que les États-Unis peuvent supprimer
quand ils le voudront la faculté de transit, et que s'ils
le faisaient ils en souffriraient plus que nous. Mais, notre situation
sous ce rapport est bien garantie, que ce traité soit ou
non adopté. ...
... On a aussi soulevé l'objection que cet arrangement
était de nature à détruire nos ressources
naturelles. Mon honorable ami de Toronto-nord s'est tout particulièrement
indigné à ce sujet. Il a fait des frais d'éloquence
et a demandé ce que nous avions voulu faire en établissant
une commission de conservation de nos ressources naturelles, puis
en portant ainsi une main sacrilège sur notre œuvre.
Je dois faire observer à mon honorable ami que la commission
de conservation des ressources naturelles n'était pas du
tout destinée à s'occuper de questions d'économie
politique, mais de questions de science physique. L'honorable
député nous a dit que notre devoir était
de préserver nos ressources naturelles pour nos enfants
et les enfants de nos enfants. Mais je lui demanderai de nous
dire quel est l'objet de ces ressources naturelles. Le sol, les
eaux, les forêts, les minéraux ont été
donnés à l'homme par le Créateur pour l'usage
de l'homme, et toute les nations civilisées s'en sont servies
en conséquence. Pourquoi nos ancêtres ont-ils quitté
leurs patries respectives et sont-ils venus en ce pays enlever
le patrimoine des Indiens, si ce n'était dans le but de
s'emparer des ressources naturelles du pays et de les faire servir
à leur avantage.
Les Indiens étaient des gens selon le cœur de mon
honorable ami de Toronto-nord : c'étaient de grands
conservateurs des richesses naturelles. Ils les conservaient non
pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants et pour les
enfants de leurs enfants. Ils n'en faisaient jamais grand usage.
Ils habitaient un territoire où le minerai se trouvait
en abondance ; cependant, quand nos ancêtres arrivèrent
en ce pays, ils constatèrent que les Indiens se servaient
d'outils d'os et de pierre. Ils n'avaient jamais cultivé
le sol, ils vivaient de chasse et de pêche. Ils passaient
leur vie au milieu de forêts immense sans jamais abattre
un arbre pour se construire une maison ; le pays qu'ils habitaient
était sillonné des plus majestueux cours d'eau de
l'univers, mais l'idée ne leur venait jamais de les utiliser
pour faire tourner une roue ; jamais même ils ne se
servaient de l'eau pour laver. C'étaient donc des gens
selon le cœur de l'honorable député de Toronto-nord.
Nos ancêtres, eux, émigrèrent au Canada dans
le but de jouir des richesses naturelles du sol ; par malheur,
s'ils en ont usé, ils en ont aussi abusé. Le reproche
que l'on a à faire au colon blanc, c'est d'avoir usé
de ces richesses avec imprévoyance, d'en avoir gaspillé
beaucoup plus qu'il n'en a fait servir à son propre avantage.
On dit aujourd'hui du cultivateur canadien qu'il ne cultive pas
le sol, mais qu'il l'épuise plutôt ; de même
on reproche à l'exploitant de nos forêts non pas
de couper le bois comme il devrait le faire, mais d'en détruire
beaucoup plus qu'il n'en utilise. C'est chose admise, je crois,
que dans cette vallée de l'Ottawa, où l'exploitation
forestière se pratique depuis un siècle, les exploitants
ont gaspillé beaucoup plus de bois qu'il n'en ont sortie
des forêts. La commission de conservation n'a pas d'autre
but que d'apprendre aux exploitants des forêts, aux cultivateurs
et aux autres citoyens à utiliser les richesses naturelles
de notre pays. Cette commission, que préside avec tant
de talent mon honorable ami de Brandon, rendra donc un service
signalé en apprenant à notre population à
tirer partie de ces richesses avec assez de prévoyance
pour que nous puissions les transmettre à nos fils et à
nos petits-fils.
Mais quel rapport cela a-t-il avec la présente convention
douanière ? Au dire de mon honorable ami, les Américains
vont s'emparer de nos richesses naturelles ; eh bien !
s'ils le font, ce sera en payant. Mais qu'ils le fassent ou ne
le fassent pas, que la convention soit ratifiée ou rejetée,
on n'en utilisera pas moins les richesses naturelles du pays,
et je me plais à espérer qu'on le fera avec plus
de prévoyance qu'à l'heure actuelle. Que mon honorable
ami de Toronto-nord dissipe ses craintes à ce sujet.
Je passe à une objection plus importante, à la seule
qui me paraisse avoir quelque force : c'est que la convention
va mettre nos industries en danger. Comment cela ? Cette
convention porte surtout sur les produits naturels ; elle
ne vise aucun produit manufacturé, sauf les instruments
aratoires. En négociant cette convention, nous nous en
sommes rigoureusement tenus à la lettre de la résolution
adoptée par le parti libéral à sa convention
de 1893, alors qu'il se prononçait en faveur de l'établissement
d'un régime de réciprocité à l'égard
des produits naturels et de certains articles fabriqués,
dont la liste avait été dressée après
mûre délibération. Pourquoi cette résolution
comportait-elle une telle réserve ? Pourquoi avions-nous
déclaré en toutes lettres que si nous étions
jamais appelés à négocier un régime
de réciprocité, celui-ci embrasserait tous les produits
naturels, mais ne viserait qu'un certain nombre d'articles manufacturés
dont la liste serait dressé avec le plus grand soin ?
C'est parce que la réciprocité commerciale à
l'égard des produits naturels est bien différente
de celle qui se rapporte aux produits manufacturés. C'est
pour cela que nous avons agi avec tant de circonspection. Je n'assistais
pas à la conférence qui a eu lieu entre les honorables
collègues qui siègent à mes côtés
et M. Knox, mais pas n'est besoin d'un bien grand effort d'imagination
pour supposer qu'ils avaient beaucoup plus d'intérêt
à obtenir la réciprocité de commerce à
l'égard des produits industriels qu'en matière de
produits naturels ; nos négociateurs, toutefois, ne
voulurent pas acquiescer à un régime de réciprocité
embrassant tous les produits industriels, et exigèrent
que la convention douanière ne visât que les seules
machines agricoles. Et il en fut ainsi.
En agissant de la sorte, nous ne sommes pas allés aussi
loin, je le sais, qu'on aurait voulu en certains quartiers où
l'on réclamait l'entrée en franchise des instruments
aratoires ; mais nous avons pensé qu'il n'était
ni sage ni utile d'aller aussi loin que cela. Et pourquoi ?
C'est que les membres du cabinet, qui sont responsables devant
le peuple, se rendent compte qu'en matière tarifaire il
existe une différence énorme entre les produits
manufacturés et les produits naturels. Prescrire un droit
ou établir un tarif protecteur est toujours chose facile,
mais diminuer ou abolir un droit constitue toujours une tâche
épineuse, et cela pour une raison que l'on connaît
bien. Il est évident qu'en relevant les droits de douane
ou en établissant un tarif protecteur, on crée immédiatement
une atmosphère, économique factice, et qu'en obligeant
tout à coup les industries nées au sein de cette
atmosphère et à la faveur d'un tel tarif, à
faire face à l'abolition des droits de douane, on pourrait,
en une seule nuit, faire perdre des millions et jeter sur le pavé
des milliers d'ouvriers. Voilà pourquoi nous avons agi
comme nous avons fait.
Nous avons abordé la négociation de cette convention
qu'avec un soin et une circonspection extrêmes. A notre
avènement au pouvoir, en 1896, nous avions le même
problème à résoudre, il nous fallait tenir
compte des mêmes exigences ; aussi avons-nous pris
toutes les précautions possibles, tout en faisant bénéficier
le public - comme c'était notre devoir - d'une réduction
des droits de douane, pour ne pas porter préjudice aux
industries déjà établies, et je crois que
nous y avons pleinement réussi.
Des VOIX : Très bien ! très bien !
Sir WILFRID LAURIER : Bien que la réciprocité
commerciale avec les États-Unis fût inscrite à
notre programme politique, nous avons eu soin de faire en sorte
qu'elle ne fît tort à aucune industrie. La seule
qui soit atteinte par la convention douanière est celle
des machines agricoles ; à l'égard de certaines
de ces dernières, les droits sont réduits de 17½
à 15 p. 100, tandis qu'en d'autres cas le droit est réduit
de 20 à 15 p. 100. Pour ma part, j'aurais aimé à
faire une réduction plus sensible, mais nous avons pensé
qu'en agissant de la sorte nous nous montrerions peut-être
injustes envers le grand nombre de ceux qui ont placé des
capitaux dans cette industrie.
Le Gouvernement n'existe pas uniquement pour les cultivateurs,
les industriels ou un groupe quelconque de la population ;
sa sollicitude doit s'étendre également aux manufacturiers,
aux cultivateurs et à tous les éléments qui
composent notre nation.
Des VOIX : Très bien ! très bien !
Sir WILFRID LAURIER : Il ne devrait pas y avoir d'antagonisme
entre les diverses classes de la société ;
il ne devrait pas exister de rivalité entre les manufacturiers
et les cultivateurs. Le manufacturier est le meilleur ami du cultivateur,
et le cultivateur est le meilleur ami du manufacturier. Qu'ils
se donnent donc la main pour tirer parti de leur occupation respective.
Quant à nous, voici quatorze ans que nous gérons
les affaires du pays en nous efforçant de faire disparaître
les rivalités entre les différentes classes de la
société et de faire régner partout l'union
et la concorde, nous inspirant sans cesse de cette devise :``Liberté
pour chacun, privilèges pour personne.`` Telle a été
notre ligne de conduite : nous n'en voulons pas d'autre.
Certains pensent que nous allons inconsidérément
ruiner l'industrie et les capitaliste. Les capitalistes sont toujours
hésitants : or le chef du Gouvernement et les ministres
qui lui prêtent leur concours seraient indignes de la confiance
de leurs concitoyens s'ils n'avaient pas toujours soin de veiller
à ce que les capitaux placés dans une industrie
de ce pays soient à l'abri de tout danger. ...
... Les conservateurs d'il y a un demi-siècle étaient
d'une plus rude étoffe. En 1854, le traité négocié
par lord Elgin, sous le ministère de Francis Hincks, entraîna
aussitôt la prospérité. Dix ans après,
ce traité fut dénoncé et remplacé
par un tarif protecteur élevé. A ce moment-là,
les Canadiens ont-ils faibli ? Ont-ils hésité ?
Ont-ils été obligés de nouer des relations
plus intimes avec les États-Unis ? Non, en présence
de cette conduite, ils ont conçu et établi la Confédération
canadienne. ...
... Nous fermons l'oreille à cet avis des âmes timorées,
nous préférons suivre l'exemple que nous ont donné
les âmes fières d'il y a un demi-siècle. En
jetant un coup d'œil sur la situation, loin de partager les
lugubres pressentiments relatifs aux conséquences de l'application
non pas d'une doctrine nouvelle mais d'une politique ancienne,
il me semble découvrir de nombreuses preuves que nos relations
avec nos voisins entrent dans une nouvelle phase, et voir luire
à l'horizon des jours plus brillants. Une chose est certaine
et indéniable, c'est que les relations qui ont existé
entre les deux pays depuis un demi-siècle, principalement
depuis vingt ans et encore plus pendant les douze dernières
années et qui ont presque atteint l'état aigu il
y a un an, c'est que ces relations, dis-je, ont été
une flétrissure pour la civilisation des deux pays. Elles
équivalent presque à une déclaration de rupture
des relations commerciales, en tant que les lois peuvent produire
cette rupture.
Il est une autre chose incontestable, c'est que celui qui a porté
le parti conservateur à l'apogée de sa puissance
et de son prestige, celui dont le nom est encore vénéré,
bien que son exemple ne soit pas encore imité, sir John
A. Macdonald, a regretté et redouté cette situation.
Il a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire
pour la métamorphoser et l'améliorer. A cette fin,
il a fait maints sacrifices et c'est dans ce but qu'il a lancé
son dernier appel au peuple canadien.
Il y a une autre chose qu'on ne saurait nier, c'est qu'en ce moment
les penseurs de la république américaine sont de
plus en plus d'avis que la ligne de conduite qu'ils ont suivie
depuis un demi-siècle a été mauvaise, qu'elle
est égoïste et mesquine, et ils sont prêt à
revenir sur leurs pas et à lier avec nous des relations
commerciales mutuellement avantageuses. Lorsque nous sommes parvenus
à cette étape, il est inconcevable qu'on nous dise que
cette politique rétrograde, longtemps mise en pratique
par les États-Unis et qu'ils sont à la veille d'abandonner,
devrait être la politique du Canada et que nous devrions
poser en principe que nous n'aurons pas de rapport commerciaux
avec eux. Cela est incroyable et cependant nous avons à
plusieurs reprises entendu exprimer cette idée devant la
Chambre. On nous dit qu'à moins que cette politique ne
soit mise en vigueur, le Canada est exposé à des
dangers et on nous prédit l'annexion si nous ne maintenons
pas la doctrine de la cessation de nos rapports avec les États-Unis.
L'annexion ! Il fut un jour où une violente agitation
en faveur de l'annexion régnait en ce pays, et cette agitation
a été enrayé pour la première fois
lorsque lord Elgin rapporta de Washington le traité de
réciprocité de 1854. Dès lors le désir
de l'annexion s'est constamment affaibli, au point qu'on n'en
voit plus aucune trace nulle part au Canada.
Autrefois - et c'est un autre point de l'histoire - tous les citoyens
américains étaient persuadés que la Confédération
canadienne devait un jour former partie de la république.
Les récents événements ont prouvé
qu'il y a encore aux États-Unis des gens qui nourrissent
cet espoir. Mais il y en a aussi qui commencent à comprendre
que la république, bien que sa carrière ait été
glorieuse, a encore plusieurs problèmes à résoudre,
maints périls à affronter ; et plusieurs d'entre
eux commencent à se rendre compte que la solution de leurs
épineux problèmes serait gravement compliquée,
peut-être irrémédiablement compromise si le
territoire de la république embrassait une autre étendue
de ce pays aussi vaste, habitée par une population moins
nombreuse que la leur, ayant aussi des problèmes à
résoudre et dont l'union aux États-Unis ne ferait
qu'accroître les embarras auxquels la nation américaine
doit faire face. Si mon humble voix pouvait se faire entendre
d'une extrémité à l'autre du pays et si,
sans forfanterie, elle pouvait se faire entendre au-delà
de la frontière, je dirais à nos voisins les Américains :
Quoique l'idée que le territoire de la république
puisse couvrir tout le continent depuis le golfe du Mexique jusqu'à
l'océan Arctique soit de nature à flatter votre
vanité, souvenez-vous que nous, Canadiens, nous sommes
nés sous le drapeau de nos ancêtres, drapeau sous
lequel vous avez peut-être été opprimés,
mais qui a été et est plus que jamais, pour nous,
le symbole de la liberté.
Rappelez-vous que si vous avez fondé une nation en vous
séparant de la mère patrie, nous, Canadiens, avons
entrepris d'en fonder une sans nous séparer d'elle :
rappelez-vous que dans cette tâche nous sommes déjà
très avancés ; que nous avons nos institutions,
une entité comme peuple, et tout ce qui constitue une
patrie, et qu'à cette patrie nous sommes tout autant dévoués
que vous l'êtes à la vôtre. Rappelez-vous que
le sang qui coule dans nos veines vaut autant que le vôtre ;
que si vous êtes un peuple fier, nous le sommes autant que
vous, bien que nous ne soyons pas aussi nombreux, et que nous
préférerions la mort à la perte de notre
existence nationale. Si mes amis les Américains étaient
à portée de ma voix je leur dirais : Il y a
un spectacle encore plus noble que celui d'un continent uni, un
spectacle qui étonnerait le monde par sa nouveauté
et sa grandeur, le spectacle de deux peuples vivant l'un à
côté de l'autre, sur une frontière de près
de 4,000 milles de longueur, frontière à peine
visible en plusieurs endroits, sans un canon montrant sa gueule
menaçante à l'autre côté de la frontière,
sans une forteresse d'un côté ni de l'autre, sans
aucun armement, mais vivant en harmonie, dans une confiance mutuelle,
et sans aucune autre rivalité qu'une généreuse
émulation dans le commerce et les arts de la paix. Au peuple
canadien je dirai que s'il nous est possible d'établir
des relations de ce genre entre ce peuple jeune et grandissant
et la puissante république américaine ; le
Canada aura rendu à la vieille Angleterre, la mère
de ces nations, et à tout l'empire anglais, un service
sans égal dans ses effets immédiats et surtout dans
ses conséquences au point de vue de l'avenir.





