|
La théorie économique et le champ des sciences humaines et sociales: une troisième voie
Romain Kroës
Diplômé de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de l'Etat, retraité du transport aérien depuis 1997. Divers articles dans les revues spécialisées et la presse générale, deux rapports de droit d'alerte, deux ouvrages: Erreurs humaines (1992) et Capitalisme fin d'une histoire (1994), Editions De Magrie. Domaines de recherche successifs: ergonomie, philosophie des systèmes, économie du transport aérien, histoire économique, épistémologie économique.
Résumé
A travers l'échange, la course à la productivité et les crises de l'endettement, cet article invite à réviser les controverses traditionnelles sur la place de l'économie par rapport au champ des sciences humaines et sociales. Ces controverses résultent en fait d'un ensemble de faiblesses conceptuelles. D'une part, les diverses théories de l'échange n'intègrent ni l'échange primordial entre l'espèce et l'écosystème, ni les rendements décroissants imposés par celui-ci. Ce biais une fois rectifié, il s'avère possible d'isoler des contraintes spécifiquement économiques échappant au relativisme comportementaliste ou normativiste. D'autre part, le dogme du rôle central du capital dans la formation de l'investissement et son corollaire, le rôle démiurgique de l'épargnant, masquent tout à la fois la nécessité économique du crédit et la dimension sociologique de la créance. Entre la métaphysique par laquelle la théorie économique prétend s'approprier tout le champ des sciences humaines et sociales et celle qui la réduit à une simple partition de cet ensemble, il n'y a donc pas lieu de trancher, mais de tracer le périmètre d'une incontournable science économique autonome. L'article n'en propose cependant qu'une ébauche.
Mots clés: asymétrie, productivité, entropie, crises, créance.
Abstract
Economic Theory and the field of human and social sciences: a third way
Through exchange and race to productivity and debt crisis, this paper invites people to revise the traditional controversies about the place of economics with respect to the field of human and social sciences. In fact, these controversies are resulting from a set of conceptual weaknesses. On one hand, the various theories of exchange integrate neither the primordial exchange between mankind and ecosystem, nor this latter's imposing a fading efficiency. This bias once corrected, it turns out that it is possible to isolate some specific economic constraints escaping the behaviourist or prescriptivist relativism. On the other hand, the dogma of capital's role in creating investment, and its corollary, saver's demiurge role, are concealing both the economic necessity of credit, and the sociological dimension of debt. Between the metaphysic according to which the economic theory appropriates the whole of the field of human and social sciences, and the one that reduces the economic theory to a simple partition of this set, there are no grounds for coming to a decision, but for drawing the perimeter of an autonomous economic science that can not be ignored. However, the paper proposes only a draft of it.
Key words: asymmetry, productivity, entropy, crises, debt.
Introduction
La question de la situation de l'économie par rapport au champ des sciences humaines et sociales se trouve aujourd'hui au coeur des choix politiques et géopolitiques. Elle oppose une conception naturaliste, au sens de la nature humaine, par laquelle l'économie s'approprie tout le champ des sciences humaines et sociales, à une conception plus politique qui la réduit à une simple partition dans le champ des sciences sociales. La première justifie le "libéralisme", la seconde par exemple l'"altermondialisme". Une approche scientifique de la question doit-elle trancher entre ces deux conceptions, ou bien considérer que l'inventaire en est encore incomplet?
Pour le savoir, nous partons ici de trois processus qui caractérisent l'économie humaine et qui sont réputés mettre en oeuvre tant les comportements humains que les rapports sociaux. Il s'agit de l'échange, de la course à la productivité et du problème de la dette. Nous considérons d'abord les termes dans lesquels ces processus sont actuellement théorisés et le degré de justification qu'ils apportent aux deux conceptions antagoniques. Puis nous relevons un certain nombre de contradictions par lesquelles l'actuelle théorie économique fausse la question. Enfin, une approche historique des crises récurrentes de l'endettement nous conduit à séparer la question du crédit et celle de la créance. Le crédit se présente comme le résultat d'une contrainte spécifiquement économique, la créance comme un déterminant sociologique de premier ordre.
I. L'échange, la productivité et le crédit dans la théorie économique
Les diverses théories de l'échange économique à ce jour recensées renvoient toutes soit à l'homme naturellement mercantile d'Adam Smith (1991, p.80), soit à l'homme social de Marx (2000, S.537) ou de Polanyi (1972, p.74-75), l'un et l'autre étant prédisposés et non pas assujettis à l'échange. Le caractère subsidiaire accordé à la dimension économique de l'échange est encore renforcé par le postulat de la préexistence d'utilités surabondantes comme condition préalable à sa réalisation (Marx, 1962, S.102; Weber, 1991, p.218). Pour résumer, la théorie économique elle-même considère l'échange économique comme appartenant à l'ensemble des échanges humains, individuels ou sociaux, et en aucun cas comme une nécessité d'origine économique qui s'imposerait aux individus et à la société.
La théorie économique et la sociologie s'accordent par Smith (1991, p.77) et Durkheim (1967, p.1) à faire de la productivité une conséquence de la division du travail, elle-même engendrée dans un cas par l'homme naturel et dans l'autre par le progrès social. Pour le premier, l'accroissement de la division du travail dépend de "l'étendue du marché" (Smith, 1991, p. 85). Pour le second, elle dépend également de l'extension des échanges sociaux (Durkheim, 1967, p.237), sauf que Durkheim ne limite pas l'échange au "marché". Tant pour Smith que pour Durkheim, il ne fait donc aucun doute que l'accroissement de la productivité ne dépend que des hommes et de la société. L'actuelle théorie économique n'a en rien altéré cette certitude qui justifie une conception de la productivité écartant, là aussi, toute nécessité d'origine économique.
Bien que Keynes ait démontré le contraire - nous y reviendrons un peu plus loin - les économistes croient toujours, comme Smith (1991, p.354) et Marx (1964, S.254) que c'est le capital qui avance l'investissement, et que son accumulation vient de la part du profit que le capitaliste choisit d'investir plutôt que de la consommer. Aussi Weber est-il fondé d'attribuer la formation de capital à la "contrainte ascétique à l'épargne" (2003, p.237). Mais alors, le crédit ne répond pas, lui non plus, à une nécessité économique. Il n'est nécessaire qu'à ceux qui n'épargnent pas et qui doivent de ce fait, à ceux qui épargnent, une juste rétribution de leur vertu, associée à une juste pénalisation de la prodigalité. Et c'est pourquoi le crédit public ne saurait entraîner que des "incumbrances" (Hume, 1777).
Par conséquent, la théorie économique justifie complètement, du moins par ses formulations explicites, soit l'appropriation du champ des sciences humaines et sociales par l'économie, en tant que l'homme est un être économique par essence, soit l'intégration de celle-ci comme simple partition dans le champ des sciences sociales, en tant que l'homme est par essence un être social. Le problème, pour l'approche scientifique, c'est qu'elle ne peut trancher entre deux métaphysiques. Mais il reste à confronter les termes, dans lesquels la question est posée, au "principe de réalité".
II. Asymétrie de l'échange économique
Les théories de l'échange économique jusqu'ici recensées reposent toutes sur une hypothèse implicite jamais démontrée ni prouvée: celle d'une symétrie originelle des échanges. Pour les unes, c'est le troc équilibré entre valeurs d'échange intrinsèques (Smith, 1991, p.99-108; Marx, 1962, S.50-92) ou utilités extrinsèques (Bentham, 1789; Mill, 1998; Walras, 1952, p.82-87), pour les autres la "réciprocité" (Sahlins, 1976; Kolm, 1984). La représentation de la réalité économique s'organise ainsi autour d'une sorte de mouvement perpétuel d'où il résulte que l'économie ne peut être que comportementaliste ou normative. Mais l'histoire économique n'accrédite pas l'hypothèse d'une symétrie résultante des échanges.
Si les échanges commerciaux pouvaient être globalement symétriques, comme le postulent encore implicitement les économistes, la balance des paiements de chaque territoire serait alternativement positive et négative, puisqu'en principe nul ne peut éternellement s'abstenir de faire face aux échéances de remboursement d'une dette, sous peine d'être exclu des circuits commerciaux.. Or il se trouve qu'historiquement c'est le contraire qui est vrai.
Athènes, qui importait la majeure partie du blé qu'elle consommait, exportait peu en échange; et Xénophon (1958, p.455) nous révèle que les importateurs pouvaient partir du Pirée avec pour toute cargaison de l'argent tiré des mines du mont Laurion et dans lequel était frappé le symbole d'Athéna. Si Athènes avait dû importer le métal dans lequel elle frappait sa monnaie, le problème se serait posé d'équilibrer la balance des paiements. D'où l'absolue nécessité, pour cette métropole qui est alors la ville la plus peuplée de Méditerranée, d'assurer la suprématie de sa monnaie afin que ce soit son métal qui circule en paiement des denrées importées, et non pas celui de ses partenaires. Quand il sort pour la première fois, il équilibre le déficit de la balance commerciale. Quand il revient, à la faveur du passage des innombrables visiteurs d'Athènes pour raisons commerciales, politiques ou touristiques, il participe du déficit commercial, du fait qu'il accroît la consommation intérieure et par conséquent le recours aux importations. Mais en fait il ne revient que partiellement, soit qu'il circule dans le reste du système monde, soit que les partenaires commerciaux d'Athènes l'absorbent en thésaurisation.
De tous temps, les métropoles des systèmes monde ont cherché à solder leurs échanges extérieurs dans leur propre monnaie, parce qu'ainsi, en cas de déficit, elles peuvent payer leurs dettes avec leurs dettes. Toute monnaie est en effet contrepartie d'une dette. Celui qui la reçoit en paiement détient une créance sur les biens de son lieu d'origine. Mais s'il s'agit d'un solde commercial systématiquement déficitaire, la créance différentielle n'est jamais honorée, puisque dans ce cas un accroissement des exportations de la métropole considérée ne modifierait pas par lui-même la structure de l'appareil productif. Il signifierait une croissance de la production, et augmenterait par conséquent les importations dans la même proportion.
Alors, les créances s'accumulent et se renouvellent indéfiniment; et elles ne font l'objet d'une échéance effective, que si la métropole est contrainte de payer ses dettes à l'aide d'une monnaie dont elle n'a pas la maîtrise. C'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle de notre ère, pour éviter de devoir équilibrer ses importations par ses exportations ou des transferts d'or, l'Angleterre a inventé les balances sterling que ses débiteurs pouvaient placer contre intérêt sur le marché financier de Londres. Ce système est devenu aujourd'hui le privilège des USA dont la balance commerciale, systématiquement déficitaire, est transformée en financement de leur économie, grâce au statut d'unité de compte planétaire du dollar. La permanence historique de la distribution systématique du signe de la balance commerciale, négative pour les pôles importateurs, positive en moyenne pour la périphérie du système monde, reflète l'asymétrie structurelle des échanges économiques.
L'archéologie atteste l'existence, dès le paléolithique, d'un réseau très étendu de relations commerciales maritimes, fluviales et terrestres, constitué de populations de producteurs et de marchands plus ou moins spécialisées, organisées en sphères régionales d'échanges (Servet, 1980, p.30). La thèse de la propension humaine à l'échange et de la préexistence d'un surplus de valeurs d'usages transformable en valeur marchande s'avère très insuffisante pour expliquer cette réalité, d'autant qu'alors, selon toute vraisemblance, les surplus sont consacrés aux sacrifices. Seule la nécessité d'aller chercher toujours plus loin des matières premières essentielles comme le sel, le silex et l'obsidienne, en raison de l'épuisement irrémédiable de leurs gisements accessibles, peut expliquer l'étendue et l'expansion de tels réseaux commerciaux. Le sel pour la conservation et le stockage des aliments, le silex et l'obsidienne pour l'industrie des outils et des armes. Plus tard, ce seront les métaux puis les phosphates et enfin le pétrole.
Autrement dit, pour autant que la "horde" ait jamais existé, le processus de sédentarisation, loin de répondre à une nécessité économique, a au contraire confronté les hommes à un problème économique à première vue insoluble, cependant résolu par l'invention du commerce. Celui-ci se justifie donc non par on ne sait quelle prédestination à l'échange qui serait inhérente à la nature humaine, mais simplement par son statut de complément indispensable de la sédentarisation.
Un commerce qui se trouve très tôt caractérisé par une irréductible asymétrie: celle de l'échange de produits agricoles ou manufacturés, renouvelables sur place, contre des matières premières qui ne le sont pas. Tel est l'échange asymétrique qui structure l'économie monde en expansion qu'Immanuel Wallerstein (1974) restreint à l'Europe du 16e siècle, mais dont Guillermo Algaze (1993) a démontré qu'on la rencontre déjà dans la sphère étendue des échanges de Sumer, près d'un millénaire avant le premier empire de l'histoire connue.
Par conséquent, la théorie économique ne justifie l'intégration de l'échange économique à l'ensemble des échanges de toute nature entre les groupes et les individus, qu'à la condition d'ignorer la réalité de l'asymétrie originelle et structurelle de cet échange. Elle ne tient compte en fait que des échanges entre les hommes, sans égard pour l'échange primordial entre l'espèce et l'écosystème.
III. La course à la productivité est illusoire
C'est précisément cette méconnaissance de l'échange primordial entre l'espèce humaine et son environnement, de la part de la théorie économique, qui autorise les sciences humaines et sociales à s'approprier le phénomène de la course à la productivité, réputée ne dépendre que de l'innovation et de la division du travail. Or l'asymétrie de l'échange primordial autorise un tout autre éclairage de ce phénomène.
Tant qu'une expansion du réseau commercial est possible, la tendance au rendement décroissant des gisements de matières fossiles peut être compensée. Il en résulte un surcoût qui peut être lui-même compensé par des gains de productivité dans les transports et les communications. Mais, périodiquement, se présente un obstacle qui limite le rayonnement et les capacités des lignes de transport et de communication. La tendance à l'épuisement des gisements provoque alors une tension sur les prix relatifs: il faut plus d'exportations, en échange de chaque unité de matière première importée. Le pôle importateur doit alors augmenter la production voire la productivité de ses exportations. C'est par exemple ce qu'on observe à Sumer, où l'afflux de matériaux et d'objets précieux en provenance d'Anatolie, d'Arménie, d'Iran et du Golfe Persique va de pair avec l'extension du domaine agricole, le creusement de canaux d'irrigation, la multiplication des ateliers de vannerie et de poterie, et l'élévation de la température des fours.
Ainsi s'explique très simplement l'origine de la course à la productivité. Bien entendu, la dialectique des prix relatifs et de la productivité joue dans les deux sens. Ce peut être celle-ci qui exerce sur les importations une tension, quand elle entraîne une croissance générale de la production et donc de la demande de produits génériques. Cette initiative est historiquement observable, mais en faire l'origine des tensions plurimillénaires réclamerait néanmoins une hypothèse anthropologique non vérifiable, de l'ordre de la propension à l'échange, tandis que la nécessité de compenser une tension sur les prix relatifs ne demande d'autre hypothèse que celle de la tendance, avérée, à l'épuisement des gisements, et de la durée des cycles de renouvellement de certaines richesses comme les forêts. Enfin, la contraction des prix de revient, qui constitue le critère le plus universel et le plus constant de la gestion des entreprises, milite en faveur de la réponse productiviste à des tensions extérieures, ainsi que de leur persistance historique.
Figure 1
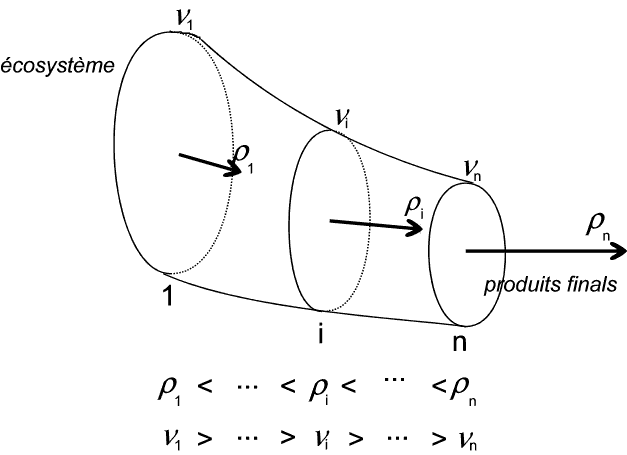
La chaîne des transformations entre l'écosystème et les productions finales. Les vecteurs r représentent la productivité, croissante de l'amont vers l'aval. Chaque section représente l'activité, en nombre n de producteurs, croissante de l'aval vers l'amont. Tout gain de productivité en aval de la chaîne, en réponse à une dégradation en amont, ne fait qu'accentuer le différentiel des productivités.
La course à la productivité est donc fondamentalement une réaction aux rendements décroissants de l'exploitation des ressources naturelles. En d'autres termes, soit elle ne fait que compenser une baisse de productivité sur la chaîne des transformations, soit elle se heurte à une dégradation de l'écosystème, ou à la concurrence de tiers confrontés aux mêmes nécessités. Si l'on se contente d'observer une partie seulement de la chaîne économique (figure 1), celle qui englobe les pôles de l'accumulation, on peut avoir l'illusion que, globalement, la productivité de l'économie humaine peut croître indéfiniment. Et encore faut-il ne pas prêter une grande attention au phénomène de déplacement relatif de l'emploi, au sein même de ces métropoles, vers les activités où la productivité artificielle est structurellement la moins élevée. Le processus de "délocalisation" de l'emploi, dans le cadre de la "mondialisation", obéit certes à une sous-enchère sur le prix du travail. Il atteste néanmoins que la productivité ne supprime pas le travail mais le déplace (figure 2). On peut ajouter que ce déplacement constitue d'autre part un facteur d'entropie non seulement écologique mais aussi sociologique, tant en aval qu'en amont de la chaîne "mondialisée".
Figure 2
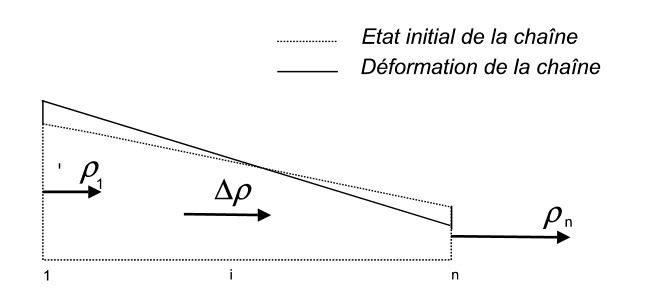
Déplacement du travail vers l'amont, sous l'effet d'une accentuation du différentiel de productivité.
Le progrès technique est certes cumulatif, mais, en intensifiant l'exploitation et la dégradation sociologiques et écologiques, il est aussi la cause de la volatilité des gains de productivité. Autrement dit, la course à la productivité recrée elle-même sa propre nécessité, de sorte que, de ce point de vue, l'innovation et la division du travail accomplissent très exactement un travail de Sisyphe. Nous pouvons donc conclure que l'économie de la productivité est justiciable d'une approche scientifique autonome par rapport à celle des sciences humaines et sociales.
IV. De la nécessité du crédit
Si plusieurs pôles exportateurs de produits agricoles et manufacturés, poussés par la même nécessité de faire face à une tension sur les prix relatifs ou à l'une de ses conséquences collatérales, se disputent la même zone d'expansion commerciale, ils entrent en concurrence. Cette circonstance explique bien des guerres sinon toutes, et notamment celles que fit l'Angleterre à la Hollande et à la France au 17e siècle, ainsi que les guerres napoléoniennes. Elle explique enfin la folie universelle de la priorité aux exportations et l'insoluble problème qu'elle pose aujourd'hui à l'organisation mondiale du commerce (OMC).
Si un pôle exportateur ne réussit pas à compenser la tension sur les prix relatifs par des gains de productivité ou par des moyens coercitifs, il doit accroître ses exportations au détriment de son marché intérieur. Quand celui-ci est trop appauvri par la priorité aux exportations, le pôle en question ne peut plus faire face à ses engagements commerciaux extérieurs. Tel est aujourd'hui le problème de la dette qui amplifie l'urgence des exportations pour une fraction tendanciellement majoritaire de la population mondiale, et stérilise son développement.
Les crises de l'endettement remontent à la plus haute antiquité. Elles sont attestées dès le troisième millénaire, en Mésopotamie, par la récurrence des décrets d'annulation des dettes (Sollberger et J-R Kupper, 1971, p.68-69; J. Bottéro et E. Cassin, 1961), si présente dans la mémoire moyen-orientale qu'on en trouve l'écho dans l'ancien testament et les écrits intertestamentaires. L'acte fondateur de la démocratie athénienne est un décret dramatique d'annulation des dettes publiques et privées, la sisachthie de Solon (Aristote, 1985). L'histoire de la République romaine est jalonnée de "nouveaux registres" (tabulae novae), c'est-à-dire de remises de dettes, et même après l'intermède du consulat de Cicéron, Jules César puis Auguste prenaient encore des décrets aboutissant à une dépréciation de l'endettement (Salvioli, 1906, p.243).
La dimension historique du problème de l'endettement laisse peu de place à la morale de l'épargne qui dénie au crédit toute nécessité d'origine économique. Cela vient de ce qu'en réalité, ce n'est pas l'épargne qui détermine l'investissement, mais l'inverse, ainsi que Keynes en a fait la démonstration. Il n'est en effet pas possible d'épargner plus que la quantité de valeur monétaire mise en circulation par les circuits bancaires (Keynes, 1973, p.84-85). Un épargnant qui ajoute un titre à son portefeuille s'enrichit, lui, mais il ne peut le faire que si quelque part un actif de même valeur est cédé. De ce fait, il n'enrichit nullement la collectivité (Keynes, 1973, p.83-84). Autrement dit, l'épargne ne peut pas assurer un investissement additionnel. Elle ne peut fournir que réinvestissement, c'est-à-dire recyclage de la valeur ayant déjà accompli au moins un cycle productif. Autrement dit encore, ce n'est pas le capital financier qui avance l'investissement additionnel, mais l'institut d'émission monétaire, c'est-à-dire le "crédit public", ce qui tend à dénier au capital le rôle central qu'à bien ou à mal de toute part on lui prête encore.
La nécessité du crédit vient de la nécessaire gestation des produits du travail. Le temps qu'un produit soit fabriqué et mis en vente, il faut bien en effet que ses producteurs vivent, ainsi que leurs ayant droit. La mobilisation d'une force de travail additionnelle nécessite donc une création monétaire qui constitue une distribution additionnelle de pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'accès aux stocks, le temps que ceux-ci soient reconstitués. Tout investissement est un endettement sur l'avenir. Cet endettement est éteint par la vente des produits additionnels, à l'issue de leur fabrication. L'investissement initial devient alors un profit pour le capital financier, en vertu de dispositions purement juridiques (figure 3).
Figure 3
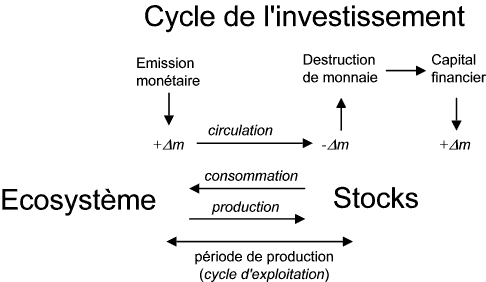
Transformation de l'investissement en profit cumulable au capital financier. La période est le cycle moyen d'exploitation (Immobilisations sur Valeur Ajoutée), c'est-à-dire la gestation moyenne des produits du travail. Au désendettement, le profit ne reste cependant un capital que s'il est immédiatement quelque part réinscrit au passif en face de l'actif correspondant.
"Qui paie ses dettes s'enrichit", dit la sagesse populaire. Il est permis de s'étonner qu'une vérité aussi limpide n'ait toujours pas droit de cité dans la théorie économique. Théoriciens et politiciens continuent en effet de raisonner selon le dogme du rôle démiurgique de l'épargnant, comme en témoigne notamment la stratégie des "privatisations" dont on attend rien moins qu'un miracle. C'est que cette question sort du domaine de la rationalité. L'audace de Keynes n'est pas simplement passée inaperçue ou tombée dans l'oubli. Bien qu'elle n'ait jamais été scientifiquement réfutée, elle a été rejetée. L'université s'est empressée de l'oublier ou de la minimiser, si bien que les étudiants l'ignorent ou en reçoivent une version douteuse. Derrière cette rigidité dogmatique, se cache une problématique qui s'identifie à l'histoire de la civilisation: celle de l'attribution de la créance.
V. La créance, pilier de la polis
Dans la structure économique tribale, le créancier en dernier ressort, à travers ses métaphores, est la nature nourricière à qui tout appartient y compris les stocks. Le cycle économique commence alors par un investissement de travail et se termine par la reconstitution des stocks à l'occasion des battues, cueillettes, moissons et parturitions du bétail. Les hommes ne manquent pas alors de remercier dieux, ancêtres et esprits, envers lesquels ils se considèrent comme débiteurs. Les stocks étant suffisamment fournis, le surplus est restitué à ses légitimes propriétaires, c'est-à-dire sacrifié, afin que ces derniers consentent à perpétuer les cycles nourriciers. L'antériorité des stocks par rapport à la production courante tend à conférer la créance aux aînés à qui sont dus la subsistance et la semence, mais le plus ancien des aînés est lui-même débiteur des ancêtres, et ainsi la créance est-elle à toute la communauté (Meillassoux, 1992, p.70). Cette représentation du circuit économique procède de la cohésion du groupe, en ce qu'elle évite de le diviser en débiteurs et créanciers: les conséquences des mauvaises récoltes, épidémie, etc. sont amorties par les stocks, c'est-à-dire réparties entre tous. Comment est-on passé de la créance collective à sa répartition individualisée?
L'historienne et sociologue Jane Jacobs (1969) a formulé une hypothèse hétérodoxe selon laquelle les premières cités ne se seraient pas développées sur une base économique rurale, ainsi qu'il est encore communément admis des économistes, historiens et ethnologues, mais directement à partir d'une activité commerciale de comptoir ou de carrefour. Ce serait alors l'agriculture qui succéderait à la civilisation urbaine, et non pas l'inverse. A l'appui de cette thèse, Jane Jacobs cite Çatal Hüyük, en Anatolie, où John Mellaart (1971) a mis au jour les preuves d'une culture qui perpétue les traditions picturales du paléolithique supérieur et n'a pas connu le néolithique. Jane Jacobs avance un autre argument qui interpelle directement l'économiste et l'anthropologue. C'est l'observation, de toutes les époques, selon laquelle les gains de productivité en agriculture ont toujours eu une origine urbaine et accompagnent la croissance des cités. L'intérêt de l'hypothèse de Jane Jacobs est d'introduire le cosmopolitisme qui caractérise la cité et que n'intègre pas l'hypothèse de l'émergence d'une ville à partir d'un gros village. Elle permet ainsi d'expliquer l'avènement juridique de la créance, par la dissolution du lien entre généalogie et administration politique qui caractérise les agglomérations homogènes.
Dans la cité cosmopolite, la gestion des stocks n'étant plus assurée par les anciens nécessite qu'un personnel spécialisé s'y emploie, au nom de la divinité tutélaire du lieu. Les surplus, prenant dorénavant la forme d'offrandes, servent alors essentiellement à entretenir le personnel de ces palais ou de cestemples. C'est de cette structure fonctionnelle, dans laquelle la relation de parenté se dissout, que viennent les premières reconnaissances de dette, c'est-à-dire les premières créances écrites. De son côté, le prince délègue le commerce extérieur à des associations marchandes et institue les taxes qui font de lui-même le créancier principal (Weber, 1998, p.153). Néanmoins, la référence à l'instance divine se perpétue longtemps, au moins jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère où, en dépit du développement du commerce et du crédit bancaire et commercial, on trouve encore des attestations de dettes envers le dieu tutélaire du temple qui a fourni la marchandise (Garelli, 1963, p.252-253). La créance gravée dans l'argile institue les magasins et entrepôts comme origines du cycle économique. C'est à eux qu'on emprunte, c'est envers eux qu'on se désendette. Si bien qu'on trouve déjà, également au deuxième millénaire, des contrats de prêts qui attribuent la propriété de la marchandise à des individus ou organismes laïcs et ne font plus référence aux dieux que pour solenniser les engagements et présider à la solution des litiges (Garelli, 1963, 233-234, 248). Ainsi commence le règne du capital.
C'est ici l'occasion de proposer du capital une définition dénuée d'ambiguïté. A ce jour, les diverses acceptions de ce concept demeurent entachées de naturalisme, ne parvenant pas à séparer les moyens de production des titres de leur propriété, ainsi que des diverses formes de créances fiduciaires. Il y aurait un capital industriel et un capital financier s'additionnant l'un à l'autre. La monnaie, même, s'y ajouterait, comme une forme complémentaire des deux autres. Cette confusion débouche sur un débat sans fin autour de la mesure du capital accumulé et de sa circulation. Quel est l'amortissement économique des moyens de production? Quelle est leur valeur résiduelle? En quelle unité faut-il les mesurer? Si le capital est matériel, alors il faut considérer qu'il existe depuis la nuit des temps, car les hommes ont de tout temps consommé productivement des stocks et des outils. Le débat s'éteint, si l'on considère que le capital n'est pas une substance mais une abstraction, duale du capital réel, et dont le fondement est purement juridique. Il est constitué des parts de copropriété sur l'appareil productif, ainsi que de toutes les formes de créances associées à la production, des obligations aux effets de crédit bancaire et commercial.
Le capital, en tant qu'entité sociale hégémonique, est donc né du statut juridique de la créance, lui-même issu d'un glissement progressif de l'imputation de la dette, consécutif à la gestion documentaire des stocks. Cependant, s'en tenir à cette corrélation accréditerait l'idée que la force d'un simple habitus suffirait à bouleverser une longue tradition socio-économique et culturelle, alors qu'un tel renversement dogmatique met nécessairement en jeu les ressorts les plus intimes de l'imaginaire. Au temps où la représentation du circuit économique est spontanément isomorphe de l'échange primordial entre l'espèce et son environnement, les divinités sont des métaphores de la nature. Quand s'inverse l'imputation dogmatique de la dette, les dieux sont devenus anthropomorphes et les olympes des projections de la cité dans lesquelles le temps et la mort sont abolis. C'est cette mutation culturelle qu'il faut interroger. Et elle n'a de sens que si l'on observe la religion des sociétés primitives avec un oeil différent de celui des "occidentaux".
Les rites de ces sociétés que leurs conquérants méprisaient ne sont pas de pures superstitions. Ils ont une caractéristique commune: celle de conjurer les dangers qui menacent les individus et le groupe. Ils occupent toute la journée d'un homme, présidant à chacune de ses activités et contraignant d'autre part l'individu à faire la preuve qu'il adhère à la collectivité, à ses traditions, à sa doxa. Ces rituels sont le plus souvent festifs et non pas lugubres ou craintifs, même lorsqu'ils sont relatifs à la mort. Comment expliquer alors cette répression obsessionnelle et son acceptation de tous, dans des sociétés où le pouvoir appartient aux anciens, de sorte que tout le monde y accède un jour, où les anciens eux-mêmes sont réputés tributaires des ancêtres, et où l'on n'a encore inventé ni les castes, ni les dynasties? Cette question reste une énigme, si l'on considère les "primitifs" comme l'enfance de l'humanité, et ayant à ce titre un comportement comparable à celui du petit enfant. Mais si l'on déplace quelque peu le théorème et qu'au lieu de la répression on envisage la protection de l'individu, l'adhésion de celui-ci devient concevable. Cependant, la simple protection matérielle n'explique pas les rituels contraignants et compliqués. Il s'agit nécessairement d'une protection psychique dont témoignent le chamanisme et l'exorcisme.
Selon Lucien Lévy-Bruhl, les civilisations primitives ont toutes en commun de s'investir essentiellement dans la conjuration de la peur (1963, XX-XXI). Une peur métaphysique qui ne paralyse pas l'érotisme de ces sociétés, mais qui oppose des interdits à tout ce qui peut constituer une menace contre l'intégrité et la pérennité du groupe, y compris les conflits d'intérêts et les sentiments incontrôlés tels que la colère, la jalousie, etc. (Lévy-Bruhl, 1963, p.45-63) Mais ce qui a toujours constitué et constitue toujours la plus grande menace pour la civilisation, on l'a bien vu en ce vingtième siècle, c'est l'aliénation des esprits. Il s'agit de conjurer le monstre qui se révèle dans les rêves. Selon Sandor Ferenczi (Roudinesco et Plon, 1997, p.849), "L'homme normal devient psychotique pendant la nuit", et trente mille ans au moins avant l'exploration de l'inconscient par Freud, les sociétés primitives, très impressionnées par la vie onirique, ont compris qu'il fallait l'aider à ne pas l'être pendant le jour. L'argument de tout le rituel développé à cet effet n'est pas l'oppression de l'individu, mais un exorcisme qui le met à l'abri de la folie. Non pas seulement de la folie pathologique, mais aussi et surtout de la confusion entre le rêve et la réalité, qui peut aller jusqu'au délire totalitaire, lequel procède de la même incapacité à tracer une démarcation entre la raison et l'utopie qui est rêve éveillé.
Si les rites des religions et sociétés primordiales ont un tel pouvoir, ce n'est pas par eux-mêmes, mais du fait qu'ils mettent en scène trois instances: le sujet, les esprits de la nuit et le tiers interprète, médiateur et sacrificateur au nom de la collectivité. Dans la vie économique, on retrouve ce triumvirat dans les rapports entre les producteurs, les anciens et les ancêtres ou (et) les métaphores de la nature. Les anciens gèrent les stocks au nom des ancêtres, esprits, etc., c'est-à-dire de la collectivité. Si les chasses, récoltes et parturitions du bétail sont abondantes, ou si au contraire un quelconque fléau les frappe, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie ou en subit les conséquences.
En d'autres termes, grâce à l'interposition du Tiers, chaque individu pris en tant que tel est mis en une relation médiatisée avec lui-même par le "pôle collectif" (Lévi-Strauss, 1958, p.198), c'est-à-dire ès qualité. Il est débiteur en tant que personne exerçant la demande et créancier en tant que membre de la communauté. Si le tiers séparateur disparaît, chaque individu devient à la fois et immédiatement débiteur et créancier envers lui-même. Alors, la collectivité n'existe plus, et aucune instance ne peut plus aider l'individu à se libérer du "diable". Cela se produit quand les représentants du Tiers s'identifient à la Référence (théocratie), ou quand les sujets entrent dans une relation fusionnelle avec eux (tyrannie), ou bien encore lorsque le Tiers s'efface et délègue aux individus la charge de négocier directement entre eux, et de commercer avec la Référence de leur choix (libéralisme). En bref: quand il n'y a plus que deux instances. C'est le point où se rejoignent oppression et aliénation.
Si dans la civilisation urbaine les dieux deviennent anthropomorphes, c'est que la séparation entre l'imaginaire et le réel est devenue floue, après une longue période pendant laquelle le tiers séparateur s'est identifié à la Référence. Les dieux ont d'abord remplacé les ancêtres et les esprits de la nature. La monarchie s'est projetée dans le théâtre divin. Les olympes se sont construits sur ce modèle, au fur et à mesure que les royaumes s'agrégeaient en une superstructure, chaque cité y apportant sa ou ses divinités (Bottéro, 1987, 254-263).
Enfin, l'espace où vivait l'individu est devenu le centre de la terre, et la terre le centre de l'univers, conformément à l'égocentrisme et au fantasme de toute-puissance projetés dans la cité olympienne et l'anthropomorphisme des dieux. "Il convient de ne pas perdre de vue cette évidence que la terre est essentiellement pour le vivant l'espace sur lequel il se tient debout et sur lequel il marche", croit pouvoir écrire Elena Cassin, érigeant en une loi générale une caractéristique de la cosmogonie sumérienne (1987, p.15). Mais pour la société dogon, le centre de l'univers n'est pas la terre, mais Sirius (Griaule et Dieterlen, 1991, p.234). A méditer.
Le dogme de l'attribution de la créance au capital n'est donc pas le produit d'une simple modification dans la gestion des stocks. Il est étroitement associé à l'anthropocentrisme, forme institutionnelle du narcissisme qui succède à l'hégémonie de la raison primitive sans laquelle aucune civilisation n'aurait pu voir le jour. De même que l'anthropocentrisme s'explique par le fait que le dieu primordial n'a pas pu placer sa créature préférée ailleurs qu'au centre de l'univers, la créance apparaît comme un partage entre les créanciers de ce qui appartient à la divinité. Le capital est un don de Dieu, et rien ne saurait par conséquent le corrompre, ni le temps, ni aucun événement. L'or monétaire symbolisera naturellement ce fantasme d'innocuité du temps et des événements à l'égard des créances. La "prédestination" le justifiera idéologiquement. Ainsi les créanciers seront-ils prédestinés et de ce fait légitimés - l'ordre social étant voulu par Dieu - à posséder le capital, à la condition de le conserver intact pour la Gloire de Dieu, et de le multiplier (Weber, 2003, p.232).
Cette mutation psychoculturelle peut donc s'expliquer par l'évanescence des liens généalogiques entre les sujets et les tiers médiateurs. Les stocks sont désormais gérés par des spécialistes asservis au Temple, au Palais, puis au capital privé, et l'individu n'est bientôt plus en rapport avec ses concitoyens que par des liens juridiques directs de créances et de dettes. La créance n'ayant de sens que si elle est honorée à échéance et en toutes circonstances, la dette, cette fois, divise le groupe social. Ce ne sont plus les stocks, et encore moins leurs gestionnaires, qui sont censés amortir les aléas et vicissitudes de la production, mais en premier lieu ceux d'entre les producteurs qui en sont débiteurs.
Le renversement des pôles créditeur et débiteur place le capital au centre de la vie économique, politique et sociale. Ainsi s'explique notamment le dogme de l'antériorité de l'épargne par rapport à l'investissement.
La récurrence des crises de l'endettement et de la dévalorisation des créances, soit par décret d'annulation des dettes, soit par la dévalorisation de l'unité de compte, ou "inflation", révèle l'instabilité et la limite du système de l'appropriation privée du capital financier. Mais elle met également la civilisation en péril.
D'un côté, la sortie de crise passe par une inévitable annulation de tout ou partie des dettes les plus criantes, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi à l'intérieur des territoires économiques où un endettement anticipant une croissance finalement réprimée étrangle les entreprises et les pousse artificiellement vers la faillite. L'obstination à vouloir protéger les créances ne peut que retarder cette échéance, ainsi que le prouve une histoire déjà plurimillénaire. Ce n'est pas la dévalorisation des créances qui est perverse, c'est la fiction juridique qui prétend opposer un équilibre pérenne à un déséquilibre structurel irréductible. L'histoire le prouve abondamment: on ne sort jamais d'une crise économique sans une dévalorisation du capital.
D'un autre côté, la civilisation repose entièrement sur le système des créances-dettes. L'appropriation privée des créances masque ce pilier de la polis, du fait qu'elle suggère un conflit d'intérêts déstabilisateur et cause de tous les désordres. En fait, ce n'est qu'une forme dérivée et même, peut-on dire, dévoyée du rapport fondamental des citoyens à la cité. A l'origine, la cité invente le droit, pour remplacer le lien généalogique effacé par le cosmopolitisme; et le premier acte juridique est la reconnaissance de dette. Par elle, le citoyen est à la fois débiteur, en tant que sujet de la demande, et créditeur ès qualité, en tant que sujet reconnu de la collectivité. C'est ce lien civilisateur originel qu'il faut préserver, et non pas le clivage qui l'a supplanté.
Conclusion
La question du statut de l'économie ne peut donc être tranchée par aucune des deux conceptions qui s'affrontent et qui reposent également sur un présupposé métaphysique de toute-puissance, individuelle ou collective, des hommes sur leur économie. En réalité, l'échange économique et la course à la productivité obéissent essentiellement à des contraintes d'écosystème et au phénomène d'entropie associé à tout processus matériel. De ce fait, ces deux processus requièrent une approche scientifique autonome, non pas exclusive mais indépendante de toute considération comportementaliste ou normative. En revanche, la question de l'attribution de la créance échappe à toute considération économicienne et tombe complètement dans le champ de la sociologie.
Le problème de la place de la théorie économique concerne en fait essentiellement cette dernière qui empiète sur ses voisines ou se trouve envahie par elles, du simple fait qu'elle n'a pas encore été capable de délimiter son périmètre. Puisse l'ébauche qui en est ici proposée contribuer à cette entreprise nécessaire.
- Références bibliographiques:
Algaze, Guillermo. The Uruk World System. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
Aristote. Constitution d'Athènes, VI, 1. Paris: Les Belles Lettres, 1985.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne, 1789. Bibliothèque virtuelle du CHPE, Paris I, http://phare.univ-paris1.fr/
Bottéro, Jean et Cassin, Elena. "Désordre économique et annulation des dettes en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne", in Journal of economic and social history of the Orient, Leiden: E. J. Brill, 1961, vol.IV, Part II, p.113-164.
Bottéro, Jean. Mésopotamie. Paris: Gallimard, 1987.
Cassin, Elena. Le semblable et le différent. Paris: La Découverte, 1987.
Durkheim, Émile. De la division du travail social. Paris: Les Presses universitaires de France, 1967, 8e édition, Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.
Garelli, Paul. Les Assyriens en Cappadoce. Paris: Adrien Maisonneuve, 1963.
Griaule, Marcel et Dieterlen, Germaine: Le renard pâle. Paris: Institut d'ethnologie, 1991.
Hume, David. "Of Public Credit", in Essays and Treatises on Several Subjects (1777). Bibliothèque virtuelle du CHPE, Paris I, http://phare.univ-paris1.fr/
Jacobs, Jane. The Economies of Cities. New-York: Random House, 1969.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge (GB): Macmillan and Cambridge University Press, 1973.
Kolm, Serge-Christophe. La bonne économie, la réciprocité générale. Paris: Presses Universitaires de France, 1984.
Lévi-Strauss, Claude. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958.
Lévy-Bruhl, Lucien. Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris: Presses Universitraires de France, 1963.
Marx, Karl. Das Kapital. Berlin: Dietz Verlag, 1962, Erster Band.
Marx, Karl. Das Kapital. Berlin: Dietz Verlag, 1964, Dritter Band.
Marx, Karl. Ökonomische-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. K. Marx u. F. Engels, Werke, Ergänzungsband, 1. Teil, S.465-588. Marxists' Internet Archive, 2000, http://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/
Meillassoux, Claude. Femmes, greniers et capitaux. Paris: l'Harmattan, 1992.
Mellaart, John. Çatal Hüyük, une des premières cités du monde. Paris: Tallandier, 1971.
Mill, John Stuart. L'utilitarisme, Essai sur Bentham. Paris: Presses Universitaires de France, 1998.
Polanyi, Karl. La grande transformation. Paris: Gallimard, 1972.
Roudinesco, Elisabeth et Plon, Michel. Dictionnaire de la psychanalyse. Paris: Fayard, 1997.
Sahlins, Marshall. Age de pierre, âge d'abondance. Pais: Gallimard, 1984.
Salvioli Giuseppe. Le capitalisme dans le monde antique. Paris: V. Giard et E. Brière, 1906.
Servet, Jean-Michel. "Ordre sauvage et paléomarchand", in Sauvages et ensauvagés. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1980.
Smith, Adam. La Richesse des Nations. Paris: Flammarion, T1, 1991.
Sollberger, Edmond et Kupper, Jean-Robert. Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes. Paris: Le Cerf, 1971.
Wallerstein, Immanuel. The modern World System, New York, Academic Press, 1974.
Walras, Léon. Eléments d'économie politique pure. Paris: LGDJ, 1952.
Weber, Max. Histoire économique. Paris: Gallimard, 1991.
Weber, Max. Economie et société dans l'antiquité. Paris: La Découverte, 1998.
Weber, Max. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Paris: Gallimard, 2003.
Xénophon. "Ressources ou revenus", in Oeuvres. Paris: Les classiques Garnier, 1958.
- Notice:
- Kroës, Romain. "La théorie économique et le champ des sciences humaines et sociales: une troisième voie", Esprit critique, Printemps 2004, Vol.06, No.02, ISSN 1705-1045, consulté sur Internet: http://www.espritcritique.fr
|