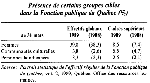
Jacques Bourgault
Université du Québec à Montréal
James Iain Gow
Université de Montréal
L'année politique au Québec 1988-1989
| · | Rubrique : L'administration publique |
L'année 1988-1989 n'est pas pour l'administration publique l'occasion d'innovations majeures, bien qu'il y ait eu l'annonce des orientations d'une réforme du système de la santé et des services sociaux. C'est plutôt une année qui nous rappelle la prédominance du quotidien dans la vie de l' État. Après les grands débats, après les commissions parlementaires, après l'adoption des lois et des règlements, l'administration applique, révise et met ceux-ci en vigueur. Le public et la classe politique prennent conscience de cette activité à l'occasion d'enquêtes, de vérifications, de conflits, d'incidents ou encore lorsque les tribunaux interviennent au nom du respect de la règle de droit. Dans le texte qui suit, nous abordons les changements les plus importants survenus au sein de l'administration publique selon l'ordre suivant: les institutions, notamment la santé et les services sociaux, l'environnement, la protection du territoire agricole et Hydro-Québec, suivies de la Fonction publique, des négociations collectives dans le secteur public et, enfin, de l'évolution des règles du droit administratif et des institutions judiciaires en 19881989.
Au ministère du Conseil exécutif, on dénombre 250 organismes gouvernementaux, dont 24 ministères, qui composent la trame de l'administration québécoise. Notre relevé porte sur ceux qui ont connu des développements importants ou controversés en 1988-1989.
Jamais de mémoire de citoyens, autant de faits troublants ridiculisant la gestion d'un domaine n'ont été dévoilés dans l'espace d'une seule année.
Du côté des productions, relevées par les médias, mentionnons l'adoption d'un nouveau règlement sur les déchets toxiques (mars 1989), d'un plan de diminution de la pollution industrielle visant surtout les 630 principaux pollueurs responsables de 75 % de ce type de pollution (juin 1989), le développement du programme d'assainissement des eaux, la création d'une escouade de « police verte », la publication du rapport Lacoste sur la consultation préalable à tout nouveau projet industriel; notons d'autre part l'amende de 105000$ imposée en avril à Mines Eldorado pour avoir enfreint la Loi sur la protection de l'environnement.
Par ailleurs la crédibilité du gouvernement et du ministère furent sérieusement mises en cause tout au cours de cette année: en avril 1989 un sondage révèle que plus du tiers des Québécois doutent de la sincérité des gouvernements en matière d'environnement.
D'autre part on ne cesse de critiquer le fonctionnement du ministère: en janvier la C.U.M. le taxe de laxisme dans l'application des normes hors de la région de Montréal, en février l'embauche d'une nouvelle sous-ministre adjointe se fait dans la controverse suite au rôle qu'y a joué le chef du cabinet du Premier ministre; les éditorialistes multiplient les attaques contre le ministère: on reproche la mauvaise qualité des inspections, le fait que de faux rapports d'entrepreneurs ne soient pas vérifiés, que les avis émis par les inspecteurs soient impunément ignorés, que des poursuites soient trop rarement prises contre les contrevenants, et que les injonctions et plaintes pour nuisance soient sous-utilisées.
Ainsi, au cours de l'année il fut révélé que Marc Lévy, propriétaire de l'entrepôt dévasté de B.P.C. à St-Basile, falsifiait systématiquement ses rapports, et ce, sans émouvoir le ministère, qu'un permis de transport de matières dangereuses fut émis à la compagnie LE.M. sans consulter le gouvernement de l'Ontario (avril 1989), que la ministre ne savait pas si son ministère était au courant du commerce illégal d'huiles contaminées (mai 1989), que Laval avait autorisé illégalement une compagnie appartenant au président du Comité des finances du Parti libéral du Canada (M. Rizzutto) à opérer un dépotoir; les problèmes de gestion des sites d'entreposage de pneus et de pesticides font la manchette presque chaque semaine : déjà en décembre 1989, il avait été démontré que le ministère avait renouvelé les permis de Marc Lévy alors qu'il savait ce dernier sous le coup d'avis d'infractions et responsable de la diminution des garanties que la loi lui avait requis de donner au ministère; de plus, c'est le ministère lui-même qui aurait autorisé et même obligé Lévy à loger sous un même toit des solvants inflammables et des huiles contenant des B.C.P. En juin les conclusions du commissaire aux incendies dans l'affaire de l'entrepôt de St-Basile seront accablantes pour le ministère. De plus, la publication du rapport Lacoste en mars relèvera l'énorme lenteur du processus actuel d'études et d'audiences préalables aux divers projets demandant en moyenne trois ans de délais!
Comme si ces controverses nées de l'application courante des lois ne suffisaient pas, les actions du front commun anti B.P.C. en Abitibi contre l'entreposage de B.P.C., puis de Greenpeace en Angleterre, puis des débardeurs sur la Côte-Nord ont infligé au ministère et à tout le gouvernement un long calvaire politique, alors que la facture de la décontamination passe progressivement de dix à 48 millions.
À ces coups du sort s'ajoutent les nombreuses difficultés politiques vécues aux plus hauts paliers du ministère: tout d'abord la crédibilité des ministres est attaquée; après la démission de Clifford Lincoln en désaccord avec la politique linguistique de son gouvernement voilà son successeur, Me Bacon qui le critique en avril d'avoir plus parlé qu'agi et de n'avoir pas fait avancer les dossiers depuis quatre ans; elle-même fut prise à partie par la presse qui déplore qu'elle cumule la direction de deux ministères; puis voilà, le ministre Paradis des Affaires municipales qui demande en avril que le ministère de l'Environnement soit amputé de la partie de sa mission qui prolonge celle des affaires municipales en matière de traitement de l'eau.
Les ressources disponibles au ministère ont souventes fois défrayé la manchette cette année: après avoir ajouté 100 postes en août 1988, voilà que 43 postes dont onze d'inspecteurs sont coupés en janvier 1989 laissant à l'état d'embryon, l'escouade de « police verte » ; le budget, comparé à celui du ministère de l'Environnement de l'Ontario, apparaît toujours famélique avec trois fois moins d'employés et quatre fois moins d'argent (crédits de traitement des eaux non compris); en mars 1989 Me Bacon veut deux fois plus d'argent, elle aura finalement une augmentation de 15 % de ses crédits.
À côté du ministère, un organisme public voué à la protection de l'intérêt public en matière d'environnement relève du ministre, il s'agit du Bureau d'audiences publiques en matière d'environnement (B.A.P.E.); or cet organisme a connu une année toute aussi mouvementée que celle qu'a vécue le ministère.
Requis de mettre sur pied une enquête portant sur les moyens à mettre en oeuvre pour disposer des déchets dangereux suite à l'accident écologique de St-Basile, voilà que le B.A.P.E. est accusé d'avoir nommé des membres trop tolérants pour mener cette enquête, d'avoir tardé à la mettre sur pied et surtout d'avoir négligé de demander au Conseil du trésor les moyens supplémentaires pour mener correctement cette enquête; la ministre laisse le président du B.A.P.E. porter une large part de responsabilité dans cette affaire, et surtout après publication d'une lettre strictement confidentielle à elle adressée par le président du B.A.P.E. qui offre à la ministre de tenir une enquête dont les conclusions ménageraient le ministère, éviteraient d'embarrasser la ministre et serviraient à rassurer la population plutôt qu'à dresser un portrait complet de la situation lorsque cette description risquerait d'inquiéter la population! La ministre forcée de publier ces échanges épistolaires, ne renouvellera pas le mandat du président Goldbloom après avoir rabroué celui-ci.
Le B.A.P.E. était déjà par ailleurs sous les feux de la rampe ayant perdu beaucoup de crédibilité aux yeux des groupes de pression concernés qui lui reprochent en avril, de tolérer que trois postes de commissaires soient vacants depuis dix-huit mois, d'avoir largement dépassé le délai promis pour publier le rapport Lacoste, de tenir des audiences après de trop longs délais, d'avoir cessé de publier son bulletin d'information; ces critiques s'ajoutent à celles déjà formulées à l'effet que le B.A.P.E. tolérerait la pratique des entreprises qui fragmentent les demandes de permis d'arrosage de pesticides pour éviter ses audiences publiques et à l'effet que l'octroi d'une permission de survol du territoire à des avions de chasse F-18 pour fins d'utiliser un champ de tir avait aussi été exempt d'audiences publiques.
En mai 1989, le gouvernement nomme Yvon Charbonneau, candidat défait au rectorat de l'Université de Sherbrooke et ex-président de la Centrale des enseignants du Québec, à la tête de la Commission d'enquête sur les moyens de disposer des déchets dangereux; ce faisant, il nomme une personne qu'on ne pourra accuser de complaisance encore que certains aient questionné sa compétence particulière pour cette tâche.
La C.S.S.T. attira l'attention du fait de son premier budget équilibré, de la réforme de son financement et surtout, des sévères critiques dont elle fut l'objet de la part du vérificateur général.
En 1988, la hausse des cotisations des employeurs (40 % de 1985 à 1989), le resserrement des dépenses et surtout une approche beaucoup plus sévère pour indemniser les accidentés du travail lui fait présenter son premier budget équilibré sous les critiques croisées des employeurs réclamant une baisse des cotisations et des syndicats demandant plus de générosité dans l'évaluation des dossiers. En mars 1989, elle annonce une réforme interne de son financement par laquelle les catégories d'employeurs se répartiront différemment la note de 1,5 $ milliard à la fois selon les secteurs de provenance et selon la performance de chaque entreprise en matière de prévention d'accidents.
Cette bonne santé budgétaire, la C.S.S.T. la doit en partie à la nouvelle rigueur de traitement des dossiers: or, le Protecteur du citoyen l'avait qualifiée à cet égard de monstre grotesque promenant chaque dossier entre quatre à douze paliers de décision, multipliant les délais, dans un univers de complexité technique et bureaucratique: de fait les plaintes reçues en 1988 au sujet de la C.S.S.T. avaient augmenté de 80% par rapport à l'année 1987.
La plus grande controverse vint certainement de la publication en décembre 1988 du rapport du vérificateur général; cet employé de l'Assemblée nationale y envoya 26 employés pendant cinq mois pour scruter son fonctionnement; à son grand dam, la direction de la C.S.S.T. refusa de commenter son rapport préliminaire.
Le vérificateur conclut que les délais d'indemnisation sont trop longs et que dans 30% des cas, (représentant des dépenses de 280 millions), l'admissibilité des réclamations payées était douteuse à cause de la nature des « blessures », et à cause des informations incomplètes fournies par l'employeur et les médecins; il déplore que plusieurs des mécanismes de prévention prévus par la loi ne soient pas encore mis en place; il note que les intérêts non réclamés aux employeurs sur les cotisations dues ont représenté en 1987 une perte de 400 000 dollars; enfin le vérificateur déplore des erreurs de gestion comme le manque de planification pour les locaux et les postes de travail et souhaite que les liquidités soient gérées par la Caisse de dépôt. Ses conclusions firent un bruit tel que dès le lendemain le ministre responsable sollicita l'aide du vérificateur pour améliorer la situation.
La perception de la situation à la C.S.S.T. changea radicalement un mois plus tard après que la direction et les syndicats eurent réagi aux conclusions du vérificateur; tous deux déplorèrent l'amateurisme du vérificateur lorsqu'il utilise le dictionnaire courant plutôt que la loi, la littérature, médicale, et la jurisprudence pour définir le terme « blessure » ; les syndicats lui reprochent en outre d'allonger les délais en tentant d'augmenter les contrôles et de mal comprendre le système de traitement médical des dossiers d'accidentés du travail.
La direction de la C.S.S.T. contestant la définition de blessure qu'a donnée le vérificateur, prétend qu'au plus 5% (et non pas 30%) des dossiers seraient peut-être douteux; elle rappelle le contexte de l'année 1987 qui amena une nouvelle direction, une nouvelle loi et un nouveau barème des dommages corporels pour justifier les 45 000 dossiers accumulés représentant 200 millions de dollars en demandes d'indemnisation. La réplique du vérificateur vint le ler mars à la Commission parlementaire du budget et de la vérification et ne sut pas convaincre les observateurs du bien-fondé de sa définition de « blessure ».
Après le dépôt du rapport de la Commission Rochon, Me Lavoie-Roux, ministre de la Santé et des Services sociaux, entreprit une longue série de consultations régionales portant sur les conclusions du rapport; cette tournée lui permit de publier au printemps 1989 le document « Orientations » qui énonce les grands axes d'intervention prévus par la ministre pour donner suite aux recommandations du rapport Rochon.
Les observateurs semblent unanimes à concevoir que la ministre retient surtout un aspect du rapport Rochon, soit la régionalisation de la gestion des budgets et qu'elle en propose une application bien singulière; les régies régionales permettront le décloisonnement et l'unification des établissements mais dépendront largement du ministère qui resserrera ses normes et critères de dispensation des services et financera globalement chaque régie dont le responsable sera nommé par la ministre; de plus, les comités de bénéficiaires seront renforcés obtenant plus de pouvoirs formels et de financement tandis que le document est muet tant sur le rôle des' médecins dans le fonctionnement des régies que sur celui du ministère en termes de contrôle des décisions des régies ; enfin la ministre semble concevoir son intervention dans le cadre d'un plafonnement des dépenses publiques en matière de santé. Le document prévoit en outre le remplacement du Conseil des affaires sociales par un centre permanent d'enquête épidémiologique sanitaire et sociale.
Enfin en septembre 1988 fut créé un Conseil de la famille formé de dix-huit membres représentant divers milieux et groupes d'âge de la société.
Adopté en décembre 1987, à la vapeur et sous les feux croisés de la critique venant de tous horizons, le projet de loi 30 créant une Commission des relations de travail qui recevait les pouvoirs de quatre organismes coexistants (le Conseil des services essentiels, la Commission de la construction, le Bureau du commissaire du travail et le Tribunal du travail), n'a toujours pas en 1989 trouvé preneur auprès des groupes d'intérêt du milieu.
Cette loi visant officiellement à déjudiciariser les relations de travail et à raccourcir les délais de décision participe à la logique du comité des sages qui recommandait en 1986 de réduire les budgets gouvernementaux en réduisant le nombre des organismes et des fonctionnaires. Syndicats et patrons contestent l'ampleur des pouvoirs de l'organisme et surtout, ils souhaitent conserver un forum juridique en droit du travail.
En octobre 1988 le ministre qui n'a toujours pas fait mettre en vigueur cette loi, vieille de onze mois, crée plutôt un comité pour revoir ses champs d'application et ses modalités de fonctionnement. Le rapport prévu pour mai 1989 n'était toujours pas paru en juin 1989.
Le plan de transport du gouvernement du Québec a reçu un accueil assez favorable des banlieues formant la grande ceinture de Montréal; la ville de Montréal et la Communauté urbaine ont cependant reçu l'appui de la quasi-totalité des groupes de pression économiques de la région pour dénoncer ce plan qui, à leur avis, contribuera à éloigner de Montréal encore plus d'industriels et de résidents ; la querelle a aussi porté sur la façon de refaire l'autoroute Métropolitaine, le maire de Montréal prêchant pour la solution plus complète et fonctionnelle d'aménager l'autoroute en tunnel que le ministre trouve beaucoup trop chère. À la Commission parlementaire le ministre restera sur ses positions... dont il dérogera pendant la campagne électorale pour annoncer le prolongement du métro à Laval, proposition qui accroîtra encore davantage l'exode des Montréalais vers les banlieues du Nord.
Les conflits permanents à la S.T.R.S.M., les menaces de conflits à la S.T.L., les problèmes de financement vécus dans ces deux sociétés et à la S.T.C.U.M. et les accusations de mauvaise gestion pleuvant sur la S.T.R.S.M. dont le directeur général fut limogé, tous ces facteurs contribueront à faire germer dans l'esprit du ministre un immense projet de réforme du transport public dans la région de Montréal. Faute de temps avant la campagne électorale et d'assurance quant à la perception de la réforme par les groupes concernés l'annonce du projet fut reportée à des jours meilleurs mais l'épée de Damoclès est maintenant visiblement suspendue au dessus des sociétés de transport de la région métropolitaine.
En novembre 1988 sont fusionnés les ministères du Commerce extérieur et des Affaires intergouvernementales dans le ministère des Affaires internationales. Restent à vivre des défis de l'intégration des personnels des deux administrations jusqu'alors concurrentes.
À son arrivée comme ministre des Affaires internationales, M. Paul Gobeil envisageait de déménager une part importante des effectifs à Montréal (les opérations commerciales et économiques) et même de diminuer l'étendue du réseau de délégations à l'étranger.
En septembre 1989 on constate que les résistances bureaucratiques au sein du ministère et les résistances du milieu politique de la ville de Québec ont réussi à lui imposer un quasi-statu quo puisqu'il semble que moins d'une dizaine de 35 postes ciblés furent déménagés à Montréal.
Après avoir reçu un rapport d'évaluation des délégations du Québec à travers le monde et avoir effectué des missions sur les cinq continents le ministre Gobeil en arrive au printemps 1989, à la conclusion que plutôt que de fermer des délégations il en ouvrira cinq aux États-Unis et d'autres peut-être en Asie et en Amérique du Sud, ces dernières étant financées par un réaménagement des ressources actuellement disponibles.
L'exportation de la production québécoise servira d'axe de développement et de fonctionnement pour le réseau des délégations; à tous ces égards les fonctionnaires du ministère semblent rassurés et agréablement surpris des conclusions de leur ministre.
Les incidents entourant le dézonage à la ville de Laval ont révélé des failles dans un processus qui, pourtant, semblait bien rodé. Par une loi de 1985, le gouvernement péquiste avait introduit une révision de la classification des terres établie au lendemain de l'adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole en 1978. Selon ce processus, la municipalité régionale de ce comté fait une proposition à la Commission de la protection du territoire agricole pour ajuster les limites des zones agricoles verte et blanche. Sous les auspices de la CPTA se tient une discussion avec la section locale de l'Union des producteurs agricoles. S'il y a consensus, le projet est soumis pour approbation au Conseil des ministres qui l'approuve sans modification.
La proposition litigieuse concerne le dézonage de 4 444 hectares, soit près de 40 pour cent des terres de Laval jusqu'alors réservées à l'agriculture.
Cette proposition fut le fruit d'une entente signée le 19 mars 1988 entre la ville de Laval, la MRC et l'UPA. Le ministre de l'Agriculture, Michel Pagé s'apprêtait à en recommander l'adoption au Conseil des ministres quand l'opposition a soulevé une série de faits troublants entourant cette décision, en commençant par un sondage qui montrait que 69 pour cent des citoyens de Laval étaient opposés au projet.
Au mois de juin 1989, le député péquiste Jacques Brassard suggère que quatre groupes ou individus pourraient réaliser des profits de 750 millions $ à la suite du dézonage proposé, chiffre que le premier ministre Bourassa qualifie de farfelu. Néanmoins, il est établi que certains de ces terrains appartiennent à la famille de Tommy d'Errico, président de la compagnie Beaver Asphalte et président également de la Commission des finances du Parti libéral du Québec: or, M. d'Errico a eu à l'été de 1987 une rencontre personnelle avec Pierre-Luc Blain, président de la CPTA, à propos de deux terrains situés dans la zone verte, qu'il songeait à acheter. Ces terrains, qui furent effectivement achetés par M. d'Errico aux mois d'août et de septembre 1988, ne figuraient pas dans la première version de l'entente Laval-MRC-UPA. Ils furent ajoutés à la demande de la CPTA qui est même revenue à la charge deux fois là-dessus et ce, selon les journaux, contre l'avis de son propre service technique.
Le plus grand bénéficiaire de ce projet de dézonage serait cependant un autre individu, Alex Kotler, dont les différentes compagnies associées à sa firme Monitec disposaient à elles seules de 860 hectares et qui risquaient de réaliser des profits, selon le PQ, de 630 millions $. De plus, à la CPTA, qui avait refusé de dézoner ces mêmes terrains avant l'élection de 1985, les commissaires qui ont traité de ces questions avaient tous été nommés par le gouvernement Bourassa depuis 1985. Les journaux ont aussi révélé que M. Jacques Beldie, conseiller municipal à Laval et ancien président d'une association de comté libérale, a participé à une vente de terrain dans la zone impliquée deux mois avant la signature de l'entente en question. Enfin, Mme Gilles Lacroix, la femme du président de l'UPA de Laval aurait fait une offre d'achat sur un terrain dans cette même zone, conditionnelle à une modification du zonage.
Dans la levée de boucliers qui a suivi ces diverses révélations, les attaquants étaient le Parti québécois et le Parti lavallois, parti municipal d'opposition. Tandis que le gouvernement cherchait d'abord à se dérober en déclarant qu'il n'avait pas à se mêler d'une décision prise à la suite d'une entente négociée par les intéressés, ceux-ci ont défendu le projet, rappelant notamment qu'en tout il impliquait 4 000 propriétaires. L'Union des MRC a dénoncé la démagogie qui entourait le débat. Le président du comité exécutif de la ville de Laval, Gilles Vaillancourt, comme le président national de l'UPA, Jacques Proulx, ont soutenu que la nouvelle zone verte consolidait les vraies terres agricoles à Laval. M. Proulx a déclaré que M. Lacroix avait été injustement critiqué et que désormais l'UPA « ne se mêlera plus de zonage ».
Au gouvernement, la tactique de Ponce Pilate n'ayant pas marché, on procède par étapes afin de limiter les dégâts. Le ler juin le projet de zonage à Laval est suspendu. Le 2juin M. Bourassa annonce qu'une enquête sera menée afin de faire l'inventaire complet des transactions sur les 4 444 hectares en question. M. Pagé annonce qu'il déposera avant la fin de la session parlementaire un projet de loi ayant pour but notamment de séparer les deux fonctions de la CPTA, l'une judiciaire et l'autre administrative, mais le Conseil des ministres ne s'entend pas sur son projet et il le retire. Le 17 juin, M. Pagé annonce un moratoire général et global sur tous les décrets de révision de zonage agricole en attendant le rapport d'un comité de travail présidé par un haut fonctionnaire, Me Jules Brière, chargé de proposer des mesures pour améliorer le processus. Pour compliquer encore le débat, le gouvernement annonce la mise en vigueur au ler juillet du projet de loi 100, adopté le 12 avril et qui prévoit qu'il existera dorénavant deux sortes de zones vertes, l'une à usage exclusif et l'autre, protégée elle aussi, mais pas de façon exclusive. L'opposition a vite appelé ces deux zones celle du « vert foncé» et celle du « vert pâle ».
Le 27 juin M. d'Errico démissionne de son poste de président de la Commission des finances du Parti libéral du Québec. Le 5 août il est annoncé que M. Blain, dont le mandat à la présidence de la CPTA est échu depuis quelques temps, est nommé «expert » à la Régie des marchés agricoles. Le même jour, le ministre de la Justice annonce que, faute d'indice qu'une infraction a été commise, aucune enquête policière ne sera faite dans cette affaire. Pendant ce temps l'Union des MRC dénonce le moratoire qui cause des torts considérables, ditelle, aux parties qui s'étaient entendues dans tous les autres cas de projet de dézonage (il y en a 46), mais il est clair que le dossier est en suspens jusqu'après les élections.
Le nom de Tommy D'Errico était aussi mêlé à deux histoires de patronage dans l'attribution des contrats de voirie, mais aucune n'a eu le retentissement de l'affaire du dézonage à Laval.
En 1988-1989, la société d'État Hydro-Québec avait plusieurs raisons de pavoiser. Sa santé financière était excellente, de nouveaux contrats de ventes d'électricité à l'état de New York avaient été signés, le ministre responsable, John Ciaccia, avait annoncé en septembre 1988 une politique d'autosuffisance en énergie hydroélectrique. Une nouvelle direction de l'entreprise, installée à l'automne de 1988, visait un statut ressemblant à celui d'une entreprise privée. Malheureusement pour elle, une série sans précédent de pannes d'électricité, puis des difficultés dans certains autres dossiers comme les relations avec la clientèle et les relations de travail ont rappelé le statut éminemment politique de cet organisme.
L'importance d'Hydro-Québec dans l'économie et la société québécoise est indéniable. Au début de mars 1989, lors de la présentation de son plan de développement 1989-1991, la société rappelait quelques chiffres impressionnants. Avec une contribution directe et indirecte à l'économie québécoise de l'ordre de 5 pour cent, Hydro engendre 55 000 emplois (70 000 en 199 1), fait l'acquisition annuelle de biens et services d'une valeur de 2 milliards $ et se situe au premier rang des entreprises d'électricité au Canada pour ce qui est des dépenses de recherche et de développement. En novembre 1988, elle conclut une entente avec NewYork Power Authority pour vendre entre l'an 1999 et 2018 du courant saisonnier d'une valeur estimée à 8,5 milliards$, tandis que la NVPA tiendra à sa disposition l'hiver quelque 400 mégawatts qui vaudront environ 380 millions $ sur la période couverte par le contrat. Puis, le 26 avril, Hydro a signé avec la NVPA « le plus important contrat d'exportation de son histoire » : à partir de 1995, par étapes, on atteindra une capacité de 1000 MW pour ces ventes, qui rapporteront près de 17 milliards $ en 21 ans.
La nouvelle direction, sous le président du conseil d'administration, Richard Drouin, et le président à l'exploitation, Claude Boivin, donne tous les signes de vouloir conduire l'entreprise sur une base commerciale, en bons « citoyens corporatifs » bien sûr, mais rien de plus. Par exemple, ils voudraient ramener le taux de retour sur son avoir-propre de 8 pour cent réalisés en 1988 aux 13,5 pour cent réalisés par des entreprises semblables au Canada ou aux États-Unis. Également, ils veulent graduellement éliminer l'interfinancement par lequel présentement les abonnés domestiques ne paient pas le coût entier du courant qu'ils consomment, tandis que les PME en paient plus que leur part. Dans le plan de développement, la direction demande au gouvernement une hausse générale des tarifs de 4,7 pour cent, qui se répartit en trois composantes, soit 5,7 pour cent pour le secteur domestique, 4,7 pour cent pour les grandes entreprises et 3,6 pour cent pour les PME. La moyenne de 4,7 pour cent serait suffisante pour couvrir la hausse de l'inflation attendue en 1989, tandis que le tarif proposé pour le marché domestique vise non seulement à rendre cette clientèle plus sensible au coût réel du courant, mais aussi à augmenter le taux de retour sur l'investissement de 8,4 pour cent à 9,9 pour cent en 1991. Troisièmement, en commission parlementaire, en expliquant l'introduction du limitateur du courant pour les abonnés qui ont plus de 120 jours de retards dans le paiement de leurs comptes, le vice-président à la planification générale, André Delisle, refuse l'idée de transformer « Hydro-Québec en complément de l'aide sociale ». Finalement, il est clair que deux des objectifs de la direction dans les négociations avec ses différents syndicats sont de ramener les salaires à l'Hydro à la moyenne des vingt entreprises les plus grandes au Québec et de récupérer des pouvoirs de gérance afin d'agir de façon unilatérale sans attendre l'accord du syndicat.
Mais il y eut les pannes. En commission parlementaire, le président et chef d'exploitation Jean Claude Boivin, a résumé la très mauvaise année qu'a connue l'Hydro en 1988: 46 000 pannes, ce qui constitue une hausse de 35 pour cent et qui est le double du chiffre du début des années 1980, une durée moyenne de 9,1 heures de panne par client, par rapport à une moyenne canadienne de 4 heures en 1986 et, surtout, trois pannes du système de transport du courant, dont une panne générale de plusieurs heures au 18 avril 1988. Après une panne impliquant 500 000 foyers le 15 novembre 1988, le ministre Ciaccia déclare que la situation est inacceptable et nomme un groupe de travail composé de trois experts étrangers pour faire rapport. Pour ajouter aux malheurs de la société, des erreurs de lecture de compteurs à l'automne de 1988 auraient donné lieu à des erreurs importantes de facturation, de sorte que des montants considérables ont dû être réclamés par de nombreux clients dès le mois de janvier. Cet incident a défrayé les manchettes pendant plusieurs jours.
Dans le plan de développement de 1989-1091 présenté en commission parlementaire au mois de mars, la direction propose des investissements de plus de 700 millions $ pour les sept années à venir afin de réduire le nombre et la durée des pannes, mais M. Boivin prévient qu'avec le climat québécois, il sera difficile de rivaliser avec la moyenne canadienne. Pour le grand malheur de la direction, le système est frappé d'une nouvelle panne générale le 13 mars. Bien que des scientifiques du Conseil national de recherche trouvent crédible l'explication de l'Hydro voulant que la panne fut le résultat de perturbations du champ magnétique de la terre à la suite d'orages solaires d'une rare intensité, le président du Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec attribue la panne à l'état lamentable du réseau à l'abandon, depuis 1980. Cette explication est aussi l'une des causes retenues par les trois experts dans leur rapport dont M. Ciaccia a fait part à la presse le 5 mai 1989.
Selon un sondage fait conjointement par Le Devoir et Créatec publié le 22 mars, le public est aussi de cet avis. Soixante-douze pour cent des répondants trouvent le nombre de pannes inacceptable. Parmi les causes retenues, de loin la plus importante est l'usure du réseau (89 pour cent). Viennent ensuite la manque de personnel d'entretien (70 pour cent), le manque de contrôle gouvernemental (69 pour cent), l'incompétence des hauts dirigeants (64 pour cent) et l'étendue du réseau (63 pour cent). La direction d'Hydro-Québec, qui avait déjà publié un communiqué le 9 décembre 1988 voulant rassurer le public sur sa fiabilité et ainsi démentir toute idée que « le réseau électrique du Québec est vétuste et mal entretenu », revient à la charge le 22 mars avec une déclaration du président Drouin relevant d'autres opinions exprimées dans le sondage, notamment que trois répondants sur quatre estiment que le personnel d'Hydro-Québec a toujours la compétence technique nécessaire pour solutionner les problèmes actuels et qu'une majorité s'estime satisfaite des services à la clientèle de l'entreprise.
Le gouvernement, lui, s'est montré d'accord avec les 72 pour cent des répondants qui trouvaient insuffisant le contrôle exercé par le gouvernement sur l'Hydro. Au lendemain de la panne du 13 mars 1989, le ministre Ciaccia exige un rapport mensuel sur les travaux d'amélioration du réseau. Le 5 mai, jour où il dévoile le contenu du rapport des trois experts étrangers, M. Ciaccia annonce la suspension de tous les travaux majeurs sur le réseau jusqu'à ce qu'il ait eu réponses satisfaisantes aux critiques de la technologie proposée. En fait, les travaux n'ont pas été suspendus.
Du côté des relations avec la clientèle, le gouvernement n'accorde qu'une hausse moyenne de 4,3 pour cent suivant ses propres calculs du taux probable de l'inflation. Aussi, il n'accorde qu'un très léger redressement de l'interfinancement, les PME ayant un taux de 4,0 pour cent à payer, les deux autres catégories, un taux identique de 4,5 pour cent. Puis, par une législation sanctionnée le 14 juin, un poste d'ombudsman est créé pour recevoir et enquêter sur les plaintes de la clientèle.
Ainsi, Hydro-Québec est soumise à des contrôles grandissants, alors qu'elle voulait fonctionner comme toute autre entreprise du genre, publique ou privée. Un autre dossier, celui de l'environnement (notamment lors de la phase Il du projet de développement de la Baie James), risque de lui rappeler dans un proche avenir la nature politique de son rôle et de sa fonction.
La Loi sur la Fonction publique de 1983 impose au Conseil du trésor l'obligation de déposer à l'Assemblée nationale au plus tard le 22 décembre 1988 un bilan de la mise en application de la loi avec des recommandations, s'il y a lieu, de l'amender. Ce n'est pas une vraie clause « sunset », car la loi reste en vigueur à moins d'être révoquée ou amendée, mais le rapport du Conseil du trésor doit être examiné en commission parlementaire. Le Rapport sur la mise en oeuvre de la Loi sur la Fonction publique fut effectivement déposé à l'Assemblée nationale le 28 décembre 1988. Huit mois plus tard, il n'avait toujours pas été étudié en commission parlementaire.
Le rapport rappelle les grands problèmes qui avaient été relevés par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la Fonction publique (Commission Bisaillon, 1982), « Pour une fonction publique sensible aux besoins des citoyens, moderne efficace et responsable ». La loi de 1978 avait donné lieu à une réglementation excessive et à l'omniprésence des organismes centraux dans la vie des ministères et organismes assujettis. Les activités de vérification et de contrôle avaient connu un développement phénoménal et la règle du mérite, telle que renforcée, posait de nouveaux obstacles à l'efficacité et à l'accès à l'égalité. La loi de 1983 part de ces constats pour proposer « une gestion des ressources plus humaine plus souple, quoique plus exigeante ».
Sur presque tous les plans, le rapport accorde une note de « satisfaisante » à la loi. La réglementation a été largement remplacée par des directives ou des politiques du Conseil du trésor. S'il constate des progrès significatifs dans les domaines de la mobilité interne, de la formation et du perfectionnement et des relations de travail, le rapport indique que les progrès ont été plus lents en matière d'égalité en emploi et en évaluation du rendement axée sur les résultats obtenus. La déréglementation et la délégation ont donc commencé à donner des résultats, mais le Conseil souhaite une plus grande harmonisation des pratiques ministérielles avec les politiques gouvernementales, notamment dans des domaines comme l'accès à l'égalité et le rajeunissement des effectifs de la Fonction publique.
Le rapport conclut que les principes, structures et rôles définis dans la loi sont encore valables et qu'il serait prématuré de les modifier après une si brève période. Ce rapport souligne l'un des paradoxes de l'administration publique québécoise de nos jours: grand apôtre de l'imputabilité des administrations et des cadres, le Conseil rend très peu compte lui-même. Seul organisme majeur du gouvernement à ne pas fournir de rapport annuel, le Conseil rate ici l'occasion de pratiquer ce qu'il préche aux autres. Il n'y a dans ce rapport aucun chiffre, que ce soit sur les résultats obtenus ou sur les objectifs qu'il a donnés aux ministères et organismes. Le conseil aurait pu facilement apporter des statistiques pour éclairer les analyses des députés. S'il ne l'a pas fait, on doit présumer que c'est parce qu'il ne voulait pas le faire.
Par ailleurs, du 31 mars 1988 au 31 mars 1989, les effectifs de la Fonction publique sont passés de 52 404 à 52 284, démontrant ainsi une certaine stabilité après plusieurs années de réduction très graduelle. Pour ce qui est des groupes cibles des programmes d'accès à l'égalité, les résultats sont les suivants:
L'année 1988-1989 fut une année de négociations collectives pour la grande majorité des employés des secteurs public et parapublic. Puisque les positions syndicales sont présentées ailleurs dans ce volume, nous ne relèverons que les positions patronales et le rôle des institutions qui composent le cadre québécois de ces négociations.
Pour le président du Conseil du trésor, Daniel Johnson, il ne saurait y avoir une opération plus importante que les négociations des secteurs public et parapublic qui surviennent à tous les trois ans et qui durent au-delà d'un an. En 1989, il doit mener des négociations à 70 tables de négociation impliquant 74 conventions collectives échues depuis le 31 décembre 1988. Si, à première vue, la négociation touche les conditions de travail de quelque 270 000 employés, en réalité elles affectent 340 000 employés, car les syndicats de la FTQ et de la CSD ainsi que le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec avaient accepté l'offre du gouvernement en 1988 de reconduire les contrats existants pour un an, avec une augmentation salariale près de celle du coût de la vie. Ceux-ci étaient donc intéressés à négocier les conditions de travail pour les deux autres années.
Au mois de décembre 1988, M. Johnson annonce ses offres aux syndicats. Elles sont semblables à celles proposées à ceux qui acceptaient la prolongation, à savoir une hausse de 4 pour cent, qui pourrait aller jusqu'à 5 pour cent si l'inflation le justifie. M. Johnson indique qu'il recherche aussi une plus grande flexibilité dans les conditions normatives des conventions, par exemple mettre fin à la limite de 30 km dans le territoire où un enseignant excédentaire doit accepter une nouvelle affectation. À propos du dossier litigieux de la discrimination salariale, le gouvernement adopte une nouvelle position. Celle-ci sera la même pour les infirmières que pour tous les emplois occupés par des femmes: il n'y a pas de discrimination salariale, mais le gouvernement est prêt à introduire une étude globale et scientifique afin d'examiner la relativité salariale. Il ne fera plus l'étude à la pièce. C'est une nouvelle position, car depuis la ronde précédente plusieurs comités conjoints travaillent sur le problème de l'équité salariale.
Tous les syndicats demandaient plus que le double de l'offre gouvernementale pour la première année, le maximum étant les 10,3 pour cent demandés par les infirmières. Au printemps, face au piétinement des négociations, ils ont commencé à recourir aux moyens de pression autres que la grève (assemblées syndicales pendant les heures de travail, obstruction administrative, manifestations). Les moyens qui ont retenu le plus l'attention, cependant, furent ceux des infirmières. Le 22 avril elles ont adopté une tactique de refus de faire du temps supplémentaire. Dès la première fin de semaine près de 1000 lits furent fermés par des hôpitaux incapables de les maintenir sans les infirmières travaillant en temps supplémentaire. La tactique a eu ses effets, car le gouvernement a haussé ses offres aux infirmières à 4 pour cent pour la première année, 7,5 pour cent pour la deuxième année et de 4 pour cent à 9 pour cent la troisième année selon l'ancienneté. Après le refus par les membres de l'entente négociée et acceptée par la FIIQ, le gouvernement les a menacés de recourir à la Loi 160, adoptée en 1986, qui prévoit des sanctions très sévères pour les personnes qui se mettent en grève illégale dans un établissement de santé. Néanmoins, par un vote tenu le 24 août le membres de la FIIQ ont donné un mandat de grève à leur comité de négociation.
L'un des faits saillants de cette négociation est la décision du Conseil des services essentiels concernant le refus des infirmières de faire du temps supplémentaire. Le conseil est un organisme autonome du gouvernement québécois, créé en 1982 et doté depuis 1985 de pouvoirs considérables d'ordonnance et de redressement dans le domaine des services essentiels. Le 19 juin, 1989, face à plus de 2 000 lits d'hôpital fermés au Québec en raison du refus des infirmières, le conseil émet l'opinion que « le refus concerté d'effectuer du temps supplémentaire constitue une grève illégale », même si la disponibilité des employés n'est pas exigée par la convention collective. Le conseil se limite à un constat, et n'émet aucune ordonnance enjoignant la FIIQ de cesser cette pratique. Le président de la CSN, Gérald Larose, blâme le conseil, non pour le fond de sa décision, mais plutôt pour le moment qui, selon lui, ne peut être choisi que pour accélérer les négociations. Il réclame l'abolition du conseil qui est téléguidé selon lui par le pouvoir politique, mais cette revendication n'est pas reprise par d'autres leaders syndicaux. Il est vrai que le gouvernement et la FIIQ en sont venus à une entente deux jours plus tard, mais on sait que les unités de base ont rejeté celle-ci.
L'autre rouage du système issu de la loi de 1985 est l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération (IRIR). Née dans la controverse, cette institution devait être représentative des différents milieux intéressés par son domaine, mais face au refus des syndicats de proposer des candidats, le gouvernement a renoncé à combler les postes (l 6 en nombre) autres que ceux de président et de vice-président. L'IRIR a néanmoins fonctionné depuis sa création, en 1988 il s'est doté d'un comité consultatif provisoire afin de combler le vide laissé par l'absence des membres réguliers.
Les premiers rapports publiés par l'IRIR furent dénoncés par le monde des affaires et par plusieurs journalistes, notamment parce que la comparaison ne comprenait pas tous les avantages non monétaires dont jouissent les employés du secteur public et parce que le groupe d'employeurs retenu, celui employant les « autres salariés québécois », ne comprenait que des entreprises privées ayant au moins 200 employés et plusieurs organismes du secteur public (municipalités, universités, Hydro-Québec, le gouvernement fédéral). Ainsi, disait-on, la comparaison comprenait le secteur public et omettait la masse des employés non syndiqués du secteur privé.
La controverse n'a pas cessé autour de PIRIR, mais celui-ci comble l'une après l'autre les lacunes de ses rapports précédents et les commentateurs commencent à s'en servir. Dans son rapport de fin novembre 1988 et sa mise à jour de fin mai 1989, l'Institut explique qu'il peut désormais comparer toutes les conditions de travail, salaires et avantages sociaux compris, sauf qu'il ne peut pas mettre un chiffre sur la valeur de la sécurité d'emploi qui prévaut dans le secteur public. Dans cette comparaison globale, PIRIR constate, selon la méthode utilisée, un écart de 1 pour cent à 3 pour cent en faveur des « autres salariés québécois ». Pour la première fois, cependant, il ajoute une comparaison strictement public-privé. Celle-ci donne un avantage de 10 pour cent au secteur public mais si on ne retient que les salariés syndiqués du secteur privé l'avantage est soit nul (novembre 1988) soit 1 pour cent (mai 1989).
Ces rapports plus complets sont cités à l'appui de jugements portés lors des négociations. Le 1 er juin Jacques Parizeau s'en servit pour justifier la notion d'un rattrapage à faire. Pour sa part, un critique irréductible de PIRIR, Jean Francoeur écrit dans Le Devoir du 23 décembre « le rapport de PIRIR établit de façon crédible que toutes les conditions offertes aux employés sont tout à fait comparables à celles que les meilleurs employeurs du Québec accordent à leurs salariés ». Ainsi, petit à petit, l'IRIR progresse sur ce terrain si difficile de la comparaison salariale.
Le monde juridique a connu en 1988-1989 de sérieuses remises en cause et ce, mis à part, les dossiers de droit privé tels la réforme du Code civil, et la loi favorisant l'égalité économique des époux; rappelons l'émergence de réglementations municipales sur le port d'armes blanches dont une fut déclarée illégale pour une cour municipale en juillet 1989 parce que fondée sur un règlement imprécis; soulignons surtout l'abolition de la Commission de police du Québec, la création d'un tribunal des droits et libertés, la modification du régime automatique de la curatelle publique et la multiplication des critiques adressées par les plus hautes autorités à notre système de tribunaux.
Le chapitre 75 des lois 1988 fut adopté le 23 décembre 1988 et abolit la Commission de police qu'il remplace par plusieurs instances; d'abord le gouvernement est maintenant habilité à adopter un code de déontologie uniforme pour tous les corps policiers et agents spéciaux (a. 35); les plaintes seront acheminées à un commissaire à la déontologie qui en examinera le bien-fondé et peut rejeter la plainte ou la transmettre soit au Comité de déontologie approprié soit au Procureur général; chacun des trois comités de déontologie, ceux de la Sûreté du Québec, de la C.U.M. et des autres corps policiers, est formé d'un président et d'un nombre égal de membres policiers et de membres qui ne sont ni policiers ni avocats; ces comités, contrairement à la Commission de police rendent des décisions exécutoires; un tribunal de déontologie policière, formé de cinq membres dont un président qui est juge à la Cour du Québec, peut entendre en appel les cas de plaintes rejetées par le Commissaire et les décisions prises par un des comités; enfin le ministre a maintenant pleins pouvoirs pour entreprendre une enquête sur un corp~ policier ou la Sûreté du Québec.
A ce jour, le Code de déontologie fait l'objet de vifs débats entre syndicats policiers, pouvoirs publics et organismes de protection des libertés aux fins de départager le domaine des relations du travail, de celui des libertés fondamentales.
Le projet de loi 141 portant sur le statut des juges municipaux visait à habiliter les villes à constituer individuellement ou collectivement des cours municipales et à conférer à leurs juges une indépendance de statut les mettant à l'abri des contestations à ce sujet qui sont d'ailleurs encore pendantes.
En juin 1989 fut aussi créé un Tribunal des droits et libertés formé d'un juge de la Cour du Québec présidant un banc de cinq personnes et arbitrant des litiges dont les parties ont préalablement consenti à l'intervention de ce forum qui rend une décision exécutoire; ce tribunal qui complète l'action de la Commission des droits et libertés de la personne n'entend que des cas que la Commission a déclarés auparavant recevables; la Commission assiste d'ailleurs le plaignant dans la préparation de son dossier et les coûts des procédures sont à la charge de l'État.
Une loi modifiant le système de curatelle a réorienté sensiblement le rôle du curateur public en matière de gestion des biens et des personnes incapables: on peut s'attendre à ce que celui-ci soit saisi de moins de cas de curatelles privées puisque ces prises en charge par le curateur public seront moins automatiques qu'auparavant; en effet d'une part elles sont maintenant judiciarisées et au certificat médical doit maintenant s'ajouter l'autorisation du protonotaire; d'autre part, par contrat de mandat un particulier peut choisir d'avance son curateur privé lequel agira sous surveillance du curateur public.
Notons enfin la prolifération de critiques venant de magistrats, de hauts fonctionnaires, du ministre de la Justice lui-même et du bâtonnier du Barreau du Québec pour stigmatiser l'inaccessibilité financière de notre système judiciaire, la longueur des délais d'attente et le manque de réserve d'une certaine presse que l'on accuse de transformer des prévenus en coupables par le traitement de l'information qu'elle fait. Des actions de réforme sont promises à ces égards et sous la révision du fonctionnement de la justice administrative, particulièrement pointée du doigt: en 1989, on notait par exemple 14 360 dossiers « en cours » à la Commission des affaires sociales dont 3 500 portant sur des affaires de santé et sécurité au travail inscrites avant 1985 ! La Commission d'appel en matière de maladies et lésions professionnelles aurait, quant à elle, déjà accumulé deux ans de retard en trois années d'opération!
Chaque dossier examiné pour l'année 19881989 révèle une ou des difficultés pour l'administration à bien réaliser les lois. Les dossiers de l'environnement et du zonage agricole illustrent les problèmes qui se posent lorsque l'administré cherche à se dérober à la loi. D'autres cas (la C.S.S.T., les relations de travail et le zonage encore) suggèrent par contre, qu'il peut être gênant pour l'administration de trop se rapprocher de sa clientèle. Enfin des dossiers comme ceux de l'aide sociale et des relations de travail dans le secteur public sont compliqués par l'existence d'exigences constitutionnelles et législatives imposant des règles contraignantes d'égalité et de justice procédurière. Les faits marquants de cette année nous rappellent donc la difficulté de combiner avec bonheur en administration publique les exigences contemporaines d'économie, d'efficience et d'efficacité.