Chapitre 4 (suite)
La régénération
On peut avancer que la tradition anti étatiste et anti
autoritariste provient en grande partie de l'influence de ces hommes anonymes qui n'ont
pas écrit une ligne, ni beaucoup discouru, en rupture de civilisation pendant une longue
partie de leur vie. Dans l'Occident européen, la flamme anti domestique s'assoupissait
sinon s'éteignait puis se rallumait au souffle des harangues ou des écrits subversifs de
certains inadaptés religieux ou intellectuels. L'histoire des idées européennes
conserve en filigrane un courant parallèle ; à ladite culture savante et dominante
s'oppose un rappel à la culture populaire et à la vie dégagée des surcontraintes
sociales imposées toujours par les mêmes aux mêmes. Nous faisons ici un retour en
arrière nécessaire à notre démonstration : Rousseau qui a lu Montaigne et Lafitau, en
vient à l'idée du « bon sauvage », décrivant le monde primitif communiste et
égalitariste. Que voltaire en ait ri et ait pu déclarer que lire Rousseau lui donnait
l'envie de marcher à quatre pattes nous en dit plus long sur sa philosophie sociale que
sur son ironie légendaire. Mais Rousseau, ce « sauvage » du XVIIIe siècle
policé à l'excès, amateur de marche en forêts, savait par ses lectures que des hommes
vivaient l'égalitarisme dans la « sauvagerie », et témoignaient qu'un autre mode de
vie, même pas imaginaire, était possible. Pour ce qui est de la Nouvelle-France, Marc
Lescarbot qui accompagne un groupe de Français venus s'installer en Acadie, en 1606-1607,
décrit les mœurs des Souriquois (Micmacs), s'étonne de n'y point rencontrer de
riches et de pauvres, et admire l'égalité qui règne entre les membres de la tribu. En
plusieurs éléments de leur culture, l'auteur trouve les Amérindiens plus civilisés et
plus vertueux parce que plus simples, plus innocents, plus « sauvage ». Son livre, paru
en 1609, eut trois rééditions, et trouva une large diffusion autant en France qu'à
l'étranger (une traduction allemande et deux traductions anglaises). L'idée du « bon
sauvage » égalitariste était en germe dans les écrits de cet avocat-écrivain, témoin
d'une vie sauvage. Montaigne avait lu Las Casas et en avait tiré l'enseignement du
relativisme de nos valeurs dites les plus « naturelles » Le Jésuite Lafitau, qui vécut
de 1712 à 1718 chez les Iroquois, décrivit avec force détails, l'organisation sociale
de ces Amérindiens, en particulier l'apparente absence de notion de propriété. Il
comparera les groupes iroquois aux premières sociétés antiques, et en arrivera à une
critique implicite de la société aristocratique de la France du XVIIIe
siècle. Plus tôt, la Hontan avait tiré, de ses rencontres avec les Amérindiens, une
pensée pratiquement libertaire, en exagérant sans doute ce qu'il avait pu tirer de ses
observations qui tiennent plus de la fiction que de l'ethnographie. Rousseau formulera
explicitement les attaques voilées de Lafitau et reprendra, par l'exemple de sociétés
primitives ignorant la propriété, la possibilité de construire une nouvelle société,
avec un homme nouveau, un homme « dédomestiqué ». Nous pensons que Warwick insiste
trop sur les étonnements-émerveillements du père Sagard, devant les mœurs
sexuelles licencieuses en même temps qu'innocentes des Indiens, contradiction insoluble
pour les croyances de l'univers clos du religieux. Il nous apparaît que la
« tradition libertine » auquel Warwick fait allusion n'a pas l'importance qu'il lui
accorde et que l'influence culturelle du coureur de bois - nous le répétons - s'exprime
mieux en termes sociaux qu'en termes moraux. Pour un représentant des classes subalternes
d'Europe, la liberté des mœurs, si impressionnante qu'elle soit, ne peut peser plus
que l'égalitarisme social, dans ce monde sauvage sans aristocrates, gardiens des titres
de propriété, sans commis du seigneur et du roi collecteur d'impôt, sans clergé
menaçant du feu de l'enfer tout contrevenant de l'ordre établi.
L'explication d'un homme nouveau en Nouvelle-France réside certes
dans un espace immense et vide, sans confinement, permettant une grande liberté de
mouvement ; elle se retrouve aussi dans la culture amérindienne. Cette dernière
explication, pourtant plus pertinente, est absente dans l'hypothèse de Turner, et pour
cause. Le pionnier américain n'entre en contact avec l'Indien qu'à la pointe du fusil,
car un « bon Indien est un Indien mort ». Cette différence ou antagonisme entre les
deux univers culturels, pratiquement absent dans l'univers canadien-francais, distingue
déjà l'homme américain de la Frontière du Québécois de la forêt. Importance
fondamentale déjà entrevue mais qu'il nous faut rappeler, d'autant plus que la vie
partagée avec l'Indien et le métissage relativement fréquent ont marqué la culture
québécoise. Cette culture ajoute aux valeurs dominantes orthodoxes, un courant
hétérodoxe, en contradiction apparente, coexistant toujours, à la fois dans la
société et dans le vécu quotidien.
Le courant hétérodoxe a été entretenu par les hommes de la
forêt. En effet, la Nouvelle-France, de l'Acadie au Mississippi et de Québec aux Grands
lacs, est d'abord une immense forêt ; du moins les hommes porteurs de la part nomade ont
tous vécus dans et de la forêt, depuis le trafiquant de fourrure jusqu'à l'ouvreur
d'abattis. La part nomade a été exploitée par la littérature québécoise en moindre
quantité que la part sédentaire (il s'agissait là surtout d'œuvre de propagande),
mais les types créés demeurent dans la conscience populaire comme auréolées du même
mystère que celui de la fotêt d'où ils viennent et où ils retournent le plus souvent.
Le Survenant, une création littéraire, est entré dans le langage courant. Il pourrait
être un homme de chantier ou défricheur, peu importe, il est l'homme que la forêt a
fait naître ou plutôt régénéré, qu'elle a transformé, a ensauvagé, a rendu nomade.
Le défricheur, qu'on nous a tant de fois représenté dans le roman rural québécois
comme le héros stoïque de la colonisation, comme celui qui s'installe, se fixe à la
terre, se
« sédentarise » en devenant cultivateur, appartient fondamentalement à la galerie
nomade et doit être enlevé du portrait de famille agricole. L'agriculture est faite pour
et par le sédentaire. La terre comme l'usine attache l'homme ; le vagabond se détourne
des deux entraves. Il s'enfonce dans le bois ou il erre sur la route et sur le rail. Le
défricheur ne monte pas dans le Nord « faire de la terre ». Sans qu'il le sache, coule
en ses veines le même sang que celui du coureur de bois, son aïeul, et si ce n'est pas
par atavisme qu'il s'attaque à la forêt, c'est que les veillées de sa jeunesse
s'illuminent des histoires et « menteries» sur la vie libre et aventureuse de celui qui
part. Très tôt, dans sa vie, le jeune rural entend exprimer par les anciens, avec la
même foi sinon la même intensité, l'attachement à la terre et l'attirance du départ ;
on lui offre deux modes de vie institutionnalisés dans la culture et non vus comme
antagonistes, qu'on accorde souvent selon les saisons : l'hiver le chantier et l'été la
ferme. C'était faire la part à deux tendances fondamentales qui avaient divisé
autrefois les peuples en nomades et sédentaires et que l'homme québécois pouvait
satisfaire de façon saisonnière.
Il est « monté » au Nord un type d'homme qui avait choisi plutôt
le départ que la domestication des manufactures américaines ou celles des terres plus
sûres... Nous n'affirmons pas que tous ceux qui ont suivi les appels des curés Labelle,
Hébert et Brassard obéissaient davantage à leur goût de la vie sauvage qu'à leur
désir d'installation agricole ; néanmoins nous pensons que beaucoup participaient à
l'esprit nomade, et nous en avons le témoignage. Le Nord permettait d'échapper à la
culture laurentienne et peu s'empressèrent de la recréer au-delà des Laurentides. Nous
pourrions en dire autant des Appalaches québécoises, autre foyer antilaurentien
(contraire à l'esprit sédentaire) où beaucoup sont demeurés colons. Le vocabulaire
technocratique actuel les étiquette comme cultivateurs marginaux. Mais le colon n'est pas
un agriculteur. C'est l'homme des bois qui tire subsistance de l'environnement de façon
hétéroclite et qui agrémente son ordinaire par l'assistance gouvernementale aliénante.
L'État, qu'il soit inca, monarchique occidental, libéral ou soviétique, laisse pas
place au refus domestique. Le Père Alexis saisit bien ce phénomène, même s'il ne
l'explique pas lorsqu'il le constate dans la région outaouaise.
« L'état de pionnier chez certains hommes est une vocation. On les
voit aller toujours de l'avant, enfants perdus de la civilisation. On dirait que le
succès et le bien-être les laissent indifférents. Après dix années d'un travail
acharné, ils vendent pour quelques centaines de piastres leur terre à un fermier plus
aisé, et tout heureux de leur marché, ils s'enfoncent de nouveau dans la forêt pour
recommencer leur rude existence. Telle est la vie du colon. Aucun Européen n'y peut
tenir. Il fera, s'il est sage, comme notre riche fermier, et au lieu de s'établir sur une
terre neuve, il achètera à bon marché un lot déjà ouvert et bâti ».
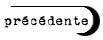  
|