Chapitre 4 (suite)
La régénération
L'ecclésiastique se sert de la dénomination colon employée en
effet plus couramment comme synonyme de défricheur, terme plus savant. Le colon n'est pas
l'habitant. Lorsque le langage populaire du Québec emploie le substantif colon, il le
distingue fort bien de cultivateur (habitant). S'ajoute à ce mot, lorsqu'on l'emploie
familièrement, une connotation quasi péjorative ; le colon signifie alors le rustre,
l'ignare, l'homme sans civilité, à la limite l'homme des bois. Le « sauvage » n'est
pas mort avec la lente assimilation des Amérindiens et la disparition du coureur de
bois...
Pour Arthur Buies, le défricheur, c'est d'abord l'homme seul
ouvrant le chemin de la civilisation. Il insiste à juste titre sur la solitude, sur
l'affrontement avec la
« sauvagerie » qui rend sauvage et qui ne finit jamais, car le goût de la forêt vient
de la vie qu'on partage avec elle. Quand sur le brûlis, lèvent les premières moissons,
le colon n'est pas devenu cultivateur. Il troquera bien vite la terre pour la forêt et
partira sur un autre lot neuf de colonisation ou s'engagera pour la saison d'hiver au camp
de la compagnie forestière. Est-ce davantage le sol ingrat ou un trait psycho-culturel
que seule la littérature paraît avoir pressenti. L'histoire du Québec doit être
révisée, à travers celle du Nord. Il n'est pas question d'invoquer le concept de
mentalité homogène, alors qu'au contraire des gens se sont engagés fermement dans la
réussite par les voies les plus modernes du développement. Nous verrons même combien
étaient attirants pour les tenants de la colonisation du Nord, l'apport des capitaux
étrangers, le chemin de fer, l'industrialisation, etc. Cependant nous continuons de
soutenir que la tradition non orthodoxe que nous avons décrite subsiste, et que le Nord
s'est peuplé d'un fort contingent de colons porteurs de cette tradition. Buies,
rationalisant ce qu'il entrevoit, trace plutôt un portait conventionnel du colon issu du
mythe de la Mission.
« Il faut voir ces forêts s'étendant à perte de vue, au milieu
de pays montagneux, durs, en quelque sorte inhabitable... pour se faire une idée de ce
que c'est que l'homme seul, au milieu de cette immensité... la lutte partout, un combat
continuel contre la nature et pour la nature... la misère prenant chaque jour une figure
nouvelle, et de consolation ni d'appui nulle part, ni d'aucun coté, ni jamais... voilà
ce que c'est la vie du défricheur, de ce colon solitaire, infatigable, héroïque et
inflexible à qui nous devons d'être ce que nous sommes, à qui le Canada tout entier
doit son existence, et cela depuis trois cents ans ».
Arthur Buies ne pouvait renier tout de son passé de pamphlétaire
libertaire. Il reprend le thème de la régénération individuelle incarnée dans le
défricheur, « affranchi des servitudes sociales », homme à la liberté retrouvée,
vivant en contact avec la seule nature qu'il affronte, mais qui le fait vivre et avec
laquelle il noue des rapports autres que sociaux et contractuels. Il n'est pas étonnant
que cet essayiste qui avait vagabondé en Europe, et qui s'était engagé dans l'armée de
Garibaldi en s'opposant aux zouaves pontificaux (l'élite ultramontaine), conserve la
profondeur nostalgie des Parkman, Whitman et Thoreau pour la vie du pionnier maître de
son destin, sans entraves et sans nulle contrainte qu'un espace sans mesure. Pour Parkman,
par exemple, les pionniers sont les vrais aristocrates de la terre, qui ont le front haut,
et non le cultivateur collé à la glèbe comme un parasite. L'historien américain va
jusqu'à voir les paysans de la Nouvelle-Angleterre « presque aussi crasseux, méchants
et stupides que les porcs, qui semblent être leurs animaux favoris ». Ces trois auteurs,
parmi les plus connus de la production littéraire et historique américaine, sont
peut-être les chantres de ce que l'on a appelé le « primitivisme », mais nous
interprétons leur œuvre davantage comme un hymne au coté nomade humain. Ils ont
perpétué un courant qu'on redécouvre maintenant à travers maintes caricatures ou
simplification (hippisme ou autre mouvement de rejet social), mais qui ne s'est jamais
tari dans la littérature américaine. Les vagabonds de l'absolu (Melville, London,
Kerouac) ne sont pas tous pionniers, mais ils refusent la domestication à l'américaine,
et, marqués par le puritanisme enviant transcrit dans leur œuvre, ils rejettent avec
force l'éthique protestante et l'éthique capitaliste qui font si bon ménage dans ce
pays de contradictions. Buies partage cet esprit. Son inspiration est proche de celle des
rebelles américains par la structure de la pensée et l'émotion du style.
Le Nord, avec sa vie sociale plus lâche, entretient sinon ravive
une contradiction. Le clergé rêve d'en faire un château fort de la collectivité qu'il
pourra contrôler en devançant le colon et l'encadrant dans son univers paroissial clos.
Cependant le défricheur s'enfonce toujours plus loin, méprisant les secours de la
société civile et religieuse.
« En face de l'espace et dans la plénitude de sa liberté, l'homme
sent décupler son énergie, son audace, ses moyens d'action et les ressources infinies de
son esprit inventif... Affranchi des servitudes sociales, n'ayant à combattre que des
difficultés et des obstacles naturels, il déploie hardiment toutes ses forces... Il va
droit devant lui, maître du lieu et de l'heure où il devra entrer en lutte avec la
nature insoumise... il n'a aucun secours à attendre, il faut qu'il puise tout en
lui-même... ».
Le père Chapdelaine est un défricheur invétéré. L'ouverture
d'une terre l'intéresse plus que la culture, l'aventure plus que la stabilité. « Faire
de la terre » demeure un projet, une oeuvre jamais achevée, toujours recommencée.
« C'était sa passion à lui : une passion d'homme fait pour le
défrichement plutôt que pour la culture. Cinq fois déjà depuis sa jeunesse il avait
pris une concession, bâti une maison, une étable et une grange, taillé en plein bois un
bien prospère ; et cinq fois il avait vendu ce bien pour s'en aller recommencer plus loin
vers le nord, découragé tout à coup, perdant tout intérêt et toute ardeur une fois le
premier labeur rude fini, dès que les voisins arrivaient nombreux et que le pays
commençait à se peupler et à s'ouvrir ».
François Paradis, le prétendant de Maria, est un coureur de bois
du Nord, de la même race nomade que le père Chapdelaine.
« La mère Chapdelaine reprit ses questions.
- Alors tu as vendu la terre quand ton père est mort, François ?
- Oui, j'ai tout vendu. Je n'ai jamais été bien « bon » de la
terre, vous savez. Travailler dans les chantiers, faire la chasse, gagner un peu d'argent
de temps en temps à servir de guide ou à commercer avec les sauvages, ça, c'est mon
plaisir, mais gratter toujours le même morceau de terre, d'année en année, et rester
là, je n'aurais jamais pu faire ça tout mon « règne » : il m'aurait semblé être
attaché comme un animal à un pieu.
- C'est vrai, il y a des hommes comme cela. Samuel par exemple, et
toi, et encore bien d'autres. On dirait que le bois connaît des magies pour vous faire
venir... ».
Louis Hémon qui a vécu, en observation-participante, tel un
ethnographe, dans une région de colonisation, avait tout loisir d'examiner quelle sorte
d'hommes la Frontière nordique abritait et ce qu'elle permettait chez ceux-là qui,
presque malgré eux, gardaient l'esprit pionnier plus que l'esprit sédentaire. Maria
Chapdelaine : le roman du Nord québécois.
Les missionnaires Mgr Alexandre-Antonin Taché et l'abbé Georges
Dugas, qui ont vécu longtemps dans l'Ouest canadien, au XIXe siècle,
rapportent dans leurs récits des témoignages éloquents sur le nomadisme et
l'ensauvagement des français, partis comme coureurs de bois et comme voyageur. Taché
décrit la formation d'une nouvelle collectivité née des liens entre Amérindiens et
Français : les Métis de la Rivière Rouge. Georges Dugas nous semble bien saisir la
motivation profonde des vagabonds continentaux, les voyageurs de la compagnie du
Nord-Ouest :
« ... d'où venait cet attrait que trouvaient presque tous nos
coureurs des bois à un tel genre de vie ? quel charme les attachait donc à ce pays où
ils avaient à essuyer tant de misères ? comment se fait-il que la plupart d'entre eux
oublièrent le sol natal et ne songèrent plus à revoir le
Canada ?
La seule explication possible de ce goût étrange qui faisait
abandonner si gaiement la vie civilisée pour la vie sauvage, était l'amour d'une
liberté sans contrôle... Bien peu, parmi ces voyageurs du Nord, retournèrent au
pays... ».
Dugas, en fin analyste de la vie nomade des voyageurs, tire toutes
les conséquences culturo-sociales déterminantes selon nous de toute une tradition anti
agricole, parce qu'anti sédentaire. Les coureurs de bois contaminaient l'orthodoxie par
leur esprit frondeur, leur fortune vite faite, leur mépris envers l'autorité. Les
voyageurs poursuivent la même œuvre en menant une vie peut-être moins libre parce
qu'au service des « bourgeois » et commis de la compagnie, mais aussi
« ensauvageante » par le contact avec les Indiens des Plaines, nomades irréductibles.
L'abbé Dugas raconte la vie d'un voyageur qu'il a connu à St-Boniface, Jean-Batiste
Charbonneau : « Sa vie ressemble à celle de tous nos anciens Canadien engagés au
service des compagnies de traite ». L'auteur, en prenant Charbonneau (1797-1883) comme
type, et en confrontant toutes ses observations attentives de missionnaire, résume le
bilan des saisons de voyages, mais son portrait n'engage pas à la condamnation explicite
de Patrice Lacombe, dans La terre paternelle. Mieux, il explique écologiquement le
choix d'un mode de vie abhoré par les ruralistes.
« Nous l'avons dit en commençant, nos voyageurs du Nord n'ont
jamais pu se faire dans la suite à la vie calme des champs. La vie nomade qu'ils avaient
menée pendant leur jeunesse les avait tout à fait dégoûtés des travaux de
l'agriculture... À cette époque la chasse avait beaucoup plus de charmes que les travaux
des champs. La chasse était abondante, et les rivières étaient remplies de poissons. Il
en coûtait beaucoup moins à se procurer les provisions nécessaires à la vie, en se
faisant chasseur qu'en maniant la charrue et la herse » .
Dugas, avec une sympathie latente, trace un tableau pas même
idyllique, mais qui pouvait séduire son lecteur par la narration des avantages de la vie
nomade des Indiens et des Métis. Cette description surprend de la part d'un membre du
clergé. Celui-ci n'en tire aucune preuve de barbarie comme de nombreux missionnaires
l'avaient fait avant lui, et n'engage même pas à éviter ce mode de vie pour son
amoralisme. L'auteur montre ce que des anthropologues viennent de découvrir en le
quantifiant et se débarrassant des jugements de valeur occidentaux : la faible activité
journalière du chasseur-cueilleur pour assurer sa subsistance. La « civilisation du
loisir » existe chez des peuples qu'on avait depuis longtemps dépeints comme obsédés
par la recherche de la nourriture. C'est le second point important de l'influence de
contact avec les Amérindiens ; le premier, comme nous l'avons dit plus haut, c'est
l'égalitarisme de l'organisation sociale.
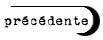  
|