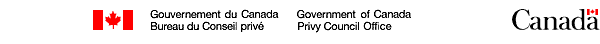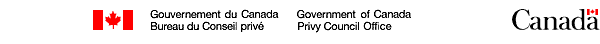|
Le Premier ministre Paul Martin prononce une allocution sur l'avenir de l'interdépendance mondiale au Forum économique mondial
J’aimerais discuter ce matin du besoin d’accroître l’efficacité de la pratique de la politique à l’échelle internationale de sorte que les retombées de l’interdépendance mondiale puissent être reparties plus équitablement.
Janvier 23, 2004
Davos, Suisse
DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
Le texte prononcé fait foi
J’aimerais discuter ce matin du besoin d’accroître l’efficacité de la pratique de la politique à l’échelle internationale de sorte que les retombées de l’interdépendance mondiale puissent être reparties plus équitablement.
À son meilleur, et ce n’est pas toujours le cas, le processus politique national est ouvert et dynamique. Il renferme la capacité de choisir avec discernement entre des priorités et des intérêts concurrentiels, de faire des choix qui montrent la voie à suivre. Les débats et les échanges font partie de ce processus, que ce soit au sein de nos cabinets et de nos corps législatifs, ou dans le cadre de discussions communautaires avec nos citoyens, et ils mènent, bien entendu, à la prise de décisions.
C’est d’ailleurs à la lumière des choix que nous arrêtons comme collectivités politiques que nos valeurs se font le plus explicites. Je tiens à souligner ce point, car lorsqu’on s’intéresse de près à la scène internationale, on se rend compte qu’elle est étonnamment apolitique. Le dialogue entre nations adopte une tournure nettement technocratique et indirecte plutôt que transparente et spontanée. Souvent, il s’articule davantage autour de la sauvegarde d’un processus que de la recherche de l’innovation. Et trop souvent, lors des grandes rencontres internationales, le dialogue suit un scénario préparé à l’avance et se déroule derrière des portes closes – portes qui sont des entraves aux consultations de l’extérieur et qui, malheureusement et de façon quasi générale, restent imperméables aux nouvelles idées.
Comme bon nombre d’entre vous le sait, les échanges les plus fructueux entre leaders ont souvent lieu dans les couloirs, en tête à tête, et ont très peu à voir avec l’ordre du jour officiel de l’événement. Quand les leaders se rencontrent dans les forums internationaux, il leur est difficile d’échapper au syndrome des « documents d’information » pour s’attaquer directement aux problèmes à régler, pour sortir des sentiers battus. Il est devenu pratiquement impossible, dans ces réunions, de consentir à cette espèce d’acte de foi qui, si souvent, s’impose si on veut sortir d’un cul-de-sac intellectuel ou historique.
Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas de progrès. Simplement que le progrès est d’une lenteur tellement pénible. J’estime donc le temps venu d’examiner non seulement les décisions que nous prenons, mais aussi celles que nous ne prenons pas, et de nous poser la question suivante. Pourquoi ne pas avoir pris telle ou telle décision? Permettez-moi de vous donner trois exemples où, me semble-t-il, le débat entre dirigeants politiques doit s’affranchir du scénario prévu, où nos engagements doivent passer de la forme à la substance.
Premièrement, prenons le dilemme créé par l’opposition entre le principe juridique de la souveraineté des États et la reconnaissance, de plus en plus grande, qu’une intervention de l’extérieur peut parfois s’avérer indispensable pour prévenir une catastrophe humanitaire lorsque le gouvernement ne peut ou ne veut pas protéger sa propre population. Si un gouvernement viole toutes les normes associées à ce qu’on appelle une conduite responsable, nous incombe-t-il à nous, en tant que collectivité internationale, de protéger les citoyens dont il a la charge – ou, si on veut, de protéger un peuple contre son propre gouvernement?
Récemment, une Commission d’experts internationaux mandatée par l’ONU a répondu par l’affirmative à cette question et a cerné divers types d’interventions acceptables, par exemple l’imposition de sanctions ou, dans certaines conditions, l’intervention militaire – avec l’approbation de l’autorité compétente.
Au Canada, nous sommes largement d’accord avec Kofi Annan lorsqu’il déclare : « ... ce qui est certain, c’est qu’aucun principe juridique – même pas celui de la souveraineté – ne saurait excuser des crimes contre l’humanité ». Lorsque les circonstances l’exigent, comme ce fut le cas au Rwanda ou au Kosovo, des interventions humanitaires sont justifiables. Nous ne souscrivons pas à la thèse voulant que les États jouissent d’une immunité absolue en vertu du principe de la souveraineté étatique. Cela dit, nous sommes sensibles aux préoccupations exprimées par ceux qui craignent qu’on utilise à mauvais escient le concept de l’intervention.
En fait, il faudrait amorcer un débat libre sur la nécessité d’intervenir dans les cas où sont bafoués les préceptes les plus fondamentaux de notre humanité à tous. Plus précisément, nous avons besoin de principes limpides qui nous aideraient à déterminer quand il convient de recourir à la force pour appuyer des objectifs humanitaires.
Il est vrai qu’il y a eu dissension au sujet de l’Iraq, mais cela ne devrait nullement nous fermer au débat, plus général, qui s’impose. Là où je veux simplement en venir, c’est qu’on ne peut pas laisser aux experts et aux diplomates le soin de mener ce débat : n’oublions pas qu’il soulève les plus profondes questions politiques et morales quant à la nature des États et à nos responsabilités les uns par rapport aux autres. Les experts et les diplomates peuvent, certes, ouvrir la voie, mais à moins que le débat ne soit le fait des dirigeants politiques, il n’avancera pas lieu au rythme voulu et n’arrivera pas à son terme non plus.
Un autre exemple d’acte de foi intellectuel nécessaire – que seul un leadership politique est en mesure d’assurer – provient de l’antagonisme entre les droits de propriété intellectuelle et la nécessité d’offrir, aux pays les plus pauvres de la planète, des médicaments à coût abordable.
Nous ne remettons pas en cause le bien-fondé des droits de propriété intellectuelle : ceux ci favorisent la recherche et l’innovation, encouragent et protègent les investissements et font en sorte que nos scientifiques, nos artistes et nos inventeurs soient équitablement récompensés pour leur dévouement et leur créativité. Mais nous avons aussi une obligation morale à remplir, soit aider, dans la mesure du possible, à soulager ceux qui souffrent. Laisser des gens mourir sous prétexte qu’ils sont sans le sou est injuste, tout simplement injuste, et, par surcroît, cela témoigne d’un manque total de prévoyance.
Où se trouve le juste milieu à cet égard? On s’emploie actuellement à le définir.
Une campagne en cours à l’échelle du globe vise à fournir des médicaments à bon marché contre le VIH/sida. Au Canada, on compte adopter sous peu une loi qui permettra à nos entreprises de fournir aux pays africains, à bas prix, des médicaments génériques anti-VIH/sida.
Bien qu’importantes, ces mesures ne sont qu’intérimaires. Au Canada et dans d’autres pays développés, on a mis en place des régimes qui garantissent l’accessibilité des médicaments à tous ceux qui en ont besoin. Nous pouvons à la fois assurer la protection des droits de propriété intellectuelle et offrir des médicaments à nos concitoyens défavorisés. Les pays en développement n’ont pas les moyens de s’offrir pareils régimes et, à l’heure actuelle, il n’existe à l’échelle planétaire aucun régime susceptible de protéger les droits de propriété intellectuelle tout en mettant les médicaments à la portée des plus pauvres d’entre nous.
La question que l’on doit se poser est la suivante : doit-on relancer le débat à chaque fois qu’apparaissent des maladies ou des besoins inédits? Pourquoi ne pas poursuivre une franche discussion politique dans le but d’arrêter des principes généraux selon lesquels le monde réagirait avec compassion et de façon plus globale aux nouvelles crises en matière de santé?
Autre question que l’on doit se poser : notre humanité s’arrête-t-elle à nos frontières? Bien sûr que non.
Nous devons donc élargir notre conception traditionnelle des responsabilités des États souverains, en ce qui concerne non seulement celles qui incombent aux pays riches face aux pays pauvres, mais encore celles de tous les pays les uns par rapport aux autres.
Ce qui m’amène au troisième type de dilemme qui découle de l’interdépendance moderne – notre gestion du patrimoine mondial, des ressources qui appartiennent ni plus ni moins à l’humanité dans son ensemble. Les pays civilisés ne permettent plus l’exploitation effrénée et non réglementée de leurs propres ressources naturelles; pourquoi, dès lors, ne réagissons-nous pas au pillage des ressources internationales?
La surpêche en haute mer illustre de façon assez effroyable cet état de fait. Au Canada, nous nous sommes déjà livrés à pareille pratique, mais nous avons pris des mesures très sévères pour y mettre un terme. Nous sommes heureux de constater que l’Union européenne a, récemment, ratifié la Convention des Nations Unies sur les stocks de poissons qui chevauchent la zone de 200 milles. Mais on compte toujours des pays – des pays pauvres dans certains cas, mais en particulier certains pays très riches – qui sont loin d’adopter des mesures suffisantes. Il semble bien que les politiques afférentes à la responsabilité s’arrêtent à la frontière des pays intéressés… ce qui n’est plus acceptable dans un monde interdépendant.
La première obligation d’un État souverain doit être envers ses citoyens; c’est l’évidence même. Mais dans un monde interdépendant, il ne saurait s’acquitter convenablement d’une telle obligation qu’en étant partie prenante à l’univers qui déborde de ses propres frontières. En outre, tous les États nourrissent aujourd’hui un intérêt réel et légitime face au bien-être des autres pays, ce qui confère aux dirigeants politiques une obligation particulière – celle de faire en sorte que nos systèmes internationaux concourent au mieux-être de tous.
Cela me ramène à la question que je vous ai posée au début de mon intervention. Quelles sont les institutions et les structures qui permettraient aux dirigeants de se mobiliser à titre de collectivité politique?
Ce qui pose des difficultés aujourd’hui dans de nombreuses organisations internationales, c’est qu’elles n’ont pas été conçues de manière à faciliter la tenue de débats politiques informels comme ceux qui s’imposent. Plus précisément, si les forums internationaux, où sont requises des décisions audacieuses, demeurent axés sur la ratification des résultats de négociations bureaucratiques menées sous un minimum d’impulsion politique, ils risquent de servir de prétexte à l’inaction.
Bref, les séances de photos ne peuvent aucunement se substituer à la volonté politique. Les dirigeants politiques sont appelés à travailler ensemble sur la scène internationale de la même façon dont ils travaillent dans leur pays, lorsqu’ils obtiennent des résultats heureux, c’est-à-dire qu’ils doivent engager des débats, explorer les possibilités et rechercher des solutions fondées sur des valeurs qui favorisent l’inclusion et non la division, qui sont stabilisatrices et non destructrices, pragmatiques plutôt qu’idéologiques.
C’est cette idée qui, dans la foulée de la crise financière qui a secoué l’Asie, nous a incités, nous, Canadiens, à travailler de concert avec les responsables d’autres nations à la création du Groupe des Vingt. Nous envisagions le regroupement officieux de ministres des Finances de toutes les régions du monde représentant des traditions politiques, économiques, culturelles et religieuses des plus différentes. C’est une formule qui a bien fonctionné, car, rassemblés autour d’une table, les ministres des Finances peuvent, entre pairs, exercer des pressions les uns sur les autres pour arracher des décisions sur des points qui autrement resteraient bloqués à tout jamais.
Par exemple, c’est à une réunion des ministres des Finances du G-20 que le Consensus de Washington sur la libéralisation financière a été modifié pour inclure en parallèle le besoin de renforcer les programmes sociaux. C’est ce que l’on appelle désormais le Consensus de Montréal.
Le principal objectif du G-20 consistait à combler le fossé entre le « nous » et le « eux » – fossé qui a sapé les fondements de tant d’instances internationales. Nous avons vu une manifestation de ce phénomène tout récemment, lors de la réunion de l’Organisation mondiale du commerce, à Cancun, en septembre dernier, où le caucus des pays en développement, le G-22, a défié les grands pays développés sur la question de l’agriculture. Les pourparlers ont échoué, ces pays ne faisant valoir qu’une facette du problème.
Mais imaginons un peu ce qui aurait pu se produire si les protagonistes, rigoureusement campés de part et d’autre de cette ligne de fracture agricole, s’étaient assis à la même table et avaient été habitués à discuter et à débattre d’enjeux complexes de manière informelle et à aboutir à la conclusion qui s’imposait. Or, certains diront peut-être que c’est justement ce qui s’est produit, sauf que la conclusion était négative. Sachez que de très rares rencontres par-delà un fossé, ce n’est pas ce que j’envisage.
Si, à l’instar du Canada, vous estimez qu’il est dans l’intérêt de tous qu’on en arrive à un déblocage de ces enjeux délicats, alors nous devons parvenir à réunir le bon groupe de pays autour d’une même table, et surtout à intervalles réguliers, mais dans un cadre non structuré. Il faut procéder à une certaine introspection, à une certaine confrontation des idées; par-dessus tout, nous devons nous demander honnêtement à quoi devraient ressembler nos pays dans 5, 10 ou 20 ans.
Ce ne sera pas possible en regroupant les représentants de 100 pays autour de la table, ni même en formant de petits groupes... si les dirigeants brillent par leur absence.
Il ne conviendrait pas selon moi de reléguer aux oubliettes les leçons du G 20 – leçons qui nous prouvent que, dans des cadres officieux, les représentants de pays aux vues fort différentes peuvent trouver un terrain d’entente et collaborer à la réalisation d’un but commun.
Ce qui m’amène à mon deuxième front d’attaque : un G-20 pourrait aider à orienter le plan d’action, mais il ne saurait remplacer nos institutions internationales. Il nous faut des institutions multilatérales efficaces. Des institutions qui ne soient pas des fins idéologiques en soi, mais des instruments essentiels au bien-être national. Aucune nation ne peut, à elle seule, « contrôler » toutes les incidences de l’interdépendance. Nous pouvons toutefois collaborer avec nos voisins, avec nos amis et alliés, avec nos partenaires régionaux et internationaux. Car une chose est sûre : nous devons impérativement travailler ensemble.
L’Organisation des Nations Unies se trouve au cœur même de ce réseau international; si elle ne fonctionne pas, dites-vous bien que le travail de toutes les capitales nationales sera sérieusement entravé.
Il est vital que l’ONU joue adéquatement son rôle : elle nous rappelle, comme aucune autre institution ne saurait le faire, que toutes les nations défendent des intérêts qui doivent être reconnus, que toutes les nations ont, les unes par rapport aux autres, des responsabilités auxquelles elles ne peuvent se dérober. L’ONU occupe le centre de la vision planétaire – une vision qui, bien qu’affaiblie, mérite toujours d’être défendue; une vision qui veut que ça marche pour tous ou que ça ne marche pas du tout.
Les mandats, structures et procédures de vote du système onusien reflètent en grande partie le paysage géopolitique de l’après-guerre. S’il n’est pas possible de les adapter aux réalités d’aujourd’hui et aux défis de demain, il arrivera de plus en plus qu’on les contourne.
Tout naturellement, la réforme du Conseil de sécurité monopolise les débats, mais il existe maints autres champs d’action auxquels nous devrions également nous intéresser. Par exemple, nous pourrions éliminer en partie le double emploi et nous assurer que les organismes coopèrent les uns avec les autres au bénéfice de leurs États membres plutôt que de se quereller en vue de protéger leurs propres intérêts institutionnels.
Il ne fait aucun doute que d’autres ministres – non seulement les ministres des affaires étrangères – devraient participer plus directement au travail des organismes de l’ONU. Je pense ici au Conseil économique et social (ECOSOC), histoire d’insuffler un peu de réalisme aux délibérations... qui en acquerraient, du même coup, un caractère prioritaire. Et si ces organismes étaient incapables de susciter la participation des ministres, nous devrions y voir un signal indiquant qu’il y a sans doute lieu de repenser de fond en comble leur fonctionnement.
En somme, il faut se demander comment le monde règle les dilemmes politiques qui mettent en concurrence des objectifs par ailleurs valables. Pris individuellement, les enjeux sont de taille. Et l’importance des enjeux va de pair avec celle des valeurs qui les sous-tendent. Envisagées dans leur ensemble plutôt qu’isolément, les décisions que nous sommes appelés à prendre détermineront si tous les progrès réalisés ces dernières décennies profiteront à tout le monde ou si des centaines de millions, voire de milliards de personnes, seront laissées pour compte à jamais.
Si je me suis attardé aujourd’hui au rôle que doivent jouer les leaders, c’est pour faire valoir qu’au niveau national, le leadership politique sert de catalyseur en matière de changement. À titre d’exemple, le changement est invariablement au programme de toute campagne électorale. Un candidat à une charge publique n’oserait jamais dire à ses électeurs : « Je ne m’occuperai pas de votre problème », ou encore, « Mes fonctionnaires prendront un temps fou pour étudier la question », ce qui revient au même. Or, voilà justement ce que beaucoup d’entre nous disons au sujet des enjeux qui débordent nos frontières.
Posons-nous la question suivante : Quel est l’avenir de l’interdépendance mondiale? La réponse réside dans le leadership politique qui sera assuré dans les capitales nationales du monde. Et, parallèlement, je dirais que la réponse réside également dans le leadership dont feront preuve les gens qui se trouvent dans cette salle. Nous avons collectivement une grande capacité d’influer sur le cours des choses. Non seulement ici à Davos, mais dans nos propres pays.
La plupart des gens ici présents ont tiré profit des possibilités économiques créées par l’interdépendance moderne. Nous avons tous intérêt à ce que les systèmes internationaux fonctionnent bien; pour ce qui me concerne, je suis persuadé qu’ils ne donneront leur pleine mesure que s’ils s’adressent à tous les citoyens du monde. Un échec aura de terribles conséquences... et nos enfants et petits-enfants nous le reprocheront à juste titre.
Il s’agit là, sans conteste, du plus grand défi de notre temps. Pour ma part, je demeure, maintenant et à jamais, un optimiste dans l’âme.
Merci beaucoup.

|