Chapitre 2 (suite)
La terre promise
Les Cantons de l'Est seront rapidement considérés comme un
pis-aller, trop
« exposés » par la présence des Anglais, surtout des Loyalistes, ces sur-Anglais
hostiles à la venue des Canadiens français. Le « choix » ne pouvait plus alors que se
fixer dans une seule direction encore libre : le Nord.
On distingue, dans ces deux derniers tiers du XIXe
siècle, trois phases de représentation ou de conception territoriale se suivant dans le
temps mais aussi se chevauchant : la première : l'occupation du sol sans spécification
géographique très précise ; la deuxième : le territoire laurentien comme le territoire
consacré ; la troisième et dernière : le Nord comme Terre promise. Une dérive
géographique s'accomplit que nous avons expliquée plus haut géographiquement et
socialement.
Il était « dans la nature des choses » (A. Buies) que le mythe
ruraliste enfantât un mythe territorial.
Après avoir escaladé la montagne La Repousse, près de
Saint-Faustin, sur le chemin de la Rouge :
« Quelles émotions dut éprouver le Curé Labelle quand au mois
d'octobre 1872, après une ascension difficile dans l'eau et la boue jusqu'aux genoux, il
s'arrêta sur ces hauteurs pour la première fois, et qu'il vit se dérouler devant lui
ces campagnes sans limites. C'était la Terre promise se dévoilant aux regards et aux
aspirations de Moïse... ».
La référence biblique s'affine naturellement en référence
d'histoire religieuse chez quelques-uns, tant est marquée par une conception religieuse
orthodoxe sinon intégriste l'idéologie dominante. La Terre promise est la Terre Sainte
que seuls quelques juifs errants parcourent (entendez la poignée de coureurs de bois
canadiens-français non rebutés par la «sauvagerie » (wilderness) de la
région), mais que la plupart redoutent. La Terre Sainte se conquiert ; on parle beaucoup
plus de conquête du Nord que de marche vers le Nord. Les propagandistes sentaient-ils
obscurément qu'il y avait affrontement, qu'il y avait quasi-bataille et que l'enjeu
était la survie ou la disparition ? L'ennemi n'était pas seulement le froid, la
distance, la montagne, mais encore et toujours l'occupant étranger d'un territoire que
Dieu a réservé et destine au groupe de ses élus qui doivent conquérir ou reconquérir
ce qui leur appartient de droit divin. Une image de l'Anglais-Hérétique, bien que non
formulée implicitement dans le texte suivant, peut être entrevue dans cette perspective
d'une guerre sainte, d'autant plus que l'Anglais est un infidèle à la doctrine romaine
de chrétienté. L'étranger accentue son altérité du fait qu'il partage une religion
différente. D'après Guillaume-Alphonse Nantel, député du comté de Terrebonne :
« La nation entière s'est levée dans une superbe affirmation de
volonté, et elle s'élance à la conquête d'une Terre Sainte dont elle n'a jamais été
tout à fait exilée, mais la routine, l'insouciance, et trop souvent le travail stérile,
dérobaient aux yeux de ses habitants en la représentant comme une terre de désolation
et de ruine. Nous avons eu nos Pierre l'Ermite, un peu partout ; nous avons possédé,
nous surtout, enfants privilégiés du Nord, le plus grand des apôtres de la nouvelle
croisade, le grand curé... Vous avez entendu sa voix les premiers, il vous a dit et
répété un quart de siècle durant : Dieu le veut ! Dieu le veut ! Conquérez la terre,
emparez-vous du sol... ».
Il peut paraître contradictoire que des membres de l'élite «
prêchent » la croisade vers une Terre Sainte « limitée » alors que le continent
était le territoire sans limites de l'expansion. L'espace seul n'est pas en cause, il y a
le nombre. Toute l'histoire de la Nouvelle-France, et Garneau s'en est fait le rapporteur
le plus éclatant, témoigne à la fois de la petitesse du groupe français et de
l'immensité du territoire où s'exerce son expansion. L'anxiété de François-Xavier
Garneau, avant même les troubles de 1837-38 et avant qu'il n'écrive son histoire, s'est
exprimée dans des poèmes que son œuvre historique a fait un peu oublier mais qui
demeurent significatifs de l'état d'esprit de certaines personnes à cette époque. Le
petit nombre, prélude à la disparition inquiète l'historien. L'importance de
l'infrastructure de la Nouvelle-France ne fait pas illusion quand Garneau apprend qu'il ne
reste, en 1831, qu'environ 120 000 Canadiens français dans tout un continent, possession
britannique ou américaine. Un poème, entre autres, projection transparente de
l'inquiétude de Garneau, chante l'agonie du dernier des Hurons en rappelant la dispersion
définitive sinon la disparition complète du groupe huron. A toutes fins utiles, les
Hurons avait cessé d'exister comme groupe distinct en 1643. Le même sort était-il
réservé aux Canadiens français ? La Huronie n'existant plus, il n'y avait que des
Hurons condamnés à disparaître. Ce groupe indigène n'avait pas la forte solidarité et
la cohésion sociale que les juifs, par exemple, avaient développées depuis deux mille
ans. La chanson - Un Canadien errant -,
écrite dans les années 1840, par l'auteur de Jean Rivard, entrée dans le
folklore québécois, témoigne aussi d'un tourment similaire, avec la différence que le
départ est ici forcé. Un autre écrivain, une des plumes les plus originales de la
littérature du XIXe siècle canadien, Arthur Buies, a écrit sur cette
expansion désordonnée, individuelle, ignorante de sa fragilité, des pages inspirées à
la fois par l'imagerie historique de l'idéologie et par la lucidité de l'observateur
social. On reconnaîtra, dans les lignes qui suivent, l'ambiguïté du phénomène
expansionniste expliqué en termes de finalité plus ou moins obscure.
« ... les Canadiens sentent le besoin irrésistible de se répandre
au dehors, d'essaimer au loin, comme tous les peuples aventureux et colonisateurs,
obéissant en cela à l'impulsion qui poussait les aïeux de leur aïeux...
Les Canadiens ne sont pas tous nés pour le défrichement ; il y en
a beaucoup à qui répugne ce travail pénible et ingrat... d'autres, en très grand
nombre, ne peuvent résister à l'esprit d'aventure... mais tous apparaissent comme
possédés du désir instinctif, inconscient pour eux, mais désormais manifeste pour
l'observateur, désir de reconquérir pied à pied, et par la voie de l'expansion
naturelle, tout le terrain qui leur a été enlevé par la conquête, de l'Atlantique aux
Montagnes Rocheuses. C'est pourquoi vous les voyez partout ; ils essaiment et prennent
racine sur les points les plus éloignés, sur les sols les plus différents. Ne cherchez
pas les causes de l'émigration des Canadiens ; elles sont fatales, elles tiennent au
tempérament même de notre peuple. Les Canadiens vont au loin, quand ils ont tout à
accomplir dans leur propre pays, parce que cela est dans le programme de leur destinée
».
En effet, on ne peut parler d'absence de conscience territoriale
chez un peuple qui avait d'abord une conscience à l'échelle de la paroisse. Ce même
peuple est en outre convaincu et encouragé à croire que la paroisse - cette organisation
socio-religieuse et territoriale - pouvait s'implanter, subsister et croître n'importe
où sur le continent nord-américain. Il y avait seulement une inconscience frontalière ;
le Bas-Canada, puis la province de Québec, n'ont jamais suffi à l'errance du migrant. La
tradition du Coureur de bois et du Voyageur était entrée dans la culture vécue et
orale. La Frontière de ces gens n'empruntait pas au mythe prométhéen. L'individualisme
aventurier et vagabond préfigure plutôt l'anti-Prométhée. Malgré quelques pages
semi-laudatives mais plutôt ambiguës de Joseph Charles Taché, la littérature du
terroir est loin de faire l'éloge de celui qui refuse la vie terrienne, seule garante des
valeurs et normes traditionnelles. Le premier véritable roman du terroir, La terre
paternelle (1846), de Patrice Lacombe, trace un portrait bref mais socialement assez
juste, de celui que Buies prenait pour l'héritier d'un atavisme déterminant :
« Après avoir consumé, dans des excursions lointaines, la plus
belle partie de leur jeunesse, pour le misérable salaire de 600 francs par an, ils
revenaient au pays épuisés, vieillis avant le temps, ne rapportant avec eux que des
vices grossiers contractés dans ces pays et incapables, pour la plupart, de cultiver la
terre ou de s'adonner à quelque autre métier sédentaire, profitable pour eux et utile
à leurs concitoyens ». (Patrice Lacombe, La terre paternelle, p.51.)
Le roman de Léo-Paul Desrosiers, Nord-Sud (1931) présente
le dilemme national de ces décennies. Le héros partira-t-il pour la Californie, en 1850,
à l'époque ou les forty-niners cherchent avec fièvre l'or qui les enrichira, ou
bien demeurera-t-il au Bas-Canada, dans sa paroisse, dans son « chez-soi » ? Le thème
de l'œuvre gravite autour d'une conscience nationale hésitante et inquiète, typique
de l'époque. Le héros n'existe véritablement dans le roman qu'en tant que symbole du
dilemme vécu par toute une génération. Vincent Douaire hésitant entre l'amour de sa
fiancé et la liberté de l'aventure symbolise de façon transparente le partage de sa
génération : goût du départ, cher aux coureurs des bois comme aux voyageurs et désir
d'agrandir le patrimoine en défrichant. Mais le héros ne semble pas très conscient
qu'il quitte son pays ; il ne renonce apparemment qu'à un mode de vie alors qu'en fait il
renonce également à sa petite patrie : la paroisse déjà existante ou celle qu'il
aurait pu contribuer à édifier. Autrement dit, et nous reprenons ici notre thèse,
Desrosiers nous présente une conscience nationale floue qui fait ignorer au partant les
frontières. Le choix n'est pas fait comme rejet d'une idéologie mais comme choix d'un
genre de vie. Douaire ne se considère pas comme traître envers un idéal national. Il
n'établit pas de relation dans son esprit entre nationalité et territoire limité. Tous
les Pays d'en Haut, donc quasi tout le continent, constituent le domaine du Canadien
français. Vincent partira pour la Californie, comme des milliers d'autres, ponctuant le
territoire américain de groupuscules francophones.
Si nous pousuivons notre analyse de l'évolution des idées sur
nation et territoire, nous retrouvons l'abbé Laflèche (1866) montrant qu'il existe bien
une nation canadienne-française et que le territoire laurentien lui appartient de droit.
« Ce que nous avons dit sur les conditions essentielles d'une
nationalité et le territoire où elle s'est formée, nous permet d'affirmer sans
hésitation que les Canadiens français en ce pays forment véritablement une nation, et
que l'immense territoire arrosé par le majestueux Saint-Laurent est bien légitimement
leur partie ».
Les rives du Saint-Laurent étaient peuplées, certains diraient
surpeuplées, ce qui, objectivement, s'expliquait beaucoup plus par une technologie
rudimentaire, par un droit de succession particulier, par des méthodes encore primitives
d'utilisation des ressources et par une agriculture fermée sur la communauté, que par la
démographie. Les Cantons de l'Est, région entrevue la première par les éventuels
colons, en décourageaient beaucoup par son manque de communication et par les immenses
terres aux mains de propriétaires étrangers absentéistes. Beaucoup d'émigrants vers
les États-Unis partiront de ces Cantons, chassés par un individu brandissant des titres
de propriété, ou trop isolés dans une forêt à peine entamée par de mauvais chemins.
Dans une brochure publiée « par ordre du Gouvernement de la Province de Québec »,
l'abbé Chartier, célèbre agent d'Immigration et de Colonisation, qui prêchait, lui, le
retour des expatriés, vante cette région dans des termes qui ne ressemblent pas à ceux
que les «écrivants » du Nord emploieront. Que le Gouvernement du Québec ait cru bon de
faire publier une plaquette de propagande où est clairement identifié le
mal : l'émigration aux États-Unis et le remède : la colonisation dans les Cantons de
l'Est, montre bien que le Nord était encore loin d'être perçu comme une Terre promise.
L'abbé Chartier n'est d'ailleurs pas tendre pour les promoteurs de
l'expansionnisme pan-étasunien.
« Que l'émigration des Canadiens aux États-Unis soit déplorable,
tout le monde en convient. Il n'y aurait que les traîtres à leur patrie pourraient se
réjouir d'une cause si certaine de notre décadence, et ces traîtres, s'ils existent,
sont en très petit nombre... Ce n'est pas ici une question de parti politique, c'est une
question de vie ou de mort pour la race canadienne française... C'est en opposant une
digue efficace à ce flot destructeur que nous éviterons l'abîme dans lequel il nous
entraîne d'une manière évidente ».
Mais le prêtre-colonisateur admet que la colonisation n'est qu'un
remède à un mal, lui-même provoqué « par certains défauts, certains vices de la vie
pratique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, qui semblent nous être particuliers, à
nous Canadiens français ». Chartier cherche la cause profonde de l'émigration qu'il
identifie avec la
« gêne ». « C'est le désir d'améliorer son sort qui éloigne le Canadien de la
patrie de ses ancêtres ».
L'auteur ne s'attendrit pas sur le comportement du cultivateur
oublieux des leçons de sagesse et de modestie que les ancêtres simples et glorieux lui
ont transmis par leur exemple. De nouvelles valeurs s'infiltrent dans les campagnes et nul
n'en est exempt. La pauvreté vraie a remplacé la vie sobre mais digne d'autrefois. Elle
pousse même à l'exil et accentue encore, par là, le mal qui ronge les campagnes.
L'abbé Chartier reconnaît l'existence d'une émigration de pauvreté, et il essaie
d'identifier les causes de celle-ci afin d'organiser la prévention de cette maladie
sociale que constitue la pauvreté.
« Donc, puisque c'est le manque de moyens qui force le Canadien à
émigrer, voyons en peu de mots quelles sont les causes de pauvreté parmi nous ». Et
l'auteur présente en quelques pages, dans l'ordre : le luxe, l'usure, le manque d'espace
dans les vieilles paroisses, l'ivrognerie, la honte du travail, le manque de calcul.
La lecture des brochures consacrées à la colonisation du lac
Saint-Jean ou de la Gaspésie offre les mêmes considérations prosaïques où le lyrisme
abonde dans les paragraphes consacrés aux travaux de la terre. On retrouve les mêmes
termes touchants, les mêmes effusions pour la vie des champs et l'héroïsme du
défricheur, avec des descriptions sans apprêt sur le territoire, dans le style des
rapports d'arpenteur accumulant les traits positifs du climat, des sols et de la
végétation. De l'opuscule Le Saguenay en 1851, à La colonisation dans les
Cantons de l'Est (1871), c'est-à-dire vingt ans de production de propagande
colonisatrice, la même constante stylistique s'appliquera à tous les textes ; point de
référence mythique si ce n'est, parfois, une allusion aux valeurs « patriotiques » de
la colonisation et au défrichement vu comme une mystique, c'est-à-dire dans l'ordre
d'une œuvre sacrée. Mieux, si l'on analyse les ouvrages d'Arthur Buies sur la
colonisation, et qu'on les étudie du point de vue thématique, il n'est que de comparer,
par exemple, l'Outaouais supérieur (1889) à La vallée de la Matépédia
(1896) et l'on retrouvera à peu près la même structure dans ce dernier volume que dans
ceux cités plus haut, alors que l'Outaouais supérieur appartient, par la
rhétorique qui s'y trouve, à la littérature mythique du Nord. Il faut ajouter à ce
livre un autre dans la même veine mythique, et effectivement situé dans ce Nord lointain
: Le Saguenay et la vallée du lac Saint-Jean (1880). On peut en dire autant de
l'œuvre d'un autre publiciste, Jean-Chrysostôme Langelier, qui, bien que sans un
style tout à fait différent de celui de Buies, c'est-à-dire dans le style d'un
compilateur , d'un rapporteur-fonctionnaire, se laisse aller dans Le Nord (1882),
à quelque débordement lyrique, absent dans La Gaspésie (1884).
La recherche d'une sécurité collective, après la stratégie
adoptée de l'occupation du sol et de la possession d'un territoire national, se
renforçait par la reconnaissance (au sens étymologique) d'un territoire réservé, d'une
terre promise : le Nord. De l'idée de propriété du sol, on arrivait à celle d'un sol
consacré. Notre esquisse de l'émergence du mythe de la terre promise a laissé de côté
une influence étrangère qui explique beaucoup et que nous étudierons dans un chapitre
suivant. Pourtant, dans la continuité de pensée des idéologues indigènes, cet apport
fit faire un bond en avant à cette pensée territoriale qu'une imagerie séculaire
inhibait. De nouvelles conditions socio-économiques étrangères et québécoises en
multiplièrent l'effet, en même temps qu'elles en expliquaient en partie la naissance.
Analyser le mythe de la Terre promise, c'est retrouver deux
cheminements stratégiques, deux visions du monde coexistant parallèlement. D'un côté,
un expansionnisme sans limites, gage de vitalité, de l'autre, un rétrécissement
territorial, gage de conservation. Il ne faut pas perdre de vue ce mouvement qui va de
l'un à l'autre à la même époque, parfois intériorisé par le même idéologue se
représentant la migration comme un mouvement de diastole-systole naturel. La
collectivité est vue analogiquement comme un organisme vivant qui doit à la fois se
fortifier et s'étendre. La Terre promise doit être entendue comme la dialectique entre
le désir du repli sur soi et le désir de l'expansion, message transmis par le mythe de
la Mission providentielle mais que certains limiteront. Les tenants des deux stratégies
emprunteront à la Terre promise sa symbolique, d'où la confusion entre les deux
conceptions si l'on s'en tient à la seule imagerie, le même mythe, devant servir une
même finalité, la survivance de la collectivité, mais par des voies différentes. Chez
tous les constructeurs de mythe, une même nostalgie profonde du continent perdu qui
teinte le discours idéologique le plus subtil et le plus simplificateur. La Terre promise
peut être vue comme la juste réponse divine au continent perdu.
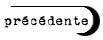 
|