La régénération
« Ceux qui sont venus depuis s'établir au Nord-Ouest, se sont
étonnés de ce que les Métis avaient dédaigné si longtemps l'agriculture, préférant
la vie de chasseur à celle de fermier.
Cependant, il n'y a rien là d'étonnant. Pour peu qu'on
réfléchisse, la chose s'explique bien naturellement.
Les prairies, il y a cinquante ans, étaient couvertes de troupeaux
de buffalos. Quelques semaines passées à la poursuite de ces animaux suffisaient pour
faire une ample provision de viande, qui, jointe au poisson pris dans les rivières,
fournissaient à l'entretien des familles pendant la plus grande partie de l'année. Puis
cette chasse était plutôt une excursion de plaisir qu'un voyage de fatigue. Pour les
anciens voyageurs et pour les Métis, la vie dans la tente, au milieu des prairies, avait
un charme indicible.
Au printemps, dès que la neige avait disparue et que l'herbe
commençait à tapisser les plaines, ces bandes de chasseurs, armés de leurs fusils et
montés sur de fringants coursiers partaient par troupes de deux à trois cents, gais et
insouciants de l'avenir comme s'ils avaient eu l'assurance de ne jamais plus manquer de
rien.
Dès qu'ils arrivaient sur les traces des buffalos, ils plantaient
leur tente, où ils installaient les femmes et les enfants qui les avaient suivis ; puis,
sous les ordres d'un chef, élu pour la saison, les cavaliers donnaient la chasse aux
animaux.
Une course durait environ vingt minutes, pendant laquelle un bon
cavalier abattait une dizaine de bœufs qu'on se hâtait de dépecer sur-le-champ. Une
fois ce travail fini, les hommes passaient leur temps à causer, étendus sur l'herbe de
la prairie, ou faisaient des paris pour des courses à cheval. La saison s'écoulait
ainsi, et vers la fin de l'été la caravane revenait avec des charrettes chargées de
viande pour l'hiver. Pendant l'automne on faisait la pêche au poisson blanc dans les lacs
et les rivières. Quelquefois la pêche manquait ou la chasse ne répondait pas aux
espérances conçues ; mais les fermiers non plus ne peuvent pas toujours compter sur une
moisson abondante : les années de disette, alternent avec les années de fertilité. Il
n'y a donc rien d'étonnant si, avec une telle facilité de se procurer de la nourriture,
les Métis n'aient que de l'indifférence pour l'agriculture ».
L'abbé Laflèche, qui lui aussi avait été missionnaire dans
l'Ouest, ne rapportera pas le même enseignement de son séjour. Il en puisera plutôt un
désir d'ordre chrétien et d'affermissement de la collectivité par les valeurs
terriennes et l'expansionnisme missionnaire et territorial. Les Pays d'en Haut ou le Nord
n'inspirent donc pas uniquement les littérateurs. L'idéologie dominante a été en
partie fabriquée pour contraindre un esprit que Laflèche et d'autres considéraient
comme nocif et subversif.
L'émigration vers les villes de la Nouvelle-Angleterre s'explique
aussi par la culture de mobilité. Nous reprenons à notre compte la conclusion des
considérations de l'abbé Magnan sur les causes du départ. Aux impératifs
socio-économiques, il faut ajouter les impératifs psycho-culturels tout aussi
déterminants.
« L'auteur qui a vécu au milieu des Franco-Américains longtemps
et interrogé des chefs de familles émigrées et fait, de la sorte, une enquête sur
place, le problème n'est pas, ou ne semble pas très compliqué. Il se résume tout
simplement dans une question d'intérêt.
Parmi les émigrants canadiens, il en est qui ont fui la misère, la
pauvreté ou, du moins, la gêne. C'est le petit nombre. D'autres, ils sont légions, ont
recherché, en s'expatriant, un champ d'action plus avantageux, des salaires élevés, un
milieu qui s'adaptât davantage à leur activité ou à leurs talents. Nous en avons
trouvé plusieurs qui ont émigrés à cause de l'attrait qu'offrait à leurs yeux un pays
étranger et, par conséquent, pour le simple plaisir de voir de nouveaux horizons.
D'ailleurs, il pourrait se faire que cette migration de notre race fût, en grande partie,
la conséquence de cette soif de l'inconnu, de ce besoin d'aventures et d'imprévu qui
sommeille plus ou moins chez les descendants des pionniers de l'Amérique du Nord ».
L'ambiguïté, sinon la contradiction, remplit les messages sur la
Régénération, qui souvent en un éventail qui va du ton libertaire et naturaliste de
Buies au ton conservateur et édifiant de Montigny. Mais Buies doit être interprété
plus comme un descendant des Radisson, Dulhut et des autres voyageurs, que comme un
croisé ultramontain. S'il embrasse la cause colonisatrice, c 'est qu'il croit que le
peuple québécois doit d'abord poursuivre son expansion, repousser les frontières de
l'oecoumène, puis se développer comme tout pays moderne, tels les États-Unis, par
exemple, qui misent sur le progrès et qui y réussissent si bien. Nous en reparlerons
plus loin. Buies ne s'est pas converti au ruralisme officiel. Il est étonnant que
l'œuvre de Buies n'ait pas été étudiée dans la perspective que nous découvrons
dans nos analyses. Le Nord et les mythes afférents tiennent une place évidente dans ses
livres de colonisation. Buies se régénérait à travers l'œuvre de propagande ; il
compensait par l'écriture et poursuivait par la plume un nomadisme latent qu'il avait
vécu pleinement dans sa jeunesse bohème et que l'establishment clérical avait
brisé. La seconde phase de sa carrière ne doit pas faire illusion. Sa rencontre avec le
curé Labelle à la fin de la décennie 1870 lui assura une certaine respectabilité. Mgr
Bourget avait été une de ses cibles favorites et même le pape dans sa revue La
Lanterne (1868-1869). Le curé Labelle deviendra son héros. Il se pliera aux
exigences sociales les plus élémentaires, prendra femme en 1887, et se conformera aux
directives les plus engageantes de l'idéologie, mais la débordant aux deux extrêmes. Il
valorise, en effet, le développement à l'américaine et conserve une nostalgie profonde
pour d'homme libre de la nature, primitivisme mal étouffé qui sourd dans maintes pages.
« C'est un milieu dans lequel tous les besoins factices
disparaissent et où la santé compromise s'empresse de se refaire... Ils sont une race
admirable, d'un courage et d'une persistance unique. Placés pour ainsi dire au sein de la
nature... ils y apprennent les secrets de l'hygiène et de la conservation de la vie, et,
sous ce rapport, ils peuvent en remontrer à bien des gens de la ville.
Warwick n'a pas su exploiter la trame nordique et le fil nomade de
l'œuvre de Buies. Il cite cet auteur une seule fois alors que cette œuvre a une
valeur exemplaire et représente, pour nous, la contradiction de l'idéologie tout autant
que sa pleine manifestation. Buies aurait pu être ce Whitman qui chantait dans des
stances sans fin, le rail, le pionnier (l'homme véritable) et l'expansionnisme
américain. Après sa période d' «autocritique», Buies ne put avoir que des
velléités d'écrivain libre.
Montigny ne se chauffe pas au même bois que le pamphlétaire.
Chevalier de Pie IX, ancien zouave pontifical, ultramontain achevé, adepte fervent du
ruralisme, s'il parle de la régénération, c'est par opposition à la ville, certes,
mais par-dessus tout à la ville mangeuse d'âmes, à la ville et à l'usine qui
éveillent les consciences de classe par la division du travail et l'exploitation
apparente de l'homme. Pour la paix sociale et l'harmonie retrouvée, le retour aux champs
régénérateurs éliminera les tensions sociales et morales.
« Arrivez donc ici, vous qui êtes ployés sous le poids des
plaisirs et qui êtes ridés des veilles de la dissipation ! Venez sous ce dôme rustique,
vous que les affaires font blanchir, et reposer du ballottement de la vie dans cette oasis
où l'âme est à l'abri des exigences sociales et des grandes passions du cœur.
Venez prendre une leçon des secrets du bonheur.
Il ne faut pas voir une critique ironique de Montigny dans notre
analyse, mais il nous faut partager les deux tendances de cette Régénération, et
montrer qu'elles originent de systèmes de valeurs différents. Buies toujours attiré par
un modèle anticontrainte et Montigny rêvant d'un Nord reproduisant le système du Sud
mais en éliminant les éléments corrupteurs qui s'y introduisent.
« La Colonisation ! c'est l'une des plus importantes questions
sociales. Que dis-je, une question ? C'est une solution, qui offre un remède effectif à
notre mal social. En effet, de quoi notre peuple des villes surtout souffre-t-il ? Au
moral, il est exposé, quand même sa robuste foi ne lui fait pas entièrement défaut,
aux vices qui naissent du manque du travail, ou bien du travail énervant des manufactures
et des grandes agglomérations... ».
L'abbé Jean-Baptiste Proulx partage l'idéologie de Montigny où
l'éthique catholique sert de fondement aux valeurs sociales. Pour lui, la Régénération
ne s'entend que dans le sens biblique. On se régénère par le travail en respectant la
malédiction divine, et le travail le plus régénérateur parce que le plus sain, le plus
près de la nature, œuvre de Dieu, c'est le travail de la terre. Proulx rejoint
Laflèche et les ruralistes dans son appel. Lui et les autres « mythoplastes » nordiques
régionalisent l'idéologie.
« Obligé de travailler à la sueur de son front, il n'a pas le
temps ni l'occasion de chercher ces plaisirs qui ruinent la santé, amollissent les
constitutions, tandis qu'un exercice rude et continu forme ces natures mâles et
vigoureuses qui assurent la force et la prépondérance aux peuples adonnés aux travaux
des champs ; de là l'axiome : « C'est aux peuples du Nord qu'appartient l'avenir ».
Mais les deux tendances contradictoires, qui se sont toujours
côtoyées dans l'histoire canadienne-francaise, fusionnent sous la même notion mythique.
De toute façon, les constructeurs du mythe nordique visent à établir le plus possible
de nationaux dans une région nouvelle, et, assurés que leur groupe doit choisir d'abord
entre l'assimilation et la survivance, ils s'entendent pour privilégier une frange
pionnière que la collectivité ouvrira seule. Elle s'y régénérera dans la mesure où
elle évitera les compromissions du travail pour l'étranger, et le voisinage dangereux
avec l'élément anglo-protestant avide de profit. L'Anglo-saxon, détenant le capital et
le monopole des affaires, impose son système de normes et de valeurs à une nation
franco-catholique objectivement et subjectivement dans une ère préindustrielle, d'où
veulent la faire pourtant sortir quelques esprits progressistes et hommes d'affaires
autochtones. Le ruralisme a su prôner et maintenant si décrié ne débouchait pas
seulement sur le seul agriculturisme ; plutôt que refus catégorique, il était davantage
rationalisation de l'échec de la bourgeoisie à entrer dans le monde des affaires
continental dominé par le capital étrangèr. Le Nord, en particulier, n'a pas véhiculé
que des idées de mise en valeur agricole. Notre conclusion reprendra cette remarque.
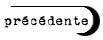 
|