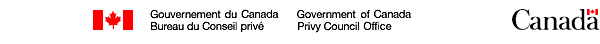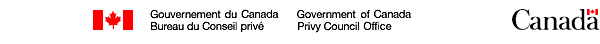|
« MAINTENIR L'UNITÉ NATIONALE DANS
UN CONTEXTE PLURI-NATIONAL »
NOTES POUR UNE
ALLOCUTION À
LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
LONDRES
LE 19 MAI 1998
Indira Gandhi, qui parlait en connaissance de cause avec son pays fait de trois
ethnies principales, six grandes religions et 24 groupes linguistiques
importants, a déclaré voir dans le Canada la preuve «que non seulement la
diversité enrichit mais qu'elle peut être une force». J'espère que le Canada
va effectivement se montrer à la hauteur de cet idéal de tolérance et de
respect pour la diversité. Et j'ai l'impression qu'une École qui a reçu des
étudiants de tous les horizons et de tous les milieux, de John F. Kennedy à
Mick Jagger, doit être le bon endroit pour parler de diversité! Qu'une École
dans laquelle ont enseigné Harold Laski et Friedrich Hayek doit bien savoir ce
qu'est le pluralisme! Qu'une École qui a contribué à former le champion de
l'unité canadienne et ancien Premier ministre du Canada, Pierre Elliott
Trudeau, et le séparatiste historique et ancien premier ministre du Québec,
Jacques Parizeau, a quelque chose d'intrinsèquement canadien!
Je vais donc vous parler d'unité canadienne. À
l'invitation du Premier ministre Jean Chrétien, j'ai fait mon entrée au
Cabinet fédéral le 25 janvier 1996, sans expérience politique directe, mais
poussé par mes convictions sur l'unité canadienne. Le Premier ministre m'a
nommé ministre des Affaires intergouvernementales. À ce titre, j'ai le mandat
de conseiller le gouvernement pour tout ce qui touche le fonctionnement,
l'amélioration et le maintien de la fédération canadienne.
Alors 1) pourquoi l'unité canadienne et 2)
comment la garantir. Voilà mes deux sujets d'aujourd'hui. De ces deux sujets
découleront, je pense, les raisons pour lesquelles je suis très confiant quant
à l'unité de mon pays.
1. Pourquoi l'unité canadienne?
Le Canada, ce pays que Indira Gandhi et bien
d'autres ont vu comme un modèle d'ouverture, de tolérance, admiré pour sa
capacité de réunir des populations différentes, ce Canada est la seule
démocratie bien établie qui fait face depuis une trentaine d'années
maintenant, à un danger de sécession.
Il est facile de deviner ce que serait la
réaction dans le monde si le Canada devait se briser. De cette fédération
défunte, il serait dit qu'elle est morte d'une surdose de décentralisation, de
tolérance, de démocratie en somme : «Ne soyez pas aussi tolérants,
décentralisés, ouverts que l'a été le Canada, car votre minorité ou vos
minorités vont se retourner contre vous, menacer l'unité de votre pays, sinon
le détruire». Voilà ce qui se dirait.
N'est-ce pas ce que l'on a entendu de certains
partisans du «Non» lors de vos récents référendums : «N'accordez pas des
parlements à l'Écosse ni au Pays de Galles, sinon vous allez créer des «Québec»
en Grande-Bretagne».
Et au Congrès américain, récemment, quand on a
envisagé d'offrir à Porto Rico la possibilité de devenir un État américain,
on a entendu des représentants s'opposer à l'idée de créer un «Québec»
aux États-Unis.
Je me suis lancé en politique justement parce
que je veux entendre le contraire, je veux que partout dans le monde, l'on
répète : «Nous pouvons être confiants envers nos minorités, leur permettre
de s'épanouir à leur façon, car ainsi elles renforceront notre pays,
exactement comme le Québec renforce le Canada».
Les Canadiens sont des gens modestes qui ne
soupçonnent pas à quel point le débat sur l'unité de leur pays a une portée
universelle. Si un pays béni des dieux comme le Canada échoue à maintenir son
unité, alors les Canadiens auront envoyé un mauvais message au reste du monde
en cette fin de siècle.
En fait, les Canadiens sont en train de débattre
de ce qui pourrait être le principal enjeu du prochain siècle : comment faire
cohabiter dans un même pays des populations différentes. Il est vrai que les
Canadiens en discutent calmement et pacifiquement. Ailleurs, ça se passe
souvent mal.
Depuis la fin de la guerre froide, le nombre de
conflits au sein des États a dépassé de beaucoup le nombre de conflits entre
États, a calculé une commission de la Carnegie Corporation, qui a dénombré
233 minorités ethniques ou religieuses qui réclament une amélioration de
leurs droits légaux et politiques.
Le professeur Daniel Elazar, de l'Université
Temple, à Philadelphie, a dénombré quelque 3 000 groupes humains dans le
monde se reconnaissant une identité collective. Or, il n'y a même pas 200
États à l'ONU. À chaque peuple son État est une idée impraticable qui
ferait exploser la planète. Comme l'a déclaré l'ancien secrétaire des
Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali : «Il reste que si chacun des groupes
ethniques, religieux ou linguistiques prétendait au statut d'État la
fragmentation ne connaîtrait plus de limite, et la paix, la sécurité et le
progrès économique pour tous deviendraient toujours plus difficiles à assurer».
La séparation des peuples est non seulement
impraticable, mais elle est souvent une erreur morale. En démocratie, elle
m'apparaît très difficile à justifier. La démocratie nous demande d'être
solidaires de tous nos concitoyens; la sécession nous oblige à les choisir. On
en garde certains, on en laisse tomber d'autres, selon des critères qui seront
immanquablement ethniques, religieux ou linguistiques.
La démocratie nous invite plutôt à aider nos
concitoyens qui sont différents de nous, à accepter leur aide et à voir, dans
notre cohabitation parfois difficile, l'apprentissage d'une citoyenneté plus
complète, plus proche des valeurs universelles.
C'est un fait qu'on ne connaît pas de régions
riches d'un État démocratique qui aient laissé tomber leurs régions pauvres.
Les séparatistes de l'Italie du Nord perdent leur temps. Ou je me trompe fort,
ou jamais ils ne parviendront à briser la solidarité qui unit les Italiens.
Il doit en aller de même entre concitoyens de
langues différentes ou aux références culturelles différentes. L'idée-force
qui devrait les convaincre de rester ensemble est celle des identités
plurielles.
J'ai la chance d'être Québécois et je suis en
même temps très fier et heureux d'être Canadien. Je sais qu'une personne de
Calgary ou de Vancouver sera assez différente de moi sur le plan culturel et il
y a même peu de chances qu'elle parle ma langue. Mais je sais aussi que notre
vie en commun est un apprentissage de la citoyenneté, parfois difficile, qui
fait la vraie grandeur du Canada.
Maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis
très confiant quant à l'unité de mon pays. C'est que, très clairement, les
Québécois, et cela se confirme sondage après sondage, se sentent aussi
Canadiens. À peine 20 % à 25 % d'entre eux ne se reconnaissent plus
d'identité canadienne. J'avoue que si c'était l'inverse, si 75 % à 80 % des
Québécois ne voulaient plus être Canadiens, je serais inquiet.
Il faut ainsi promouvoir les identités
plurielles. Que chaque Québécois puisse dire : «Je suis Québécois et
Canadien, et je refuse de choisir entre les deux».
2. Comment garantir l'unité canadienne
Pour maintenir l'unité nationale dans un
contexte pluri-national, il est deux fausses solutions qui me paraissent vouées
à l'échec, de façon certaine, au Canada : l'assimilation et l'inclusion
forcée. La solution m'apparaît plutôt résider dans cet équilibre à
maintenir entre la primauté des droits individuels et la reconnaissance des
réalités collectives, entre l'intégration et l'autonomie.
L'assimilation a été activement recherchée par
les esprits libéraux du XIXe siècle partout en Occident, notamment au moyen de
l'instruction populaire conçue comme un moule unique. Ils y voyaient la
condition pour assurer l'égalité des chances entre individus. Lord Durham, le
gouverneur que la Couronne britannique avait envoyé au Bas-Canada après les
rébellions de 1837-1838, et qui, comme solution, avait recommandé
l'assimilation rapide des Canadiens-français, était un progressiste en Grande-Bretagne,
partisan de l'éducation populaire, du droit de vote et de la réforme agraire
pour les petits paysans, à tel point qu'on l'avait surnommé «Radical Jack».
Il estimait qu'être Français en France c'était très bien, mais que les
Canadiens-français, eux, dans le contexte anglo-saxon, allaient être
injustement pénalisés, entravés dans leur développement, si on ne les
assimilait pas.
De l'assimilation, il y en a eu et il y en a
encore au Canada, mais dans l'ensemble elle a échoué. Les francophones et les
anglophones ont dû apprendre à se tolérer d'abord, à mieux se respecter
ensuite, puis à s'entraider. Cet apprentissage difficile, chargé de pages
sombres, les a mieux disposés à accueillir de nouveaux citoyens venus de tous
les continents.
Considérons maintenant l'inclusion forcée,
c'est-à-dire l'interdiction de la sécession. Plusieurs États démocratiques
interdisent la sécession dans leur Constitution, explicitement ou implicitement.
Ils estiment que chaque parcelle du territoire national appartient à tous les
citoyens du pays et que celui-ci ne saurait donc être divisé.
C'est là un principe qui se défend, mais on
doit quand même se demander s'il est possible pour un État démocratique de
retenir contre sa volonté une population concentrée sur une partie de son
territoire et qui voudrait très clairement le quitter.
Au Canada, nous estimons que notre pays ne serait
pas le même s'il ne reposait pas sur l'adhésion volontaire de toutes ses
composantes. Il n'est pas une seule force politique au Canada qui propose de
retenir les Québécois dans le Canada contre leur volonté clairement exprimée.
Le gouvernement du Canada estime cependant de son devoir de s'assurer que jamais
une sécession ne pourrait être effectuée sans l'assurance que c'est très
clairement ce que souhaite la population. Il a demandé à la Cour suprême de
préciser si le gouvernement indépendantiste actuellement au pouvoir au Québec
a le droit de faire unilatéralement l'indépendance. Le gouvernement du Canada
pense que cette prétention du gouvernement du Québec est sans fondement
juridique, et certainement sans fondement moral.
Une autre fausse solution m'apparaît être celle
que j'appellerais le «séparatisme intérieur», soit cette attitude qui
consiste à céder aux séparatistes tout ce qu'ils souhaitent à l'intérieur
du pays, en espérant qu'ils perdent l'intérêt de faire la séparation. Pour
le Canada, une fédération déjà très décentralisée, cela voudrait dire
donner peu à peu, au gouvernement du Québec, à peu près toutes les
responsabilités publiques. Ainsi, espère-t-on, la vaste majorité des
Québécois pourraient se satisfaire de cette large autonomie et les
séparatistes durs et purs seraient marginalisés.
Ce serait une erreur que de suivre une telle
stratégie, selon moi. Chaque nouvelle concession faite pour calmer les
séparatistes conduirait les Québécois à se retrancher toujours davantage sur
leur territoire, à se définir par un «nous» exclusif, à ne plus voir que de
loin les autres Canadiens et à rejeter le gouvernement canadien, les
institutions communes canadiennes, comme une menace à leur nation, un corps
étranger. Ce n'est pas là la bonne façon de promouvoir les identités
plurielles.
En plus, toutes ces concessions faites à une
province attiseraient la jalousie des autres provinces, qui demanderaient pour
elles les mêmes pouvoirs, ce qui pourrait mener, dans les faits, à une sorte
de balkanisation. Mais si le gouvernement fédéral refusait d'accorder aux
autres provinces les mêmes pouvoirs qu'au Québec, il risquerait de susciter un
ressac profond.
Le «séparatisme intérieur» est une stratégie
vouée à l'échec : elle ne peut faire fonctionner un pays dans l'unité. Il
est certain qu'un groupe humain concentré sur un territoire, qui se perçoit
une identité collective, comme peuple ou comme nation, doit avoir une
autonomie, des institutions dans lesquelles il se retrouve. Mais en même temps,
si l'on veut que la notion d'identités plurielles ait un sens, il faut que ces
citoyens se sentent aussi membres du pays en son entier. Il faut qu'ils se
sentent solidaires des autres citoyens, en complémentarité avec eux. Ils
doivent jouer leur rôle dans les institutions communes. Il faut les inviter à
voir la vie en société autrement qu'à travers la seule grille de leur
nationalisme.
Cet équilibre à maintenir entre l'autonomie au
sein d'un pays, d'une part, et la solidarité avec l'ensemble du pays, d'autre
part, nous l'avons perdu pendant un temps, au Canada, et nous l'avons perdu à
propos de ce qui est peut-être la question la plus délicate dans toute cette
affaire : celle de l'identité. À la suite de différentes rondes
constitutionnelles, une proposition a été mise sur la table qui visait à
reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution
canadienne. Cette proposition a été rejetée en juin 1990, une proportion
importante des Canadiens anglophones y voyant une source de privilèges qui
avantageraient les Québécois au sein de la fédération.
Mais de nombreux Québécois ont vécu cet échec
constitutionnel comme un rejet de leur identité et de leur culture. L'option
indépendantiste a alors connu une embellie sans précédent. Les leaders des
Québécois favorables à l'unité canadienne ont voulu contrer cette montée
séparatiste en exigeant du reste du pays un transfert massif de pouvoirs du
gouvernement fédéral vers le gouvernement du Québec. Ce transfert n'ayant pas
été consenti, c'est frustrés et déçus que de nombreux Québécois sont
allés voter au référendum du 30 octobre 1995. Tout près de la moitié (49,4
%) ont voté OUI à la souveraineté du Québec, sur une question ambiguë, le
vote séparatiste ayant été artificiellement gonflé par un vote de
protestation. Les sondages ont en effet démontré que de nombreux électeurs du
OUI espéraient par leur vote améliorer la place du Québec au sein du Canada.
Aujourd'hui, deux ans et demi plus tard, les
sondages indiquent que, avec la même question ambiguë du 30 octobre 1995,
l'appui à la sécession oscille autour de 40 % au Québec. Les sécessionnistes
obtiendraient encore moins avec une question claire sur la séparation. Les deux
tiers des Québécois indiquent qu'ils ne veulent pas d'un autre référendum.
Les partis libéraux, favorables à l'unité canadienne, mènent dans les
sondages sur les partis indépendantistes, tant sur la scène fédérale que sur
la scène provinciale.
Bien sûr, les sondages valent ce qu'ils valent,
et les variations peuvent être liées à des effets de conjoncture, telle la
popularité fluctuante des leaders. Je crois pourtant qu'un changement plus
fondamental s'est produit peu à peu depuis deux ans. Nous sommes revenus à un
meilleur équilibre entre le besoin d'autonomie des Québécois et leur désir
de se sentir partie prenante du Canada.
Le Canada se porte mieux sur le plan économique,
et ce redressement a été piloté par des Québécois : le Premier ministre,
Jean Chrétien, le ministre des Finances, Paul Martin, et le Président du
Conseil du Trésor, Marcel Massé. Des catastrophes naturelles sont survenues au
Québec et au Manitoba, au cours desquelles les Canadiens ont manifesté une
grande solidarité entre eux. Divers changements ont été apportés au
fonctionnement de la fédération, non pas pour plaire aux chefs séparatistes,
mais pour améliorer la capacité du gouvernement du Canada et des gouvernements
des provinces de travailler ensemble dans le respect de leurs compétences
respectives. Les autres provinces ont adopté une déclaration qui reconnaît le
caractère unique du Québec ainsi que l'égalité de statut des provinces,
déclaration qui n'a pas de portée juridique mais qui est apparue comme un
geste de bonne volonté.
En même temps, un débat s'est engagé sur ce
que serait une sécession, comment on la ferait et quelles seraient ses
conséquences sur les relations entre Québécois. Trop longtemps, la sécession
a été décrite et perçue comme une négociation entre deux blocs
monolithiques : le Québec et le Canada. À l'heure actuelle, elle est davantage
perçue comme une source de division entre Québécois : des Québécois qui ne
veulent plus du Canada essaieraient de l'enlever à ceux qui veulent le garder.
De plus en plus, les Québécois sont conscients du fait que ce processus serait
difficile.
Conclusion
Souvent, les régimes autoritaires ne font
qu'apposer un couvercle sur les haines ethniques. Lorsque l'autorité
disparaît, les conflits resurgissent comme s'ils n'avaient jamais cessé.
Il se pourrait, à l'inverse, qu'une démocratie
ne puisse survivre au fil des décennies sans tisser des liens authentiques
entre ses populations. Ces liens devraient pouvoir retenir les identités
plurielles ensemble.
Le philosophe allemand Herder a écrit que
«L'État le plus naturel est un État où n'existe qu'une nationalité faite
d'un seul caractère». Je ne sais pas ce qu'est un État naturel, mais je sais
qu'un pays gagne en humanité quand il tire le meilleur parti de ce que le
philosophe canadien, et québécois, Charles Taylor, appelle la diversité
profonde (deep diversity).
Bien sûr que le peuple québécois existe. Et le
peuple canadien aussi. La grande majorité des Québécois ont la bonne fortune
de se sentir membres des deux peuples en même temps. Une grave erreur de leur
part serait de voir dans cette double appartenance une tension, une anomalie,
une contradiction à résoudre.
Au Canada, nous parlons souvent des «deux
solitudes» pour décrire les difficultés entre francophones et anglophones. On
a oublié que cette expression est tirée d'une lettre de Rilke qui voulait par
là exprimer l'amour plutôt que l'isolement. «L'amour consiste en ceci : deux
solitudes qui se protègent, se rejoignent, et s'ouvrent l'une à l'autre», a
écrit le poète, exprimant ainsi cette double quête de l'autonomie et du
partage, de la définition de soi et de l'ouverture aux autres, nécessaires
tant pour les relations entre les personnes que pour celles entre les
populations [Traduction libre].
En fait, dans ce monde global, où les
populations se brasseront de plus en plus, l'intériorisation de différents
registres culturels, la possibilité de s'appuyer sur des concitoyens qui nous
complètent à leur façon, le mariage de l'autonomie et de l'entraide, seront
plus que jamais une force. Quand on a la chance d'avoir plus d'une identité, on
les garde toutes.
L'allocution prononcée fait foi

|