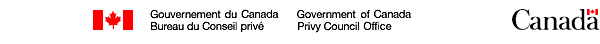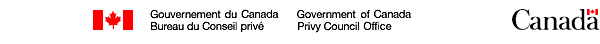|
«Un point tournant dans l'histoire du Canada :
l'avis de la Cour suprême sur la sécession unilatérale»
Notes pour une allocution
de
l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
au Centre d'études
constitutionnelles
Université de l'Alberta
Edmonton (Alberta)
le 24 septembre 1999
L'avis de la Cour suprême du Canada rendu le 20
août 1998 sur la sécession unilatérale est un point tournant dans l'histoire
de la fédération canadienne. Il confirme qu'une sécession unilatérale serait
sans fondement juridique.
La Cour nous dit qu'en droit, une sécession
nécessite une modification constitutionnelle, laquelle doit être négociée.
Elle ajoute que l'obligation d'entreprendre ces négociations constitutionnelles
ne peut venir que d'un appui clair en faveur de la sécession.
La conséquence de cet avis de la Cour suprême
du Canada est la confirmation d'un droit des Québécois : le droit de ne jamais
voir leur pleine appartenance au Canada remise en cause à moins qu'ils aient
clairement exprimé leur volonté d'y renoncer.
Ce droit profite aussi à tous les autres
Canadiens, eux qui, comme vous Albertains, ont le bonheur de compter le Québec
comme faisant partie de leur pays. Vous avez le droit de ne jamais perdre le
Québec à moins que les Québécois aient clairement renoncé au Canada. Et
comme vos concitoyens québécois, vous avez le droit, en cas de tentative de
sécession, à ce que celle-ci soit dûment négociée avec une recherche
sincère de justice pour tous.
Le gouvernement du Canada estime qu'il a le
devoir moral de refuser de négocier la perte du Canada pour les Québécois à
moins qu'ils aient clairement appuyé la sécession. L'avis de la Cour suprême
a confirmé qu'un tel refus de négocier dans l'ambiguïté a un fondement
juridique certain. En cas de proclamation unilatérale d'indépendance faite par
le gouvernement d'une province, le gouvernement du Canada est fondé en droit de
continuer à honorer pacifiquement ses responsabilités constitutionnelles
envers la population de cette province.
Le gouvernement du Québec, lui, prétendait que
le droit international écarterait le droit canadien en cas de proclamation
unilatérale d'indépendance, privant ainsi le gouvernement canadien de la
capacité d'évaluer par lui-même les préférences des Québécois. Seule la
Cour pouvait confirmer que le gouvernement du Québec ne serait pas fondé en
droit d'effectuer une tentative de sécession unilatérale. C'est ce que la Cour
suprême a fait le 20 août 1998.
Pour nous permettre de mesurer à quel point cet
avis de la Cour constitue un tournant historique, je vais, dans un premier
temps, rappeler la façon dont les partis sécessionnistes au Québec
envisageaient de faire la sécession. On verra que leur conception des choses
reposait sur un mythe juridique, une théorie erronée du droit à la sécession.
Deuxièmement, je montrerai que ce mythe juridique s'est évaporé devant les
précisions contenues dans l'avis de la Cour suprême. Je vais décrire l'avis
de la Cour de façon technique, académique même, mais n'est-ce pas la seule
façon de plaire à une assemblée de distingués juristes!
1. Le mythe du droit automatique à la
sécession
Les partis séparatistes au Québec, du R.I.N. au
Bloc, se sont imaginés qu'ils avaient le droit de faire l'indépendance du
Québec sur la base d'une simple victoire électorale. Ils soutenaient que le
droit international reconnaissait à un parti qui obtient la majorité des
sièges à l'Assemblée nationale, et qui ainsi forme le gouvernement, le droit
de s'autoproclamer gouvernement d'un pays indépendant.
Bien sûr, avec le temps, ces partis ont convenu
que le recours à un référendum serait une étape nécessaire pour confirmer
la volonté des Québécois de faire l'indépendance. Depuis, ils prétendent
qu'une question référendaire choisie par le gouvernement du Québec, fort de
sa majorité à l'Assemblée nationale, mènerait à une déclaration
d'indépendance dès lors qu'une majorité absolue des voix exprimées (50 %
plus un) indiqueraient une réponse positive à cette question. Cette
déclaration unilatérale serait valable pour tout le territoire du Québec,
quoi qu'en penseraient les électeurs des différentes régions qui le composent,
car le droit protégerait l'intégrité du territoire québécois mais pas celui
du territoire canadien.
Si les partis séparatistes ont convenu que des
négociations avec le Canada pourraient précéder la déclaration unilatérale
d'indépendance, ce n'est pas, là encore, parce qu'ils estimaient y être
obligés par le droit. S'ils offraient des négociations, c'est pour faciliter
la transition et en vue de conclure ce qu'ils appelaient une «association
économique» et ce qu'ils appellent maintenant un «partenariat politique et
économique» avec le Canada.
Dans la procédure annoncée en 1995 dans le
projet de loi 1 sur l'avenir du Québec, le gouvernement du Québec avait
prévenu qu'à tout moment au cours de ces négociations, il pourrait prendre
sur lui de s'autoproclamer, unilatéralement, gouvernement d'un État
indépendant. Il envisageait, après une victoire référendaire, une
négociation d'un an «à moins que l'Assemblée nationale n'en décide
autrement». Après cette autoproclamation, tous les citoyens, du Québec comme
de l'ensemble du Canada, et tous les gouvernements, du Canada comme de
l'étranger, seraient tenus, en droit, de considérer le gouvernement du Québec
comme étant, effectivement, le gouvernement d'un État indépendant. La
négociation pourrait se poursuivre, mais entre deux États indépendants.
Tout cet échafaudage repose sur une théorie
juridique qui confond le droit à l'autodétermination des peuples avec le droit
à la sécession. Il est tenu pour acquis qu'à la suite d'une élection, et a
fortiori à la suite d'un référendum, le gouvernement du Québec pourrait
proclamer l'indépendance du Québec en s'appuyant sur le droit international,
au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comme l'a soutenu le
Procureur général du gouvernement du Québec devant la Cour supérieure du
Québec en avril 1996, dans la cause Bertrand c. Bégin, le processus
d'accession à l'indépendance «trouve sa sanction dans le droit international
et la Cour supérieure n'a pas juridiction à cet égard.»
Plusieurs personnes ont cru sincèrement au
bien-fondé juridique de cette thèse. Cette croyance a influencé leur choix au
référendum de 1995. Or, une sécession est déjà un changement radical
suffisamment grave sans qu'on le complique davantage en s'y engageant à partir
d'une théorie juridique erronée. Car, immanquablement, les tribunaux auraient
été saisis de ces questions dans l'hypothèse où un gouvernement aurait
tenté de faire unilatéralement l'indépendance. En effet, peut-on imaginer
qu'aucun Québécois n'aurait contesté en Cour une démarche unilatérale
visant à lui faire perdre ses droits de Canadien? Il valait beaucoup mieux
clarifier ces choses à l'avance, dans le calme, plutôt que dans la turbulence
d'une éventuelle tentative de sécession.
Cette clarification essentielle a été apportée
par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998.
2. L'obligation de la clarté
La Cour suprême réfute le mythe du droit
automatique à la sécession fondé sur un référendum ou une élection. Elle
considère comme «mal fondé» l'argument selon lequel un vote majoritaire
permettrait de faire sécession en contournant la Constitution. Cet argument «méconnaît
le sens de la souveraineté populaire et l'essence même d'une démocratie
constitutionnelle» (par. 75). En fait, «la sécession d'une province du Canada
doit être considérée, en termes juridiques, comme requérant une modification
de la Constitution» (par. 84).
Le droit à l'autodétermination des peuples ne
peut pas non plus constituer le fondement d'un droit de faire sécession
unilatéralement, sauf dans les cas d'anciennes colonies, de peuples opprimés,
d'occupation militaire ou peut-être de négation du droit à
l'autodétermination interne. «Ces circonstances exceptionnelles ne
s'appliquent manifestement pas au cas du Québec (...) Par conséquent, ni la
population du Québec, même si elle était qualifiée de «peuple» ou de «peuples»,
ni ses institutions représentatives, l'Assemblée nationale, la législature ou
le gouvernement du Québec ne possèdent, en vertu du droit international, le
droit de faire sécession unilatéralement du Canada» (par. 138).
La Cour n'écarte pas la possibilité que le
gouvernement du Québec tente une sécession unilatérale. Mais le scénario
qu'elle décrit a peu à voir avec celui que le gouvernement Parizeau
envisageait en 1995. Une telle tentative se ferait sans «le couvert d'un droit
juridique» (par. 144) et dans un contexte où le Canada aurait droit «en vertu
du droit international, à la protection de son intégrité territoriale» (par.
130).
La sécession d'une province requiert une
modification de la Constitution, «qui exige forcément une négociation» (par.
84) «dans le cadre constitutionnel existant» (par. 149). Cela signifie que le
gouvernement du Québec négocierait à titre de gouvernement provincial, dans
le cadre de la Constitution canadienne, de laquelle il tire ses pouvoirs. À
aucun moment lors de ces négociations, il n'aurait le droit de s'autoproclamer
gouvernement d'un État indépendant.
La Cour ne s'est pas prononcée sur la mécanique
complexe d'une éventuelle négociation, et encore moins sur l'identification
difficile des différentes parties à cette négociation. Elle a précisé
cependant que le processus de négociation devrait permettre de concilier divers
droits et obligations «par les représentants de deux majorités légitimes, à
savoir une claire majorité de la population du Québec et une claire majorité
de l'ensemble du Canada quelle qu'elle soit» (par. 93). Les mots «ensemble du
Canada» plutôt que «reste du Canada» indiquent que le gouvernement du
Québec se retrouverait face à une partie dont les responsabilités très
larges s'étendraient aussi aux Québécois qui voudraient rester Canadiens.
De telles négociations toucheraient
inévitablement «une multitude de questions très difficiles et très
complexes». La Cour mentionne notamment les questions économiques, la dette,
les droits des minorités, les peuples autochtones et les frontières
territoriales : «Nul ne peut sérieusement soutenir que notre existence
nationale, si étroitement tissée sous tant d'aspects, pourrait être
déchirée sans efforts selon les frontières provinciales actuelles du Québec»
(par. 96). Il se pourrait donc que le succès des négociations passe par un
accord sur la modification des frontières. Le gouvernement du Québec ne peut
écarter a priori une telle possibilité.
Tous les participants seraient tenus de conduire
les négociations sur la sécession en conformité avec quatre principes
constitutionnels identifiés par la Cour : «le fédéralisme, la démocratie,
le constitutionnalisme et la primauté du droit, et la protection des minorités»
(par. 90). La conséquence pratique de cela est que le gouvernement du Québec
ne pourrait déterminer seul ce qui serait négociable et ce qui ne le serait
pas. Il «ne pourrait prétendre invoquer un droit à l'autodétermination pour
dicter aux autres parties les conditions d'une sécession» (par. 91). Il lui
faudrait plutôt négocier de façon à tenir compte des intérêts «du
gouvernement fédéral, du Québec et des autres provinces, d'autres
participants, ainsi que des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à
l'extérieur du Québec» (par. 92) et des Autochtones (par. 139) et ce, à
propos de tous les sujets : du partage de la dette à la question des
frontières.
Non seulement les quatre principes
constitutionnels identifiés par la Cour devraient régir une négociation sur
la sécession, mais rendraient aussi cette négociation obligatoire si la
population du Québec exprimait clairement sa volonté de faire sécession (par.
90). «La répudiation claire de l'ordre constitutionnel existant et
l'expression claire par la population d'une province du désir de réaliser la
sécession donnent naissance à une obligation réciproque pour toutes les
parties formant la Confédération de négocier des modifications
constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé» (par. 88).
Cette obligation de négocier, l'honorable Allan
Rock en avait donné la portée morale, le 26 septembre 1996, alors qu'à titre
de Procureur général il exposait devant la Chambre des communes les raisons du
renvoi à la Cour suprême : «Les principales personnalités politiques de
toutes nos provinces et le public canadien ont convenu depuis longtemps que le
pays ne restera pas uni à l'encontre de la volonté clairement exprimée des
Québécois.» De même, le Premier ministre Jean Chrétien a déclaré le 8
décembre 1997 : «Dans une telle situation, il y aura des négociations avec le
gouvernement fédéral, cela ne fait aucun doute» (Le Soleil, 08-12-97). J'ai
moi-même maintes fois souligné ce principe dans mes discours et lettres
publiques, à commencer par cette première déclaration à titre de ministre :
«Si le Québec malheureusement votait avec une majorité ferme sur une question
claire pour la sécession, j'estime que le reste du Canada a l'obligation morale
de négocier le partage du territoire» (Le Soleil, 27-01-1996).
En soi, l'obligation de négocier ne change pas
grand-chose du point de vue de la réalité politique. Comme l'a écrit le
constitutionnaliste Peter Hogg : «Même sans l'avis de la Cour suprême, la
réalité politique demeure que le gouvernement fédéral serait tenu de
négocier avec le Québec à la suite d'un vote clair de la majorité des
Québécois en faveur de la sécession. On peut �affirmer, sans risque de se
tromper, que toute tentative de s'opposer à la volonté de l'électorat
québécois recueillerait peu d'appui politique» (Canada Watch, vol 7, pp.
34-35). L'élément significatif est ailleurs : il est dans le lien de
causalité solide et irréfutable que la Cour établit entre cette obligation de
négocier la sécession et la clarté de l'appui pour la sécession.
L'obligation de négocier ne peut naître que
«d'une majorité claire de la population du Québec en faveur de la sécession,
en réponse à une question claire» (par. 93). Elle n'existe pas si
l'expression de la volonté démocratique est «elle-même chargée
d'ambiguïtés. Seuls les acteurs politiques, nous dit la Cour, auraient
l'information et l'expertise pour juger du moment où ces ambiguïtés seraient
résolues dans un sens ou dans l'autre» (par. 100).
Par conséquent, le gouvernement du Québec a
certes le loisir d'utiliser sa majorité parlementaire pour faire approuver par
l'Assemblée nationale une question référendaire qu'il aura lui-même
élaborée, et pour ensuite soumettre cette question aux électeurs québécois.
Mais le gouvernement du Canada, à titre «d'acteur politique» et de
«participant à la Confédération», a aussi le devoir d'évaluer par
lui-même la clarté de la question et de la majorité avant de conclure qu'il
est tenu de négocier la rupture du Canada.
Dans ce contexte, le gouvernement du Canada prend
note que la Cour définit la sécession comme le fait de se «détacher de
l'autorité politique et constitutionnelle» d'un État et de «former un nouvel
État doté d'une assise territoriale et reconnu au niveau international» (par.
83). Le gouvernement du Canada estime donc qu'une question, pour être claire,
ne devrait traiter que de ce seul enjeu et ne saurait faire référence à un
éventuel partenariat. Il faudrait que les Québécois expriment clairement
«leur désir de ne plus faire partie du Canada» (par. 92) en vue de faire du
Québec un État indépendant.
Quant à la majorité requise, le gouvernement du
Canada voit dans les nombreuses références de la Cour à la «majorité
claire» la confirmation qu'une majorité de 50 % plus un ne suffit pas. Mais,
en plus, sa référence à la «majorité claire» au sens «qualitatif» (par.
87) indique qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de nombre : il faudrait
tenir compte aussi du bon déroulement du référendum dans son ensemble pour
que ces résultats soient jugés comme dénués de toute ambiguïté en ce qui
concerne tant la question posée que l'appui reçu.
La Cour établit ainsi un droit de négocier la
sécession sur la base d'un appui clair, suivant les principes constitutionnels.
Mais la Cour n'énonce pas pour autant un droit à la sécession. Les
négociations peuvent échouer : «Il est concevable que même des négociations
menées en conformité avec les principes constitutionnels fondamentaux
aboutissent à une impasse» (par. 97). Que faire alors? «Nous n'avons pas ici
à faire de conjectures sur ce qui surviendrait alors. En vertu de la
Constitution, la sécession exige la négociation d'une modification» (par.
97).
Ce refus de spéculer est sage et réaliste, tant
la négociation d'une sécession possible soulève des questions difficiles et
des choix déchirants. Ici commence le «trou noir» contre lequel nous a
toujours mis en garde, à juste titre, le chef de l'Opposition à l'Assemblée
nationale du Québec, M. Jean Charest. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les
gouvernements devraient s'efforcer d'agir, en toutes circonstances, à
l'intérieur du cadre constitutionnel et conformément aux valeurs
démocratiques et aux principes constitutionnels énoncés par la Cour. Un
gouvernement qui choisirait d'agir en dehors du droit établi risquerait fort
d'être incapable de maintenir l'obéissance de ses citoyens.
Le gouvernement du Québec pourrait-il alors
essayer d'obtenir la reconnaissance internationale? La Cour évalue les
probabilités à cet égard de façon très prudente et réaliste : «Un Québec
qui aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels
face à l'intransigeance injustifiée d'autres participants au niveau fédéral
ou provincial aurait probablement plus de chances d'être reconnu qu'un Québec
qui n'aurait pas lui-même agi conformément aux principes constitutionnels au
cours du processus de négociation» (par. 103). De plus, la Cour a indiqué
clairement que les institutions gouvernant le Québec «ne possèdent pas, en
vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la
sécession du Québec du Canada» (par. 154).
On comprend cette prudence de la Cour quand on
connaît la réticence extrême de la communauté internationale à reconnaître
des sécessions unilatérales. Il ne manque pas, malheureusement, de populations
dans le monde qui veulent leur indépendance de façon quasi unanime, qui sont
victimes d'exactions inimaginables de la part des États dont elles font partie
et qui pourtant ne parviennent pas à obtenir la reconnaissance internationale
à titre d'États indépendants.
Aussi bien, nous, les Québécois, ne devrions
pas opter pour la sécession en comptant sur un appui international qui
s'exercerait à l'encontre de la volonté de l'État canadien. Nous devrions
plutôt compter sur l'honnêteté des autres Canadiens. Nous devrions miser sur
les valeurs de tolérance que nous partageons tous au Canada et qui nous
seraient terriblement nécessaires pour la conduite de ces négociations
pénibles et difficiles. D'où la contradiction de ce projet sécessionniste :
puisque les autres Canadiens sont des gens biens et corrects, pourquoi se
séparer d'eux?
Conclusion
Voilà plus d'un an que la Cour suprême du
Canada a rendu son avis sur la sécession unilatérale. Le gouvernement du
Québec a eu tout ce temps pour mesurer le gouffre qui sépare la démarche
unilatérale de sécession qu'il envisageait en 1995 et une démarche qui serait
conforme aux principes de légalité et de clarté précisés par la plus haute
cour du Canada.
Sur le plan moral, les Québécois ont le droit
de ne pas voir remise en cause leur appartenance au Canada à moins d'y avoir
renoncé clairement. Ce droit appartient aux Québécois, et non aux
gouvernements. Le gouvernement du Canada s'est engagé à le respecter
pleinement. Il appartient au gouvernement du Québec de faire de même.
Une question référendaire du type de celles qui
ont été posées en 1980 comme en 1995 ne pourrait mener à l'indépendance du
Québec, car elle serait trop chargée d'ambiguïtés pour rendre obligatoire la
négociation d'une sécession. Pour qu'une sécession puisse se faire, il
faudrait d'abord que tous soient convaincus que les Québécois la veulent
clairement. Les partisans de l'indépendance du Québec comme ceux de l'unité
canadienne devraient être en mesure d'interpréter la question et les
résultats de la consultation de la même façon. Sinon, la négociation de la
sécession serait impossible.
Encore une fois, le gouvernement du Canada ne
peut pas empiéter sur les prérogatives de l'Assemblée nationale, et il n'en a
d'ailleurs jamais été question. Celle-ci a le pouvoir de poser aux Québécois
toute question référendaire qui lui semble pertinente. Mais seule «une
majorité claire de la population du Québec en faveur de la sécession, en
réponse à une question claire» (par. 93) pourrait donner au gouvernement du
Canada l'assurance que les Québécois veulent qu'il négocie la fin de ses
responsabilités constitutionnelles envers eux et, plus largement, la fin de
leur appartenance au Canada.
Avec un appui clair pour la sécession, les
négociations seraient obligatoires, mais elles demeureraient chargées
d'incertitudes et nul ne peut prédire à l'avance les résultats de ces
négociations, y compris en ce qui a trait à la question des frontières.
Je suis convaincu que si on posait une question
claire aux Québécois, ils se prononceraient contre la sécession. Ils veulent
demeurer dans le Canada. Ils sont attachés à ce pays qu'ils ont bâti avec les
autres Canadiens.
Ainsi pourrait-on s'éviter tout ce débat. Il
suffirait que le gouvernement du Québec annonce demain matin qu'il ne tiendra
jamais de référendum, sauf si un jour il semble évident qu'un consensus
existe au Québec pour qu'il cesse de faire partie du Canada et devienne un pays
indépendant. Si le gouvernement du Québec faisait une telle déclaration,
l'incertitude référendaire disparaîtrait, avec tous ses coûts et pertes
d'énergie. Nous pourrions tous mieux travailler à l'amélioration de notre
qualité de vie et à la solution des problèmes sociaux qui commandent toute
notre attention, toute notre unité.
L'allocution prononcée
fait foi

|