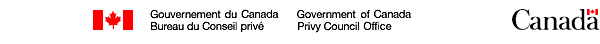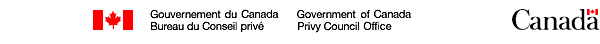|
«Le
rôle moteur du gouvernement du Canada
dans la Révolution tranquille»
Notes pour une allocution
de l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
à l'occasion du colloque
«La Révolution tranquille : 40 ans plus tard...»
Université du Québec à
Montréal
Montréal (Québec)
le 30 mars 2000
L'allocution prononcée fait foi
Notre Révolution tranquille a
eu de fortes caractéristiques propres. L'Université dans laquelle nous nous trouvons
aujourd'hui, avec sa personnalité bien à elle, en est un exemple.
Pourtant, je crois que pour bien
mesurer toute la portée de notre Révolution tranquille, il faut en saisir sa dimension
universelle en plus de ses traits spécifiques. Elle s'est inscrite dans une tendance
forte de l'histoire sociale contemporaine : l'ajustement des sociétés catholiques face
aux sociétés protestantes durant l'ère industrielle et post-industrielle.
La conjonction de ce phénomène
social avec un autre phénomène de nature plus institutionnelle, l'édification de
l'État-providence, a fait en sorte que l'un des moteurs de notre Révolution tranquille a
été notre gouvernement fédéral. C'est ce que je vais faire valoir avant de dégager de
cette démonstration des conclusions qui me semblent utiles pour nos débats
d'aujourd'hui.
1. Une révolution wébérienne
Le sociologue allemand Max
Weber, dans son ouvrage classique L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme(1), publié en 1905, a affirmé que les sociétés
protestantes s'adaptent mieux à l'industrialisation que les sociétés catholiques en
raison d'une plus grande valorisation de l'enrichissement matériel et de l'initiative
individuelle.
Weber a peut-être poussé
l'argument de façon trop systématique, mais il est certain que les sociétés
protestantes se sont engagées dans l'ère industrielle plus rapidement que les sociétés
catholiques - ce qui du reste n'enlève rien aux vertus du catholicisme en
termes de dévouement et d'altruisme. Au début du XXe
siècle, les économies dynamiques étaient principalement en pays protestants et les
seuls pays catholiques qui les approchaient, la France et la Belgique, étaient situés
dans la même région géographique. La minorité protestante jouait
d'ailleurs en France un rôle économique disproportionné. En Europe, le taux de
croissance économique des pays protestants excédait de 152 % celui des pays catholiques.
Avec la sécularisation, les pays catholiques ont comblé leur retard et le développement
économique a cessé de rimer avec protestantisme(2).
L'effet de convergence produit
par la sécularisation a pu être observé aussi sur le plan des valeurs privées. Aux
États-Unis par exemple, les catholiques des années cinquante avaient des valeurs
nettement plus autoritaires et traditionnelles que les protestants. Ces différences se
sont évanouies par la suite avec la baisse de la ferveur religieuse des catholiques et
des protestants(3).
Il est arrivé que le rattrapage
catholique ait connu une accélération au moment d'une libéralisation soudaine
accompagnée d'une brusque sécularisation. Certaines sociétés catholiques ont vécu un
dégel du genre encore plus spectaculaire que le nôtre. Je pense notamment à l'Espagne.
Quiconque a visité ce pays au milieu des années soixante-dix, pour ensuite y retourner
au début des années quatre-vingt, n'a pu qu'être frappé par l'incroyable changement
qui s'y est effectué en quelques années. L'Irlande des années quatre-vingt-dix
offre une autre manifestation saisissante de ce phénomène.
C'est cet ébranlement du
catholicisme traditionnel qui s'est produit dans le Québec du début des années
soixante. Bien sûr, il ne faut pas exagérer la coupure de 1960 et le mythe de la grande
noirceur. Mais Révolution tranquille il y a bien eue. Elle a été d'abord et avant tout
un phénomène de sécularisation accélérée, parallèlement d'ailleurs au Concile de
Vatican II. En quelques années l'Église a perdu au Québec l'essentiel de son
pouvoir séculier, comme l'a bien décrit mon père, Léon Dion, dans son livre sur le
projet de loi 60 qui allait créer le ministère de l'Éducation. On ne mesurera
jamais assez les répercussions profondes que la perte du pouvoir du clergé a eues sur la
vie de tous les jours des Québécois catholiques francophones.
Ceux qui sont assez âgés ont
tous leurs souvenirs personnels de cette époque. Je me souviens de ces petits voisins et
voisines qui nous disaient : «Vous les Dion allez brûler en enfer parce que vous
n'assistez pas à la messe chaque dimanche.» Puis soudainement, un dimanche matin, ils
étaient avec nous sur les pentes de ski.
Il aurait été bien étonnant
que le Canada échappe à cette tendance lourde qui a fait que les sociétés catholiques
ont été plus lentes que les sociétés protestantes à progresser dans
la modernité et le libéralisme. Au Canada comme ailleurs, on a pu observer des revenus
moins élevés, un entrepreneurship moins développé et, surtout, une scolarisation
beaucoup moins poussée chez les catholiques que chez les protestants.
Prenons la scolarisation,
compétence provinciale. Au Québec, l'instruction ne devint obligatoire pour les
catholiques qu'en 1943, trente ans après que le comité protestant eut
instauré cette mesure. L'Université McGill accepta les étudiantes en 1884, autorisation
qui ne fut accordée que cinquante ans plus tard en milieu catholique. À la veille de la
Révolution tranquille, moins de la moitié des 14-17 ans fréquentent l'école au Québec
comparativement à 80% en Ontario. Le taux de scolarisation universitaire est
beaucoup plus faible au Québec chez les francophones (2,9 %) que chez les anglophones (11
%).
Qui dit tendance lourde ne dit
pas fatalité. Le Québec catholique francophone aurait pu connaître une adaptation plus
rapide si le cours des événements avait été différent. Après tout, le Québec a
connu une forme de pré-révolution tranquille sous le gouvernement libéral
d'Adélard Godbout durant les années quarante, avec le droit de suffrage et
d'éligibilité accordé aux femmes, l'accès des femmes à la pratique du droit,
l'instruction obligatoire, la création d'Hydro-Québec et le début d'étatisation de
l'électricité, la création d'une commission du service civil indépendante que
Duplessis mettra ensuite en veilleuse(4) et le droit
d'association et la liberté syndicale dans les négociations pour les salariés.
Réformes progressistes,
valorisation du rôle de l'État, promotion de l'éducation, lutte au patronage, autant
d'orientations qui ont valu à Godbout d'être farouchement combattu par l'Église et le
nationalisme conservateur de l'époque. En plus de la crise de la conscription, qui lui a
nui, son insistance sur l'instruction obligatoire a été dénoncée comme de
l'anticléricalisme, sa promotion des femmes allait à l'encontre de l'unité et de la
hiérarchie familiales telles que définies par l'Église, sa lutte contre le patronage
était confondue à l'importation de schèmes étrangers, sa valorisation du rôle de
l'État a été dénoncée comme du bolchévisme. Comme l'a écrit son biographe Jean-Guy
Genest : «On peut regretter que l'ère des réformes qu'il a inaugurée n'ait pu se
poursuivre, le Québec n'aurait pas attendu les années soixante et la Révolution
tranquille pour changer de visage.»(5)
Le
vent de réformes aurait sans doute continué avec Godbout. On n'aurait peut-être pas
attendu les années soixante pour réformer le cours classique traditionnel, avec la
faiblesse de son enseignement scientifique, car Godbout avait dénoncé cette
chasse-gardée de l'Église. Il avait aussi annoncé sa volonté d'adopter un régime
d'assurance-maladie et avait créé une commission à cet effet.
La
collaboration avec l'effort modernisateur du gouvernement du Canada aurait certainement
été plus positive, car Godbout, tout en défendant l'autonomie provinciale, savait faire
la part des choses. C'est en bonne partie grâce à lui que la modification
constitutionnelle qui a permis au gouvernement du Canada de créer l'assurance-chômage a
pu se faire. À cette époque, l'aide aux chômeurs, malgré son insuffisance, absorbait
la moitié du budget provincial. Et ce n'est pas Godbout qui aurait empêché, comme
Duplessis l'a fait jusqu'à sa mort, l'achèvement de la route transcanadienne parce que
le gouvernement du Canada exigeait qu'on accorde les contrats aux plus bas
soumissionnaires sans égard aux affiliations politiques.
Seulement
voilà, Adélard Godbout, malgré une avance de quatre points dans le vote populaire,
victime de la carte électorale et de la concentration du vote anglophone et allophone qui
l'appuyait massivement, a perdu l'élection de 1944. Il est tombé sous les accusations
d'anticléricalisme, de socialisme et de servilité envers Ottawa.
Ainsi,
la Révolution tranquille aurait pu se produire plus tôt. Mais elle aurait pu tout autant
survenir plus tard, ou prendre la forme d'une évolution plus lente et progressive. C'est
ce qui se serait sans doute produit si l'équipe libérale de Jean Lesage n'avait pas
gagné de justesse l'élection de 1960, après une campagne qui a su rejoindre les
aspirations modernisatrices d'un grand nombre de francophones et obtenir l'appui massif du
vote anglophone et allophone.
Pas
de fatalité donc dans le cours des choses, mais plutôt une tendance fondamentale : notre
Révolution tranquille a été une révolution wébérienne, c'est-à-dire une adaptation
d'une société catholique à un monde séculier. Dans cette adaptation, notre
gouvernement fédéral, qui n'était pas, comme notre gouvernement provincial, sous
l'emprise du catholicisme conservateur, a joué un rôle moteur. Un rôle amplifié par
l'importance accrue qu'ont pris les gouvernements centraux lors de la mise en place de
politiques d'inspiration keynésienne et de l'État-providence.
2. Le rôle moteur du gouvernement fédéral
Le
slogan de la Révolution tranquille a été «Il est temps que ça change». Les vents de
changement que les Québécois ont fait souffler sur leur société sont venus des
universités, des syndicats, des intellectuels, de l'Église elle-même, mais une part
appréciable est venue de nos institutions fédérales. Comme je suis conscient qu'on
pourrait me soupçonner de partialité, je vais appeler à la barre une personnalité
politique d'une autre orientation politique que la mienne et qui, du reste, a été un
grand artisan de la Révolution tranquille : M. Jacques Parizeau.
«Avant
la Révolution tranquille», a-t-il déclaré dans une entrevue accordée à
Robert-Guy Scully le 22 janvier 1999, «tous ceux qui ont développé parmi
les jeunes Québécois une expertise économique, il n'y en a pas tant que ça,
travaillent à Ottawa. C'est à Ottawa que les choses se passent. C'est Ottawa qui a
créé le système de sécurité sociale au Canada, la politique de reconstruction qu'on a
faite après la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement sérieux, c'est Ottawa.
Québec est une espèce d'officine politique, un peu patronage. (...) À partir des
"Désormais" de Sauvé, (...) beaucoup de ceux qui (...) travaillent à Ottawa
pour des commissions d'enquête ou comme consultants dans tel ou tel ministère se
rabattent vers Québec et d'abord sont un peu horrifiés de voir ce qu'ils
trouvent.»
Cette
citation de M. Parizeau décrit bien les deux rôles clés qu'a joués le
gouvernement du Canada. Il a d'abord été le réformateur, celui qui a lancé les grandes
politiques qui ont permis aux provinces de prendre le relais, ce que le gouvernement du
Québec a fait avec beaucoup d'enthousiasme et d'originalité. Mais il a été aussi un
refuge, une aire de liberté, une école, comme dans le cas de deux des principaux
artisans de la Révolution tranquille, Georges-Émile Lapalme et Jean Lesage,
qui ont commencé leur carrière sur la scène fédérale ou de René Lévesque qui
s'est fait connaître comme vedette à la télévision d'État.
Partout
en Occident, l'effort de modernisation d'après-guerre a été mené par le gouvernement
central, y compris dans les fédérations, comme l'a bien montré Edmond Orban(6). Au Canada, le caractère décentralisé de notre
fédération a permis à certaines provinces -- surtout la Saskatchewan avec
l'arrivée au pouvoir de la CCF -- d'être de véritables laboratoires d'innovations,
mais c'est le gouvernement du Canada qui a permis de consolider ces expériences et de les
étendre à l'échelle du pays.
La
mise en place de l'État-providence a donc été d'abord lancée par le gouvernement
fédéral et a exigé, dans un premier temps, une plus grande centralisation. Le régime
Duplessis et ses soutiens cléricaux, nationalistes et conservateurs vont s'opposer à ces
initiatives fédérales. La population québécoise, par contre, y fera bon accueil. Par
exemple, au début des années 1950, les Québécois s'inscrivent massivement au
programme des allocations familiales qui sont facultatives et, comme le révèle un
sondage Gallup en 1955, l'approuvent à 95 %.
Comme
l'a écrit Dominique Marshall : «Durant deux décennies, le gouvernement
fédéral avait préparé indirectement la venue d'un État-providence provincial, en
fournissant lois, structures et expertise aux réformistes québécois»(7).
Ce que le gouvernement fédéral a initié, les gouvernements provinciaux vont en effet le
prolonger, en partie grâce à des subventions et à des ententes établies notamment au
moyen du pouvoir fédéral de dépenser. Claude Ryan, par ailleurs très méfiant
envers ce pouvoir aujourd'hui, l'a reconnu : «Le leadership du gouvernement
fédéral au cours du dernier demi-siècle a permis au Canada de mettre en place un
imposant filet de sécurité sociale. Celà aurait été impossible sans le pouvoir
fédéral de dépenser».(8)
[traduction] La Révolution tranquille, ce sera en partie l'histoire de ces ententes
négociées alors même que le gouvernement du Québec deviendra, lui aussi, «un
gouvernement sérieux», pour reprendre l'expression de M. Parizeau.
Pour
devenir sérieux, un gouvernement a besoin d'un personnel hautement qualifié et
expérimenté. Jean Lesage et son équipe ont largement puisé à Ottawa. Quelques
exemples : René Lévesque a recruté Michel Bélanger, fonctionnaire au
ministère des Finances du gouvernement fédéral pour le poste de directeur général de
la planification au ministère des Ressources hydrauliques et il a nommé
Jean Lessard, vice-président de l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent, au poste de président d'Hydro-Québec. Le nouveau directeur de la Police
provinciale a été Josaphat Brunet, ex-officier de la GRC. La présidence de la
Commission du service civil a été confiée à un fonctionnaire fédéral de vingt
années d'expérience, Jean Fournier. C'est un autre fonctionnaire à Ottawa,
Roger Marier, que Jean Lesage a nommé sous-ministre de la Famille et du
Bien-être social. C'est Roger Marier, comme le rappelle le Père
Georges-Henri Lévesque, qui «nous a fait passer de la charité spontanée et
souvent mal organisée au niveau de l'assistance sociale universelle»(9).
Enfin, Jean Chapdelaine, après 27 années dans la
diplomatie canadienne, a donné un élan à la diplomatie québécoise.
Mais au-delà des cercles
gouvernementaux, «la Révolution tranquille fut d'abord une révolution culturelle», a
écrit Fernand Dumont.(10) Il est indéniable que le
gouvernement du Canada a contribué directement à la renaissance
culturelle du Québec par ses politiques de communication et de recherche scientifique. La
Commission Massey-Lévesque sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences,
Radio-Canada, l'Office national du film, le Conseil des arts du Canada vont «paver la
route à la Révolution tranquille», selon l'expression de Louis Balthazar(11).
Il faut se rendre compte
que la télévision de Radio-Canada fut «le premier organisme culturel du Québec à ne
pas être contrôlé par le clergé»(12).
Fernand Séguin dira que «Radio-Canada c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire qui
soit arrivé au Canada français depuis Jacques Cartier.»(13)
Pour Marcel Dubé(14),
la télévision d'État a été à la source du rajeunissement intellectuel, de l'essor
des arts et des lettres et de la révolution idéologique observés au
Québec.
Il
y aurait tant à ajouter sur le rôle du gouvernement du Canada dans la Révolution
tranquille. Je n'ai rien dit par exemple de la Commission Laurendeau-Dunton sur
le bilinguisme et le biculturalisme, établie par le Premier ministre Pearson. Elle a
sonné le réveil dans bien des domaines. La seule étude d'André Raynauld(15) , faite pour le compte de cette commission, qui
révélait la faible participation des Canadiens français à l'économie du Québec,
provoqua «une commotion générale», selon l'expression de mon père.(16)
Mais je crois avoir fait ma démonstration : le gouvernement du Canada a été un
moteur, trop souvent méconnu, de la Révolution tranquille.
3. Deux conclusions pertinentes pour nos débats d'aujourd'hui
Je dégagerai deux conclusions,
l'une touchant notre nationalisme, l'autre notre fédéralisme.
Ma première conclusion est que
le nationalisme n'est en soi ni bon ni mauvais. Avant la Révolution tranquille, il a
souvent été une force de freinage à la modernisation du Québec, mais depuis il a
souvent été une stimulation.
Par exemple, le nationalisme a
servi de justification au patronage avant la Révolution tranquille, alors qu'après il a
servi de justification pour le combattre(17). Autant
avant, c'était «être nous-mêmes» que d'agir selon des pratiques paternalistes,
autant après il devenait impératif d'assainir nos moeurs politiques pour être les
meilleurs. C'est René Lévesque sans doute qui a le mieux décrit cette
métamorphose du nationalisme. Dans ses mémoires, il n'a pas de qualificatifs trop forts
pour dénoncer l'administration publique que Duplessis avait laissée : «loterie
arbitraire», «corps de policiers pourri jusqu'à la moelle», «écuries d'Augias»(18). Il serait difficile de trouver un autre ancien chef de
gouvernement qui ait attaché plus d'importance dans ses mémoires que
René Lévesque au thème de l'intégrité gouvernementale.
Si le nationalisme peut être
une bonne chose, il ne l'est pas forcément. Il risque toujours de devenir un cran
d'arrêt de la pensée, une référence impérative à un passé qui nous définirait pour
toujours, une obsession du consensus comme gage de fidélité à nous-mêmes. C'est ce qui
arrive quand on en vient à se définir collectivement selon un
«modèle» que personne n'est autorisé à remettre en cause sous peine d'être accusé
de ne plus aimer le Québec.
La Révolution tranquille ne
s'est pas faite au nom d'un «modèle québécois» ou de «demandes traditionnelles». Au
contraire, le modèle de l'époque, tel qu'il se profile par exemple dans la Commission
Tremblay sur les problèmes constitutionnels établie par Duplessis en 1953, celui d'une
culture communautaire traditionnelle fondée sur «la famille, le travail autonome, la
paroisse»(19), opposait un rempart à bien des réformes.
La Révolution tranquille a été faite par une génération de Québécois qui étaient
résolus à brasser la cage et qui n'ont pas avancé les yeux rivés sur le
rétroviseur.
De même, le nationalisme nuit
quand il devient une obsession de la distinction. Nous, les Québécois, sommes distincts
des autres Canadiens pour des raisons évidentes. Mais nous ne sommes pas que distincts,
quand même. Nous partageons avec eux quantité d'objectifs et d'intérêts. La
Révolution tranquille nous a permis d'affirmer davantage les droits de la langue
française et a fait apparaître de nouvelles formes d'inventivité québécoise, mais à
bien des égards nos moeurs et nos institutions sont devenues moins distinctes de celles
des autres Canadiens. De plus, le profil de notre distinction a varié avec le temps. La
Révolution tranquille aurait été bien plus difficile à réaliser si la conception que
la Commission Tremblay se faisait de notre société distincte avait été enchâssée
dans la Constitution.
Voilà qui m'amène à notre
fédéralisme. Nous, les Québécois, avons deux gouvernements dotés de pouvoirs
constitutionnels : notre gouvernement provincial et notre gouvernement fédéral. Ce
dernier n'est pas une puissance étrangère pour nous. Il a puissamment contribué à
forger notre société, durant la Révolution tranquille comme à d'autres époques. Ce
n'est pas parce que nous y sommes en minorité qu'il faut lui donner toujours tort à
priori. Il lui est arrivé d'avoir raison contre notre gouvernement provincial et je
dirais que ce fut plus souvent qu'autrement le cas durant la période
Duplessis.
Ce gouvernement fédéral, nous
l'influençons en retour. De Pierre Trudeau et de son équipe de Québécois qui ont
tant réformé Ottawa, on peut dire qu'ils ont eux-mêmes été des artisans et des
produits de la Révolution tranquille. Ils ont porté son dynamisme jusqu'au coeur des
institutions que nous partageons avec les autres Canadiens. Ils ont affirmé notre
langue et fait valoir leurs talents à Ottawa comme l'équipe Lesage l'avait fait à
Québec.
Du point de vue
intergouvernemental, la Révolution tranquille a été l'apparition de deux gouvernements
sérieux au lieu d'un seul. Pour certains d'entre nous, c'est là une contradiction
intenable. De la même façon qu'ils nous demandent de renoncer à notre identité
canadienne pour être Québécois uniquement, ils nous disent que notre seul gouvernement
est celui du Québec. En matière de gouvernance comme d'identité, ils sont adeptes de la
pensée unique.
M. Jacques Parizeau est sans
doute celui qui a le mieux exprimé cette conception jacobine de la société politique
qui exige que le siège de l'autorité ne réside qu'en un seul lieu. En 1967, il
affirmait déjà que le Canada était tombé dans «l'anarchie» parce que «nous avons
poussé déjà trop loin» la décentralisation : «Nul pays ne devrait être
autorisé à fragmenter son pouvoir de décision comme nous l'avons fait (...)»(20). Le 28 février 1999, à Québec, il
répétait la même conviction : «Il est absolument impératif que le gouvernement
fédéral, pour être capable de garder les pouvoirs d'un véritable gouvernement et de
déterminer des politiques à suivre, centralise ce qui est une fédération
extraordinairement décentralisée».
Le Canada va se centraliser, le
Québec doit en sortir : telle est la prophétie de M. Parizeau, immuable depuis les
années soixante. Je suis persuadé qu'elle est fausse et que M. Parizeau a tiré la
mauvaise conclusion d'une Révolution tranquille à laquelle il a tant
contribué.
Nous pouvons et nous devons
avoir deux gouvernements sérieux. Deux gouvernements qui ont chacun leurs perspectives,
qui sont sujets à différentes influences et qui, par une saine émulation, apprennent
l'un de l'autre ainsi que des autres gouvernements de notre fédération. C'est ainsi que
nous nous donnons les meilleures chances de développement. Bien sûr, il est normal que
nous ayons différentes opinions sur leurs rôles respectifs ou leur place vis-à-vis la
société civile et les forces du marché. Mais l'important est que nous considérions ces
deux gouvernements comme les nôtres et que nous les encouragions à collaborer par-delà
leur concurrence naturelle.
Telle est la principale
conclusion que je tire du rôle moteur du gouvernement du Canada dans la Révolution
tranquille.
1. Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme,
Paris, Plon, 1967, C1964, 2e édition.
2. Ronald Inglehart, «The Renaissance of Political Culture», American
Political Science Review, 82, (1988), p. 1203-1230.
3. Duane F. Alwin, «Religion and Parental Orientations: Evidence of
a Catholic-Protestant Convergence», American Journal of Sociology, 92, (1986),
p. 412-40.
4. James I. Gow, Histoire de l'administration publique
québécoise, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1986, p. 274-277.
5. Jean-Guy Genest, Godbout, Sillery (Québec), Les
éditions du Septentrion, 1996, p. 327.
6. Edmond Orban, La dynamique de la centralisation dans l'État
fédéral : un processus irréversible?, Montréal,
Québec-Amérique, 1984.
7. Dominique Marshall, Aux origines sociales de
l'État-providence : familles québécoises, obligation scolaire et allocations
familiales,1940-1955, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1998, p. 287.
8. Claude Ryan, «The agreement on the Canadian social union as seen
by a Québec federalist», Inroads, 8, (1999), p. 33.
9. Georges-Henri Lévesque, Souvenances 2 : Remous et
éclatements, Montréal, Les Éditions de La Presse, 1986, p. 113.
10. Fernand Dumont, Le sort de la culture, Montréal,
l'Hexagone, 1987, p. 305.
11. Louis Balthazar, «Quebec and the Ideal of Federalism», dans
M. Fournier, M. Rosemberg et D. Whyte (eds.), Quebec Society, Critical Issues,
Scarborough, Prentice Hall,1997, p. 46-47.
12. Louis Balthazar, «Aux sources de la Révolution tranquille :
continuité rupture, nécessité», in M. R. Lafond (sous la dir.) La Révolution
tranquille 30 ans après, qu'en reste-t-il?, Hull (Québec), Éditions de Lorraine,
1992, p. 94.
13. Fernand Séguin, cité dans Ignace Cau, L'édition au
Québec de 1960 à 1977, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1981, p. 98.
14. Marcel Dubé, «Dix ans de télévision», Cité libre,
48, (juin-juillet) 1962, p. 24-25.
15. André Raynauld et al., La répartition des
revenus selon les groupes ethniques, Étude de la Commission royale d'enquête sur le
bilinguisme et le biculturalisme. (La troisième étude du Livre III du Rapport de la
Commission publié en 1969, Le monde du travail. Le secteur privé, est
basée sur l'étude d'André Raynauld et al.)
16. Léon Dion, La révolution déroutée, Montréal,
Boréal, 1998, p. 214.
17. Jacques Bourgault et Stéphane Dion, «Public sector ethics in
Quebec: The contrasting society», dans Corruption, Character and Conduct,
Toronto, Oxford University Press, 1993, p. 67-89.
18. René Lévesque, Attendez que je me rappelle...,
Montréal, Québec-Amérique, 1988.
19. Québec, Rapport de la Commission royale d'enquête sur les
problèmes constitutionnels (Commission Tremblay), 1956, volume II, p. 69.
20. Conférence prononcée à Banff, reproduite dans René
Lévesque, Option Québec, Montréal, Éditions de l'Homme, 1968,
p. 104.

|