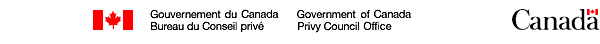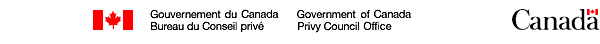|
« Mes rencontres avec l'Espagne »
Notes pour une allocution
de l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
Discours prononcé à la cérémonie d'attribution d'un
doctorat honorifique
l'Université Carlos III de Madrid
Madrid (Espagne)
le 13 novembre 2002
L'allocution prononcée fait foi
En recevant ce doctorat honoris causa de l’Université Carlos III de
Madrid, mes pensées vont à mes parents qui m’ont élevé dans le respect de
l’université et du savoir, à mon épouse, Janine, universitaire comme moi,
qui m’a plus aidé dans ma carrière que je ne l’aiderai jamais dans la
sienne, à notre fille Jeanne, qui est déjà en âge de partager la passion de
ses parents pour l’acquisition des connaissances, ainsi qu’à tous mes
proches et à tous mes amis. Je pense aussi à mes professeurs et à mes
condisciples de l’Université Laval de Québec, où j’ai appris la science
politique, de même qu’à ceux du cycle de sociologie de l’Institut d’études
politiques de Paris, où j’ai fait mes études de doctorat. Je n’oublie pas
non plus l’Université de Moncton, située dans notre province du
Nouveau-Brunswick, qui m’a donné, en janvier 1984, ma première chance d’enseigner
la science politique, et surtout l’Université de Montréal, où j’ai été
professeur de science politique de septembre 1984 à janvier 1996.
Je croyais bien demeurer à l’Université de Montréal pendant toute ma
carrière, avant que le Premier ministre du Canada, le très honorable Jean
Chrétien, me convainque de venir défendre mes idées sur la scène politique.
Bien qu’il m’ait arraché à ce que je croyais être mon seul univers
professionnel, l’université, je le remercie de m’avoir associé à ce qu’il
a accompli en politique, de la solidification de l’unité canadienne à l’amélioration
de la qualité de vie des Canadiens.
Une autre pensée me vient : je trouve extraordinaire que ce doctorat honoris
causa me soit décerné par une prestigieuse université d’Espagne, à l’invitation
de son recteur, monsieur Gregorio Peces-Barba Martínez, l’un des
« Pères de la Constitution » espagnole. Il y a eu dans mon parcours
intellectuel des points de rencontre avec l’Espagne que la cérémonie d’aujourd’hui
m’invite à préciser.
Je vous ramène au milieu des années soixante-dix. J’avais alors 20 ans et
j’étudiais la science politique à l’Université Laval. Les courants
sociologiques dominant à l’époque étaient très fatalistes. Ils
enseignaient ce que j’appellerais une conception déterministe des sociétés
humaines. Tant la sociologie marxiste structuraliste que la sociologie
fonctionnaliste parsonnienne tendaient à définir l’individu comme le pur
produit des conditionnements qu’il avait subis depuis l’enfance. Il n’était,
à toutes fins pratiques, que le résultat de son milieu, de sa culture
nationale et de ses origines de classe. On faisait bien peu de cas de son libre
arbitre.
Les sociétés humaines étaient décrites comme étant paralysées par le
poids des conditionnements, incapables de vraiment changer. Ou, si elles
changeaient, c’était sous l’impulsion inexorable de grands déterminismes
sociétaux, telle l’évolution des modes de production, face auxquels le libre
choix des individus ne comptait pour presque rien.
Cette conception fataliste des sociétés humaines tendait à dévaloriser la
démocratie libérale. En effet, celle-ci fait de la liberté individuelle non
pas la seule, mais la première des valeurs. Or, à quoi bon fonder la société
politique sur l’individu libre si cette liberté n’est qu’une illusion?
Étudiant, j’entendais souvent qualifier les institutions politiques
libérales de démocratie formelle ou artificielle derrière laquelle se
jouaient les vrais déterminismes sociétaux. Les théories collectivistes
étaient en vogue. Certains courants de la sociologie politique voyaient dans
les cultures nationales un déterminisme tel que, par exemple, on en concluait
presque à une incompatibilité insurmontable entre les pays catholiques et
latins et la démocratie dite de type anglo-saxon. Le courant marxiste, lui,
annonçait l’avènement inéluctable du collectivisme communiste.
Il faut dire que la conjoncture internationale ne semblait guère prometteuse
pour les démocraties. L’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie, l’Europe
de l’Est et une partie de l’Europe méditerranéenne étaient sous la
férule de régimes autoritaires ou totalitaires. Dans des pays comme la France
ou l’Italie, environ le quart des électeurs accordait son suffrage à des
partis ouvertement hostiles à la démocratie pluraliste. De telles idées
pénétraient les syndicats et les universités de toutes les démocraties
occidentales. La démocratie américaine, elle, était discréditée par les
séquelles de la guerre du Vietnam et la crise du Watergate.
Or, ce qui s’est passé, au cours des années qui suivirent, fut tout le
contraire d’un rétrécissement de l’espace démocratique et de la liberté
individuelle. L’humanité a connu l’un des phénomènes les plus positifs de
toute son histoire : l’avancée fulgurante de la démocratie sur tous les
continents. Et d’où cet ébranlement mondial est-il parti? De la Grèce, du
Portugal, de l’Espagne, en somme de la Méditerranée, éternel berceau de la
civilisation.
Je pense depuis longtemps que l’un des héros du XXe siècle
aura été votre roi, Sa Majesté Juan Carlos I. Plutôt que d’écouter
les voix fatalistes qui clamaient que les peuples latins n’étaient pas faits
pour la démocratie, il a cru au destin démocratique d’une Espagne prête à
assumer son pluralisme. Ce faisant, ce n’est pas seulement le destin de l’Espagne
qui s’est joué; on peut croire que c’est peut-être, aussi, celui de l’humanité.
Car c’est simplifier à peine que de dire que, lorsqu’il est devenu clair
que l’Espagne ne reviendrait pas en arrière et deviendrait démocratique, les
Latino-Américains se sont dit : Nous en sommes aussi capables que les
Espagnols!
Et c’est ainsi que la grande vague démocratique a déferlé sur tous les
continents au point de mettre à bas le mur de Berlin. Il n’y a rien eu d’inéluctable
dans cet heureux développement, qui n’est le résultat d’aucun
déterminisme de l’histoire. Il a été plutôt le résultat de choix
courageux, à l’image de votre roi. Aussi, aujourd’hui, puisque nous savons
que rien n’est inéluctable, nous ne devons pas tenir ce progrès pour acquis.
Nous devons plutôt nous efforcer de toujours solidifier davantage la
démocratie et les valeurs sur lesquelles elle se fonde.
Mais je reviens au jeune étudiant de science politique que j’étais au
milieu des années soixante-dix. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours été d’un tempérament assez volontaire. Cela m’amenait à
accueillir avec un certain scepticisme les théories que l’on m’enseignait
sur le fatalisme des déterminismes sociaux. Non pas que je niais l’influence
qu’exercent sur chacun de nous notre milieu social et la culture politique de
la société à laquelle nous appartenons. Il me semblait cependant que ces
forces collectives exercent une influence sur le libre arbitre de chacun de
nous, mais sans en annihiler le caractère décisif. D’excellents professeurs
m’ont conforté dans cette opinion. Je voudrais mentionner en particulier mon
propre père, Léon Dion, qui était un universitaire renommé de pensée
libérale. Je pense aussi au professeur qui a dirigé mon mémoire de maîtrise
à l’Université Laval, Vincent Lemieux, l’un des politologues canadiens les
plus réputés. Ma reconnaissance va aussi au grand sociologue français Michel
Crozier, qui a dirigé ma thèse de doctorat.
Michel Crozier m’a enseigné que ce qui fait le propre des sociétés
humaines est la marge de liberté de chacun de leurs membres. Le comportement de
chaque humain conserve une marge d’imprévisibilité, ce que Crozier appelle
la zone d’incertitude. Chaque humain cherche à réduire cette
imprévisibilité du comportement d’autrui. D’où les jeux de pouvoir
inhérents aux sociétés humaines. Il ne sert à rien de nier la réalité de
ces jeux de pouvoir et de se réfugier derrière la fausse sécurité des
théories déterministes. Il faut plutôt chercher à mieux comprendre cette
part d’indétermination du comportement individuel qui donne aux sociétés
humaines leur vrai dynamisme. Aucun comportement social ne peut être compris
sans référence à la conduite des individus.
Cet individualisme méthodologique a inspiré mes travaux comme chercheur et
a marqué l’enseignement que j’ai prodigué à mes étudiants. Mais il m’a
aussi aidé à développer ma propre pensée politique à propos de ce qui est
juste et bien, souhaitable et désirable, en société. Je crois en un
libéralisme équilibré, fondé sur la liberté individuelle, mais qui cherche
à orienter celle-ci vers la solidarité des citoyens. Dans mes recherches et
mes écrits sur l’administration publique, je me suis toujours efforcé de
placer au cœur de ma pensée le service public, cette belle valeur humaniste.
Le service public privilégie à la fois la primauté de l’individu sur l’administration
publique et le rôle nécessaire que joue l’État pour inciter les individus
à mieux s’entraider.
Ce libéralisme équilibré a inspiré aussi ma position face au
nationalisme. Québécois francophone, j’ai toujours baigné dans une
société très nationaliste. Le Québec est la seule province majoritairement
francophone au Canada. Le voisinage des États-Unis donne à la langue anglaise
une énorme force d’assimilation. Dans de telles conditions, on conçoit
facilement que le Québec francophone sera toujours nationaliste. Mais, après
avoir observé le nationalisme dans ma société, le Québec, et en avoir vu les
effets ailleurs dans le monde, j’en suis venu à la conclusion que, si le
nationalisme peut être une bonne chose, il peut aussi dégénérer en une force
dangereuse et nuisible. Le nationalisme joue un rôle positif quand il renforce
le désir d’entraide qui anime les membres d’une même société. Il est
nuisible et potentiellement dangereux lorsqu’il devient la seule grille
idéologique à travers laquelle on perçoit la vie en société.
Le nationalisme peut renforcer le désir d’entraide au sein d’un groupe
humain. Mais la valeur suprême doit demeurer l’humain et non la nation. La
raison en est simple : seules les personnes en chair et en os existent
concrètement, elles seules sont capables de sentiments, de liberté, de
bonheur.
Quel est le moyen de faire en sorte que le nationalisme demeure un principe d’entraide
et non une incitation au repli sur soi, voire à la haine des autres? Je crois
que la réponse réside dans la promotion constante du pluralisme identitaire.
Il faut, dans une société libérale, accepter que les citoyens aient
différentes façons de se définir par rapport à la collectivité. L’important
est que ce pluralisme des identités collectives crée une dynamique favorable
à l’entraide et à la compréhension mutuelle.
C’est pourquoi j’en suis venu à la conclusion que les identités
collectives, cela s’additionne, mais cela ne se soustrait pas. Je suis à la
fois Québécois et Canadien et je n’ai aucune envie de choisir entre ces deux
identités. Il y a une dimension canadienne à mon identité québécoise dont
celle-ci ne saurait se priver sans s’appauvrir. De même, l’attache
particulière qui me relie au Québec ne me ferme pas aux autres Canadiens. Au
contraire, elle me donne le goût de mettre mes talents individuels et ma
culture de Québécois au service de tous mes concitoyens canadiens de la même
façon que j’accepte volontiers leur contribution.
La liberté individuelle, le service public, la solidarité des citoyens, le
pluralisme des identités, telles sont les valeurs qui ont forgé ma pensée et
qui m’ont guidé en politique. Elles m’inspirent en tant que ministre des
Affaires intergouvernementales du Canada, dans les efforts que je déploie
depuis près de sept ans pour améliorer la capacité de la fédération
canadienne de servir toujours mieux les Canadiens.
Ces valeurs ne me sont pas venues seulement de mon expérience à l’université
et au gouvernement. Plusieurs expériences de vie m’ont aussi marqué. Je veux
en mentionner une en particulier. En mai et juin 1976, à l’âge de 20 ans, j’ai
parcouru la péninsule ibérique de long en large en auto-stop. J’ai alors
vécu des moments d’une inoubliable intensité en échangeant avec des
Espagnols de tout âge. Comme vous pouvez vous en douter, j’ai eu des
discussions politiques passionnantes. Ma connaissance de votre langue était, à
la fin de ces deux mois, bien meilleure qu’aujourd’hui. Je rêve de trouver
le temps de revivre un jour une telle expérience espagnole.
Je sentais bien, à l’époque, qu’un grand bouleversement se préparait
dans cette Espagne à peine sortie du franquisme, mais j’aurais bien été
incapable d’en prédire le cours.
Je suis revenu à Madrid comme jeune professeur à l’occasion du Congrès
mondial de sociologie de juin 1990. J’ai retrouvé une capitale espagnole
méconnaissable tant elle pétillait de liberté. En un peu plus d’une
décennie, votre pays avait connu une libération politique et sociale qui n’était
pas sans me rappeler l’évolution un peu analogue qu’a connue ma société,
le Québec, à partir du début des années soixante. En une décennie, le
Québec a secoué ses traditions conservatrices et cléricales au point de se
transformer en l’une des sociétés les plus dynamiques et effervescentes d’Amérique
du Nord.
En septembre 1991, j’ai participé au séminaire international sur la
planification linguistique organisé par le Consello da Cultura Galega, à
Saint-Jacques-de-Compostelle. J’ai notamment assisté à un débat animé
entre linguistes qui discutaient ferme de la possibilité que le portugais ne
soit, après tout, qu’un dialecte galicien! Ce séminaire de haut niveau m’a
aidé à mieux mesurer toute la richesse que la diversité des langues parlées
représente dans des démocraties comme l’Espagne et le Canada.
Lorsque je suis revenu à nouveau dans votre pays, ce fut en tant que
professeur invité pour donner des conférences à Madrid et à Barcelone, en
décembre 1995. Je réfléchissais alors intensément à mon avenir car le
Premier ministre du Canada venait tout juste de me faire connaître, à titre
privé, son désir que je me joigne à son gouvernement afin de l’aider à
consolider l’unité canadienne. Deux mois plus tôt, un référendum avait
été tenu au Québec, où le gouvernement sécessionniste avait demandé aux
Québécois d’approuver un projet confus de souveraineté assorti d’une
offre de partenariat politique et économique entre le Québec et le Canada. Par
une faible majorité, les Québécois avaient rejeté ce projet.
Je ne vous cache pas que mon séjour en Espagne en ce mois de décembre 1995
a contribué à me convaincre d’accepter d’entrer en politique pour y
promouvoir mes idées. Je me souviens notamment des échanges que j’ai eus à
Barcelone avec des professeurs qui étaient convaincus que l’avenir de cette
ville magnifique ne sera jamais aussi prometteur que si elle accepte d’être
tout à la fois profondément catalane, espagnole et européenne. Mes
interlocuteurs croyaient, comme moi, à la force des identités plurielles en
société. Ils pensaient, eux aussi, que les identités, cela s’additionne,
cela ne se soustrait jamais.
Ce passage en Espagne m’a aidé à réaliser à quel point le débat que
nous avons au Québec, quant à savoir si nous devons accepter ou rejeter notre
appartenance canadienne, est un débat universel. Je me suis dit que le Canada
avait mieux à faire à l’aube d’un nouveau siècle que d’offrir au monde
le spectacle de sa rupture. Il devait, au contraire, démontrer au reste du
monde qu’il était à la fois possible et souhaitable de faire cohabiter dans
l’entraide, la tolérance et l’harmonie, au sein d’un même État, des
populations de langues et de cultures différentes.
Je suis persuadé que la démocratie nous demande d’accepter tous nos
concitoyens, sans distinction de race, de religion ni d’appartenance
régionale. La sécession, elle, équivaut à choisir parmi nos concitoyens ceux
que nous acceptons et ceux que nous voulons transformer en étrangers. Il y a
donc entre la sécession et la démocratie une antinomie qui rend ces deux
notions difficilement compatibles. Les citoyens en démocratie n’ont pas pour
vocation de se transformer en étrangers les uns par rapport aux autres. Cette
conviction, je la dois en partie aux échanges que j’ai eus avec des citoyens
de votre pays.
En fait, un pays se donne les meilleures chances de s’améliorer quand tous
ses citoyens ressentent une forte solidarité les uns envers les autres et
lorsqu’ils voient leurs différences de langue, de culture ou de religion
comme une complémentarité fructueuse, jamais comme une menace ou une source de
division. Je sais que c’est l’idéal que vous poursuivez en Espagne,
encouragés par vos réussites, et sans reculer devant un terrorisme que le
gouvernement auquel j’appartiens condamne fermement au nom de tous les
Canadiens.
Les contextes nationaux diffèrent, mais la quête des Espagnols et des
Canadiens est la même. Sachez que vous n’êtes pas seuls dans vos efforts
pour bâtir une société toujours plus tolérante et ouverte à sa propre
diversité. Les Canadiens, eux aussi, voient bien que leur pays ne progressera
vers plus de mieux-être et de prospérité que par l’unité dans la
diversité.
Voilà du moins ce que m’a enseigné une vie faite de voyages, d’études
et d’action. Le doctorat honoris causa que vous me décernez aujourd’hui
signifie surtout pour moi un encouragement à poursuivre ces idéaux de liberté
et de solidarité humaine.

|