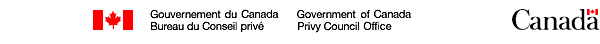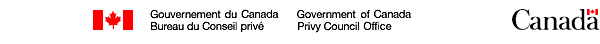« L’état de la
démocratie canadienne »
Notes pour une allocution
de l’honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
devant le Leadership Forum
du Arthur Kroeger College of Public Affairs
Ottawa (Ontario)
le 11 février 2003
L'allocution prononcée fait foi
L’Arthur Kroeger College of Public Affairs m’offre
sa tribune prestigieuse pour vous parler aujourd’hui de l’état de la
démocratie canadienne. J’en suis flatté, mais en même temps je me demande
ce qui me vaut cet honneur.
Je ne suis pas le leader du gouvernement à la Chambre. J’imagine que vous
n’attendez pas de moi un discours sur les initiatives passées et présentes
du gouvernement en matière de pratiques gouvernementales, parlementaires ou
électorales. Mon collègue Don Boudria serait bien mieux placé pour vous
parler de notre impressionnant bilan, depuis les premières initiatives
parlementaires en 1993 (comme le renvoi des projets de loi du gouvernement aux
comités avant la deuxième lecture), jusqu'à l’actuel programme du Premier
ministre concernant l’éthique : un nouveau commissaire à l’éthique
indépendant, un nouveau code de déontologie des parlementaires et un projet de
loi sur le financement des partis politiques.
Bien que je sois ministre des Affaires intergouvernementales, je ne crois pas
non plus que vous vous attendez à un exposé portant principalement sur les
relations fédérales-provinciales. Ce serait dévier du sujet. Le fédéralisme
et la démocratie ont de solides liens (il n’y a pas de fédéralisme
véritable sans démocratie), mais ce n’est pas la même chose.
Non, je peux supposer que j’ai été invité pour des raisons davantage
liées à mon parcours personnel. Vous voulez sans doute entendre le point de
vue d’un universitaire qui, après avoir écrit sur la démocratie et sur le
Canada, a connu sept années de vie politique active. C’est donc à titre de
politologue-politicien que je vais m’exprimer.
Je ne suis pas sans savoir que l’on dit de notre démocratie qu’elle vit
un certain « malaise ». Selon la Commission du droit du
Canada, « un "malaise démocratique" croissant a commencé à
caractériser le paysage politique canadien. »1.
Cette affirmation m’apparaît exagérée. Je dirais plutôt que notre
démocratie est toujours à parfaire, qu’elle éprouve des difficultés
observables d’ailleurs dans les autres démocraties et dont la résolution n’est
pas simple.
Je vais approfondir deux thèmes en particulier. Le premier est celui du
leadership démocratique. J’ai choisi ce thème parce que les organisateurs de
cette conférence ont identifié la perception d’une concentration excessive
du pouvoir, entre les mains du Premier ministre et de son entourage immédiat,
comme l'une des sources d’inquiétude au sujet de la santé de la démocratie
canadienne. Je vais vous exposer la façon dont je vois le lien entre la
démocratie et le leadership.
Mon deuxième thème est celui de la réforme institutionnelle en tant qu’antidote
au « malaise démocratique ». Les organisateurs de la
conférence ont fait part d’une hypothèse qui fait l'objet de nombreux
débats et selon laquelle des tendances inquiétantes, telle la baisse de la
participation électorale, pourraient être renversées si l’on remplaçait
carrément certaines de nos institutions, au premier chef le mode de scrutin
uninominal majoritaire à un tour. Je voudrais faire part de mon grand intérêt
pour cette hypothèse, mais aussi d’un certain scepticisme. La prudence est de
mise, car on pourrait faire plus de tort que de bien en procédant à des
changements institutionnels sans en avoir bien mesuré les conséquences.
En conclusion, je discuterai des valeurs. Le bon fonctionnement des
institutions est certes une dimension importante de l’avenir de la démocratie,
mais la transmission des valeurs civiques l’est au moins tout autant.
1. Démocratie et leadership
L’affirmation selon laquelle le pouvoir serait trop concentré entre les
mains du Premier ministre et de son entourage immédiat peut vouloir dire
deux choses : soit que le pouvoir est de plus en plus concentré par
rapport aux pratiques passées, soit qu’il est trop concentré par rapport à
une norme idéale.
En ce qui a trait à la première affirmation, la tendance à la
concentration dans le temps, je n’ai jamais rien lu qui la confirme. Les
ouvrages de Donald Savoie et de Jeffrey Simpson2
sont parfois captivants, mais ne m’apparaissent pas démontrer la thèse d’un
accroissement de la concentration du pouvoir au fil des ans. À leur lecture, je
ne trouve rien qui puisse convaincre que le Premier ministre et son entourage
immédiat, notamment le Bureau du Conseil privé et le Cabinet du Premier
ministre, accaparent plus de pouvoirs sous Jean Chrétien que ce n’était
le cas sous Brian Mulroney ou sous Pierre Elliott Trudeau.
Par contre, si je compare leurs descriptions avec des analyses portant sur
des périodes moins récentes – comme celle que fait Jack
Granatstein de l’ère Mackenzie King dans The Ottawa Men3
–, il est évident et indéniable que le pouvoir était bien plus concentré
entre quelques mains à l’époque qu’aujourd’hui. C’était sans commune
mesure avec ce que nous vivons. Le système politique était moins complexe, les
expertises plus rares, les contrôles sur le pouvoir bien moins nombreux.
Mais les attentes à l’égard de la démocratie changent. Nous exigeons
maintenant de nos élus un comportement bien plus irréprochable qu’autrefois.
Au regard de ces exigences, je sais que certains, y compris des libéraux qui
néanmoins admirent M. Chrétien, trouvent celui-ci trop autoritaire. Je crains
que sur ce sujet, mon expérience personnelle soit de peu d’utilité. Je n’ai
pas travaillé avec d’autres Premiers ministres que Jean Chrétien. Je n’ai
jamais même eu d’autre patron que lui; car un universitaire, c’est bien
connu, n’a pas de patron, exerçant la profession la plus libre qui soit.
Un jour, M. Chrétien m’a demandé si j’aimais travailler avec lui. J’ai
répondu : « Pas toujours ». Il m’a demandé pourquoi.
J’ai dit : « Parce que vous ne faites pas toujours ce que je
vous demande. » C’est vous dire à quel point mon jugement en la
matière n’est pas représentatif!
Si je n’ai collaboré de près qu'avec un seul Premier ministre, j’ai par
contre travaillé avec trois vice-premiers ministres, deux ministres des
Finances, trois ministres des Affaires étrangères, deux directeurs du Cabinet
du Premier ministre, trois greffiers du Conseil privé... Je peux vous confirmer
ce que chacun sait : le pouvoir se déplace beaucoup selon les personnes
qui l’exercent.
Le pouvoir est une notion particulièrement difficile à cerner. J’ai un
ami qui a travaillé dans des bureaux politiques sous Brian Mulroney. Il m’en
a raconté de toutes les sortes au sujet de la concentration du pouvoir. J’éviterais
pourtant de déduire de ses propos que le pouvoir n’a jamais été aussi
concentré qu’entre les mains de Brian Mulroney et de son entourage.
Mon directeur de thèse, le grand sociologue français Michel Crozier, m’a
enseigné que le pouvoir n’est pas une possession que certains ont et que d’autres
n’ont pas. Le pouvoir est une relation au sein de systèmes d’action
complexes4. En faire l’analyse n’est jamais
simple. C’est pourquoi j’inviterais à beaucoup de prudence avant de poser
des jugements péremptoires sur une supposée tendance à la concentration du
pouvoir au sein du gouvernement du Canada.
Quant à savoir si le pouvoir de nos premiers ministres est trop grand par
rapport à une quelconque norme idéale, il faudrait d’abord qu’on s’entende
sur la norme en question. Il est certain que la combinaison du parlementarisme
et du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour place le plus souvent
nos premiers ministres, tant au fédéral qu’au provincial, dans une position
qui leur permet de s’appuyer sur des majorités absolues à la Chambre. Cela
leur donne des assises plus solides que celles d’un président qui, comme aux
États-Unis ou au Mexique, doit composer avec les deux Chambres d’un Congrès,
ou celles d’un premier ministre à la tête d’une coalition gouvernementale
de partis élus à la proportionnelle, comme en Israël ou en Belgique.
Mais d’une part, il faut tenir compte du fait que, dans notre fédération
décentralisée, notre gouvernement fédéral dispose de moins de domaines de
compétence que les gouvernements nationaux des autres pays. Par conséquent,
pour recourir à une analogie sportive, notre Premier ministre joue sur une
patinoire moins grande que celle de ses homologues étrangers même s’il y
évolue en plus grande liberté.
D’autre part, je ne vois rien de suspect d’un point de vue démocratique,
dans le fait que nous soyons en mesure d’élire au Canada des gouvernements
stables formés habituellement d’un seul parti. On peut et on doit discuter
des avantages respectifs des régimes présidentiel et parlementaire, ou des
divers modes de scrutin, mais convenons que ces choix institutionnels demeurent
dans l’univers de la démocratie. Ils en expriment diverses modalités. Il est
certain que les modalités qui procèdent de notre mode de scrutin et de notre
parlementarisme favorisent l’exercice d’un leadership. Mais justement, la
démocratie et le leadership ne sont pas contradictoires.
D’ailleurs, je juge très approprié que ce soit dans le cadre de son Leardership
Forum annuel que l’Arthur Kroeger College of Public Affairs ait choisi
cette année comme thème l'état de la démocratie canadienne. En effet, dans
les démocraties représentatives, on conçoit généralement que l’élu doit
se comporter en leader, c’est-à-dire en décideur qui assume ses décisions.
On demande à l’élu d’agir selon sa conscience, en fonction de ce qu’il
estime être juste, souhaitable et faisable. On ne veut pas d’élus sans
conviction qui, telles des girouettes, suivent le vent de l’opinion publique,
ballottés au gré des sondages.
Je sais qu’une conception de la démocratie voudrait que l’élu se
conforme en tout temps aux préférences de la majorité de ses électeurs. Par
exemple, on dira que, s’il est contre la peine de mort, mais que la majorité
des électeurs de sa circonscription est pour, il doit voter pour la peine de
mort. Cette conception est présente dans les démocraties, mais elle ne m’apparaît
nulle part dominante. On reconnaît généralement à l’élu le droit, sinon
le devoir, de prendre des décisions impopulaires s’il estime qu'elles servent
le bien commun. À lui, le moment des élections venu, de convaincre ses
commettants de son discernement comme leader. Le système politique canadien
favorise l’expression d’un tel leadership et permet à l’électorat d’en
sanctionner l'exercice.
Il est vrai cependant que nous ne voulons pas que ces leaders que nous
élisons se comportent en dictateurs entre les élections. Le pouvoir des élus
est soumis au droit en démocratie. C’est pourquoi il n’y a pas de
démocratie sans état de droit. C’est par le droit que l’on fixe les
modalités d’élection, le partage des pouvoirs entre l’exécutif et le
législatif, l’indépendance du judiciaire, le partage des compétences dans
une fédération, les chartes qui protègent les droits et libertés, etc. Il y
a certainement place à amélioration, mais je crois que l’on peut dire que l’état
de droit se porte bien au Canada.
On exige aussi des leaders élus en démocratie le plus de transparence
possible. Rien de ce qu’ils font ne doit être dissimulé au public, sauf ce
que le respect de la vie privée et l’intérêt public exigent de garder
secret. Une démocratie comme le Canada raffine continuellement les mécanismes
qui favorisent cette transparence : les lois d’accès à l’information,
les rapports des vérificateurs généraux et des protecteurs du citoyen, etc.
Enfin, on souhaite aussi en démocratie que non seulement l’action des
leaders soit transparente, mais aussi qu’elle s’accompagne d’une
consultation et d’un dialogue riches et soutenus avec la population. Le leader
doit prendre ses décisions, fort d’une compréhension profonde des diverses
opinions qui prévalent parmi les citoyens, les groupes, les experts, etc. D’où
les audiences des commissions parlementaires, les livres blancs, les tournées
ministérielles, etc.
La démocratie est une œuvre constamment en voie de parachèvement. Le
ministre Boudria pourrait vous parler de tout ce que le gouvernement a fait en
ce sens depuis 1993 et vous décrire aussi les mesures à venir, tels un mandat
élargi pour le conseiller en éthique et l’important projet de loi sur le
financement des partis politiques. Quant à moi, je voudrais discuter de l’hypothèse
selon laquelle une amélioration significative de notre démocratie passerait
forcément par des changements institutionnels fondamentaux, dont un changement
de mode de scrutin.
2. Changer nos institutions? L’herbe n’est pas toujours plus verte chez
le voisin
Je suis avec beaucoup d’intérêt les débats qui ont cours au sujet de nos
institutions. Il est sain qu’elles soient continuellement remises en question.
Cela permet de mieux les comprendre, de les améliorer ou éventuellement de les
remplacer. Je me méfie cependant de tout emballement : il ne faut pas
placer des attentes inconsidérées dans les changements institutionnels.
Il est certain que nos institutions et nos politiciens ont moins la confiance
du public que ce n’était le cas il y a vingt, trente ou quarante ans.
Plusieurs sondages le confirment. Par exemple, en 1965, 49 % des Canadiens
estimaient que « le gouvernement ne se soucie pas de ce que les gens
pensent », proportion qui a grimpé à 53 % en 1979, à 63 %
en 1984, à 70 % en 1990, pour se stabiliser ensuite (le sondage que l’Arthur
Kroeger College a rendu public aujourd’hui indique une proportion de 68 %5).
Si, en 1979, 15 % des Canadiens disaient éprouver « très peu »
de respect à l’endroit de la Chambre des communes, cette proportion est
passée à 20 % en 1985, puis à 33 % en 19936.
Avant de conclure que nos institutions ont fait leur temps et qu’il faut
les changer, demandons-nous si ce problème de confiance est propre au Canada.
La réponse est non. On le retrouve dans des démocraties qui n’ont pas les
mêmes institutions que nous. Le taux de satisfaction par rapport à la façon
dont la démocratie fonctionne se situe, au Canada, dans la moyenne des autres
pays; il n’est ni particulièrement élevé ni particulièrement bas.7
Prenons l’exemple de la discipline de parti. Ceux qui affirment que nos
institutions parlementaires sont dépassées s’en prennent surtout à la
discipline de parti dont le tort, à leurs yeux, est d’empêcher le député
de défendre ses opinions et les intérêts de sa circonscription. Or, comme l’a
fait remarquer le politologue Louis Massicotte, le désenchantement envers les
élus n’est pas moins élevé aux États-Unis. Dans ce pays où il y a peu ou
prou de discipline de parti, à peine un cinquième de la population affirme
faire « énormément » ou « beaucoup »
confiance au Congrès.8
Je conviens qu’il faut réfléchir à l’importance accordée à la
discipline de parti au Canada. M. Chrétien a augmenté le nombre de votes
libres à la Chambre et peut-être faudrait-il le faire davantage. Mais il y a
quelque chose de valable dans le principe selon lequel des candidats qui se font
élire en équipe, sous la bannière d’un parti et avec un programme commun,
doivent travailler en équipe une fois élus. Si l’on devait laisser tomber ce
principe, je suis sûr que notre démocratie ne s’en porterait pas mieux et
que le public n’aurait pas davantage confiance en elle.
J’en viens maintenant à notre mode de scrutin uninominal majoritaire à un
tour. J’ai déjà souligné son grand avantage : il permet à un parti au
pouvoir d’exercer un leadership et d’en assumer les conséquences au moment
du vote. Mais ce mode de scrutin a aussi des inconvénients évidents. J’en
vois quatre surtout.
Premièrement, il rend possible l’accession au pouvoir d’un parti qui n’a
pas la pluralité des voix, comme c’est le cas dans ma province aujourd’hui.
Deuxièmement, il peut donner comme résultat électoral une opposition n’ayant
pas suffisamment de députés pour jouer son rôle. Troisièmement, il tend à
accentuer artificiellement la concentration régionale des formations politiques.
Par exemple, nous, les libéraux, détenons la presque totalité des sièges en
Ontario, bien que la moitié des Ontariens n’aient pas voté pour nous. Dans l’Ouest,
nous sommes sous-représentés au Parlement, bien que le quart de la population
ait voté pour nous.
Quatrièmement, il semble que ce mode de scrutin ait un effet légèrement
négatif sur la participation électorale, puisque les jeux paraissent faits à
l’avance dans un grand nombre de circonscriptions. La participation
électorale serait de quatre à cinq points de pourcentage plus élevée avec un
mode de scrutin à la proportionnelle.9
L’idéal serait de trouver une formule mixte qui permette de conserver les
avantages de notre mode de scrutin tout en éliminant ses faiblesses. Je suis
avec grand intérêt les recherches en ce sens. Mais là encore, je sens le
besoin de mettre en garde contre les attentes irréalistes.
Par exemple, s’il est vrai que le mode de scrutin à la proportionnelle
favorise une participation électorale légèrement plus élevée, les pays qui
l’ont adopté ont vu eux aussi cette participation décliner ces dernières
années10. Ils n’ont pas échappé à cette
tendance déplorable que nous connaissons trop bien au Canada.
Le manque de confiance du public envers la politique existe tout autant dans
les démocraties qui utilisent la proportionnelle. L’exemple de la Nouvelle-Zélande
est éloquent de ce point de vue. Ce pays a abandonné, en octobre 1996, le mode
de scrutin britannique pour une formule de représentation proportionnelle. Il y
a trois ans, le professeur Jonathan Boston, de la School of Government de l’Université
Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande), tirait de cette expérience une
conclusion guère encourageante, lui qui est pourtant favorable à ce mode de
scrutin : « [À en juger par l’expérience néo-zélandaise
à ce jour,] il convient de rejeter d’emblée les arguments voulant qu’une
réforme électorale puisse enrayer l’insatisfaction constitutionnelle que l’on
observe en ce moment dans un grand nombre de démocraties. En fait, une telle
réforme risque de simplement empirer les choses. » [traduction]11
Il faut aussi tenir compte des effets qu’un changement de mode de scrutin
aurait sur le type de fédéralisme décentralisé que nous avons. La plupart
des pays qui ont retenu la proportionnelle ont un seul parlement qui compte
vraiment. Chez nous, il y a peu de choses que notre gouvernement fédéral
puisse faire sans avoir à négocier avec les provinces. Lorsque nos quatorze
premiers ministres fédéral, provinciaux et territoriaux se rencontrent et qu’ils
conviennent d’une entente, comme ce fut le cas la semaine dernière à propos
des soins de santé, ils sont en mesure d’honorer cette entente. Ils n’ont
pas à la renégocier par la suite avec quatorze coalitions parlementaires.
Pour prendre un autre exemple, lorsque le gouvernement fédéral a voulu
mettre en place l’initiative sur le développement de la petite enfance, il
lui a fallu négocier pendant plus de deux ans avec les provinces et les
territoires. Imaginons le temps supplémentaire que cela aurait pris s’il lui
avait fallu négocier avec des gouvernements occupés à maintenir tant bien que
mal des coalitions parlementaires.
On parle parfois d’adopter au Canada le mode de scrutin en vigueur en
Allemagne, lequel laisse une large place à la proportionnelle. L’Allemagne ne
figure certes pas parmi les pays à un seul parlement « qui compte
vraiment », pour reprendre mon expression de tout à l’heure. Il reste
tout de même que le fédéralisme allemand est plus centralisé que le nôtre.
Sa constitution ou Loi fondamentale ne prévoit pas moins de 26
compétences concurrentes, et non pas seulement trois comme chez nous. Elle
établit aussi sept autres domaines où le parlement fédéral peut élaborer
des lois-cadres exigeant l’adoption par les länder de lois s’y
conformant. Une large part de l’action des länder consiste à
appliquer des lois fédérales qu’ils ont contribué à façonner par l’entremise
du Bundesrat, l’équivalent de ce que serait chez nous un sénat des provinces
s’il existait. En Allemagne, même les salaires des fonctionnaires des länder
et des municipalités doivent être conformes à des règles fixées par des
lois-cadres fédérales.
Je ne dis pas que nous n’avons rien à apprendre du fédéralisme à l’allemande.
Je maintiens simplement que si le système électoral allemand était instauré
au Canada, nous n’aurions pas nécessairement les résultats escomptés,
puisque nos institutions sont différentes.
Aujourd’hui, avec la mondialisation, non seulement notre gouvernement
fédéral doit-il négocier avec les provinces, mais il lui faut de plus en plus
s’engager dans des forums de décisions supranationaux. J’ai constaté que c’est
là un phénomène dont vous discutez dans l’un de vos groupes de discussion.
Dans un tel contexte, le Canada se voit plus que jamais obligé d’exercer un
leadership s’il veut promouvoir ses intérêts au pays comme à l’étranger.
Il ne faudrait pas qu’une réforme mal conçue du mode de scrutin n’entraîne
au Canada une situation analogue à ce que les Allemands appellent le « Die
Politikverflechtungs-Falle » (joint-decision trap), c’est-à-dire
un système trop lourd de prise de décision.12
Conclusion
En somme, je souhaite que l’on réfléchisse à l’amélioration de nos
institutions, éventuellement à leur remplacement, en faisant preuve d’une
grande ouverture d’esprit, mais aussi de prudence, car des réformes
inconsidérées nous feraient un grand tort. J’ajoute, en conclusion, que
notre réflexion doit porter non seulement sur nos institutions, mais aussi sur
les valeurs qui sont le fondement de la démocratie.
Reprenons l’exemple, très inquiétant, de la baisse de la participation
électorale, tendance qui affecte les démocraties, que leur régime soit
présidentiel ou parlementaire, ou que leur mode de scrutin fasse ou non une
place à la proportionnelle. Au Canada, il a été observé que cette baisse ne
se vérifie statistiquement que chez les jeunes, c’est-à-dire chez les
électeurs nés après 1970, en particulier parmi les jeunes les moins
scolarisés13 : « Au contraire, la
participation électorale est demeurée assez stable parmi les électeurs nés
avant 1970. »14 [traduction] Le même
phénomène semble se produire aussi aux États-Unis.15
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, rien n’indique que ces
jeunes soient nombreux à s’engager dans des formes alternatives d’action
politique. Ils sont simplement moins informés et moins intéressés par la
politique que les autres électeurs : « Il est clair que le manque
d’intérêt et d’information des électeurs nés après 1970 est un des
facteurs décisifs qui expliquent leur niveau élevé d’abstention. »
[traduction]16 De même, le sens de l’obligation
morale ou du devoir rattaché au vote est une valeur beaucoup moins ressentie
chez les jeunes que chez les électeurs plus âgés17.
Je ne serais pas surpris que le phénomène se vérifie aussi aux États-Unis et
en Europe.
Qu’en est-il donc de notre capacité – ou de notre incapacité – à
rejoindre et à intéresser ces jeunes? Nous aimerions tous connaître la
réponse, mais permettez que je risque une hypothèse. C’est Samuel Huntington18
qui a écrit que la démocratie porte en elle une éthique de l’anti-pouvoir.
Plus les valeurs de déférence et de respect de l’autorité perdent de leur
emprise sur les esprits au profit des valeurs démocratiques de liberté et d’égalité,
plus les populations se méfient de leurs gouvernants. Je crois qu’avant toute
chose, c’est cette dynamique des valeurs qui est à la source du « malaise
démocratique ».
Se pourrait-il que ce phénomène de déplacement des valeurs soit
particulièrement poussé chez les électeurs nés après 1970? Peut-être
sont-ils plus méfiants envers la politique que leurs aînés, sans être moins
démocrates pour autant? Quoi qu’il en soit, il faut trouver une façon d’établir
le contact avec eux, afin de les convaincre de s’intéresser à la politique
car elle, elle s’intéresse à eux.
Je souhaite donc que l’on s’interroge au moins autant sur la transmission
des valeurs civiques que sur le bon fonctionnement des institutions. C'est en
menant de front ces deux réflexions que des forums que le vôtre aideront le
Canada à progresser vers toujours plus de démocratie.
-
Ottawa, Commission du droit du Canada, Le renouvellement de la
démocratie : Les enjeux de la réforme électorale au Canada,
document de discussion, 2002, p. 43.
-
Donald J. Savoie, Governing from the Centre: The Concentration of
Power in Canadian Politics, Toronto, University of Toronto Press, 1999,
440 pages; Jeffrey Simpson, The Friendly Dictatorship, Toronto,
McClelland & Stewart, 2001, 238 p.
-
J. L. Granatstein, The Ottawa Men: The Civil Service Mandarins,
1935-1957, Toronto, University of Toronto Press, 1998, 333 p.
-
Michel Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système : les
contraintes de l’action collective, Paris, Éditions du Seuil, 1981,
436 p.
-
Sondage Pollara, Canadian Society Today, février 2003; voir aussi
André Blais, et al., Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the
Vote in the 2000 Canadian Election, Peterborough, Broadview Press, 2002,
p. 55.
-
J’ai discuté de ces résultats de sondage et d’autres sondages sur
le même sujet dans « La montée du cynisme : qui blâmer? »,
Revue parlementaire canadienne, hiver 1993-1994, pp. 33-35.
-
Richard Nadeau, « Satisfaction with Democracy: The Canadian
Paradox », dans Neil Nevitte (direct.), Value Change and Governance
in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2002, pp. 44-45.
-
Louis Massicotte, « Parliament: The Show Goes On, But the Public
Seems Bored », dans James P. Bickerton et Alain-G. Gagnon, (direct.) Canadian
Politics, Peterborough, Broadview Press, 2e éd., 1994,
p. 339.
-
André Blais et A. Dobrzynska, « Turnout in Electoral
Democracies », European Journal of Political Research, 1998,
33, pp. 239-261.
-
Anne-Marie Grenier, Le déclin de la participation électorale dans
les démocraties établies depuis 1961: l'influence du mode de scrutin,
mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de
l'obtention du grade de maîtrise en science politique, Université de
Montréal, 2002.
-
Jonathan Boston, « Institutional Change in a Small Democracy: New
Zealand’s Experience of Electoral Reform », allocution prononcée en
juin 2000 dans le cadre d’un colloque intitulé Le régime
parlementaire et le nouveau millénaire : continuité et changements
dans le systèmes d’origine britannique, organisé par le Groupe
canadien d’étude des questions parlementaires. Au cours d’une
conversation téléphonique, le 10 février 2003, le professeur Boston m’a
confirmé que cette conclusion peu encourageante est encore valable aujourd’hui.
-
Fritz W. Scharpf, « The Joint-Decision Trap: Lessons from German
Federalism and European Integration », Public Administration,
66, 1988, pp. 239-278.
-
Blais, et al, op. cit., pp. 46-50.
-
Ibid, p. 60.
-
Warren E. Miller et J. M. Shanks, The New American Voter,
Cambridge, Harvard University Press, 1996, 640 p., voir chapitre 3.
-
Ibid, p. 54.
-
Ibid, p. 58.
-
Samuel P. Hungtington, American Politics. The Promise of Disharmony,
Cambridge, Belknap Press, 1981, 303 p.

|