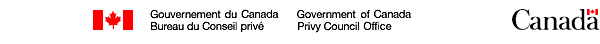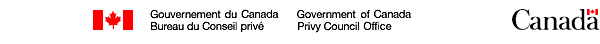« Nationalisme et démocratie
: l’avenir des systèmes décentralisés »
Notes pour une allocution
de l’honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
Allocution
prononcée dans le cadre du 25e anniversaire
de la Constitution espagnole
Madrid (Espagne)
le 21
novembre 2003
L’allocution prononcée fait foi
C’est avec émotion que
je prends la parole aujourd’hui, à l’invitation du président du Sénat,
son Excellence Juan José Lucas Giménez, à l’occasion de cette conférence
qui souligne le 25e anniversaire de la Constitution espagnole. Je
suis honoré et fier de commémorer avec vous la ratification de l’acte législatif
grâce auquel, il y a un quart de siècle, l’Espagne entrait dans le monde,
alors très restreint, des démocraties.
L’émotion que je
ressens aujourd’hui est semblable à celle que j’ai éprouvée le 13 novembre
2002, lorsque l’Université Carlos III de Madrid m’a décerné un doctorat honoris
causa, doctorat que j’ai d’ailleurs reçu des mains mêmes de l’un des
« Pères de la Constitution » espagnole, le recteur, M. Gregorio Peces-Barba
Martinez. À cette occasion, j’ai fait part d’une conviction qui m’habite,
et que je réitère aujourd’hui, soit que l’un des événements les plus déterminants
du XXe siècle aura été la démocratisation de l’Espagne.
En effet, rappelons-nous
à quel point était difficile la situation des démocraties au milieu des années
1970. L’Amérique latine, l’Afrique, l’Asie, l’Europe de l’Est et une
partie de l’Europe méditerranéenne étaient sous la férule de régimes
autoritaires ou totalitaires. Dans des pays comme la France ou l’Italie,
environ le quart des électeurs accordait son suffrage à des partis ouvertement
hostiles à la démocratie pluraliste. De telles idées pénétraient les
syndicats et les universités de toutes les démocraties occidentales. La démocratie
américaine, elle, était discréditée par les séquelles de la guerre du
Vietnam et la crise du Watergate.
Or, ce qui s’est passé,
au cours des années qui suivirent, fut tout le contraire d’un rétrécissement
de l’espace démocratique et de la liberté individuelle. L’humanité a
connu l’un des phénomènes les plus positifs de toute son histoire :
l’avancée fulgurante de la démocratie sur tous les continents. Et d’où
cet ébranlement mondial est-il parti? De la Grèce, du Portugal, de l’Espagne,
en somme de la Méditerranée, éternel berceau de la civilisation.
Je pense depuis longtemps
que l’un des héros du XXe siècle aura été votre roi, Sa Majesté
Juan Carlos I. Plutôt que d’écouter les voix fatalistes qui clamaient que
les peuples latins n’étaient pas faits pour la démocratie, il a cru au
destin démocratique d’une Espagne prête à assumer son pluralisme. Ce
faisant, ce n’est pas seulement le destin de l’Espagne qui s’est joué; on
peut croire que c’est peut-être, aussi, celui de l’humanité. Car c’est
simplifier à peine que de dire que, lorsqu’il est devenu clair que
l’Espagne ne reviendrait pas en arrière et deviendrait démocratique, les
Latino-Américains se sont dit : Nous en sommes aussi capables que les Espagnols!
Et c’est ainsi que la
grande vague démocratique a déferlé sur tous les continents au point de
mettre à bas le mur de Berlin. Il n’y a rien eu d’inéluctable dans cet
heureux développement, qui n’est le résultat d’aucun déterminisme de
l’histoire. Il a été plutôt l’œuvre de femmes et d’hommes courageux,
à l’image de votre roi. Aussi, aujourd’hui, plutôt que de tenir ce progrès
pour acquis, nous devons nous efforcer de toujours solidifier davantage la démocratie
et les valeurs sur lesquelles elle se fonde.
C’est précisément sur
l’un des grands enjeux démocratiques de notre temps que vous m’invitez à
me pencher aujourd’hui. Le thème qui m’a été proposé par le Sénat est
le suivant : Nationalisme et démocratie : l’avenir des systèmes décentralisés.
En d’autres mots, vous me demandez dans quelle mesure la décentralisation est
le moyen de faire cohabiter dans l’harmonie des populations différentes au
sein d’un même État démocratique.
Cette question est certes
pertinente pour l’Espagne et le Canada, deux démocraties qui composent avec
le pluralisme des identités collectives. Mais quantité d’autres États sont
dans le même cas. Alors qu’il n’y a pas deux cents États à l’ONU, on dénombre
dans le monde, selon les estimations, entre 3 000 et 5 000 groupes humains se
reconnaissant chacun une identité collective. Autrement dit, l’humanité
n’a pas le choix : à moins de faire exploser la planète en une poussière
d’unités ethniques, il faut apprendre à vivre ensemble au sein d’États
pluralistes. La croyance voulant que toute population ayant ses caractéristiques
propres doive avoir son propre État est terriblement fausse. En plus d’être
impraticable, elle est erronée sur le plan moral, car elle rejette le fait que
la cohabitation des cultures au sein d’un même État aide les humains à
devenir de meilleurs citoyens en leur permettant de vivre l’expérience de la
tolérance. Je vous laisse le soin de parler pour l’Espagne, mais je suis
persuadé que mon pays a le devoir de montrer au monde que le pluralisme des
identités est une force pour un État, et non une faiblesse.
En fait, vous m’invitez
à discuter de l’enjeu même qui m’a poussé à accepter l’invitation que
m’a faite le Premier ministre du Canada, le très honorable Jean Chrétien, de
faire partie de son Cabinet à titre de ministre des Affaires
intergouvernementales, responsabilité que j’assume depuis huit ans. Je suis
persuadé que ce qui constitue la principale force et la vraie grandeur du
Canada est sa capacité de rassembler des populations différentes autour
d’objectifs communs. L’idée-force qui m’a convaincu de quitter
l’université pour me lancer dans la politique active est celle des identités
plurielles. En tant que Québécois et que Canadien, j’affirme que, dans cette
ère de mondialisation, quand on a la chance d’avoir différentes identités,
on les accepte toutes. Quand on peut s’appuyer sur des concitoyens qui nous
ouvrent à d’autres registres culturels, à d’autres expériences et à
d’autres atouts que ceux dont on dispose soi-même, on accepte leur aide et on
leur offre la nôtre. Le vrai choix, pour moi, n’est pas d’être ou Québécois
ou Canadien. Il n’est pas entre le Québec ou le Canada. Il est d’être Québécois
et Canadien, plutôt que Québécois sans le Canada. Les identités, cela
s’additionne, cela ne se soustrait jamais.
Mais alors comment faire,
comment s’y prendre pour que des populations différentes par la langue, la
religion, la culture vivent dans la confiance et l’harmonie leur appartenance
commune à un même État démocratique? Vous m’invitez à répondre à cette
question en centrant ma réflexion sur les concepts de décentralisation et de
nationalisme. Je vais vous donner mon opinion personnelle sur la façon dont ces
deux concepts peuvent s’agencer de façon optimale en démocratie. Mais je
vais aussi envisager le scénario moins heureux, celui de la rupture : que doit
faire une démocratie si l’une de ses populations demande de quitter l’État
pour en former un nouveau qui lui soit propre?
1. Décentralisation
et nationalisme en démocratie
La première chose que je
dirais est qu’une démocratie libérale, de par sa Constitution comme dans la
pratique, doit avant tout être fondée sur les droits individuels, et non sur
les appartenances collectives, qu’on les appelle peuples, nations ou autrement.
La raison en est simple : seules les personnes en chair et en os existent concrètement,
elles seules sont capables de sentiments, de liberté, de bonheur.
La décentralisation des
pouvoirs publics peut aider au bonheur des individus. Elle leur facilite la
participation aux affaires de la cité et leur permet d’expérimenter des
solutions différentes selon les contextes. Mais il faut bien voir que la
centralisation aussi comporte des avantages pour eux. Un État centralisé est
bien placé pour rassembler les moyens d’action et faire prévaloir l’égalité
des droits entre concitoyens. La recherche de l’équilibre optimal entre la
centralisation et la décentralisation est l’objet d’un débat permanent en
démocratie, qu’il s’agisse d’un État fédéré comme le Canada ou régionalisé
comme l’Espagne.
Cela dit, cette recherche
d’un équilibre efficace entre la centralisation et la décentralisation se
doit de tenir compte du fait que les individus sont des être sociaux. Ils
entretiennent ou développent des affinités du fait qu’ils partagent des
traits communs. Certaines de ces affinités tiennent à la langue, à la culture
ou à la religion et se traduisent en identités collectives. Il faut prendre en
compte ces identités collectives, non pas pour nier les droits individuels,
mais pour permettre aux citoyens de mieux se réaliser et s’épanouir.
Par exemple, si, dans une
région donnée, une population parle une langue autre que celle utilisée dans
le reste du pays, ou si elle a une tradition juridique quelque peu différente,
les pouvoirs publics devront être agencés de façon à répondre aux besoins
particuliers de cette population. L’objectif ne doit pas être de couper cette
population du reste du pays. Au contraire, l’objectif doit être de permettre
à cette population de s’épanouir et de contribuer à sa façon au
renforcement de l’ensemble du pays.
C’est ainsi que l’on
obtient l’unité dans la diversité et que l’on tient compte des identités
plurielles d’une façon qui renforce le sentiment d’appartenance à
l’ensemble du pays. Procéder autrement, renoncer à la primauté des droits
individuels, aménager le pays d’abord et avant tout en fonction de représentations
collectives identitaires telles que les définiraient les pouvoirs publics,
serait une erreur. Il faut prendre en compte les identités collectives, qu’on
peut appeler peuples, nations ou autrement, mais sans postuler une uniformité
factice entre les individus qui forment chacune de ces constructions
collectives. C’est ma conviction qu’on ne peut pas s’appuyer sur la
diversité en niant sa dimension la plus fondamentale, soit la différence inaliénable
qui fait de chaque individu, de chaque personne humaine, un être unique.
Les nationalismes peuvent
être une bonne chose, dans la mesure où ils inspirent une meilleure entraide
au sein d’un groupe humain, dans un esprit d’ouverture aux autres groupes.
Mais ils deviennent une force nuisible et potentiellement dangereuse lorsqu’on
ne voit plus qu’eux comme principe d’organisation politique et sociale,
lorsqu’ils fournissent la seule grille idéologique à travers laquelle est
perçue la vie en société. Ils s’apparentent alors aux fondamentalismes
religieux qui, tout comme ces nationalismes exacerbés, constituent la plus
grande menace à la démocratie et à la sécurité internationale. La valeur
suprême doit demeurer l’individu en chair et en os, et non ses appartenances
collectives.
Permettez que
j’illustre mon propos en prenant pour exemple les relations entre le Québec
et le Canada. Le Québec est la seule province majoritairement francophone au
Canada. Le voisinage des États-Unis donne à la langue anglaise une énorme
force d’assimilation. Dans de telles conditions, on conçoit facilement que le
Québec francophone sera toujours nationaliste. De ce point de vue, il
m’importe peu que les Québécois soient définis comme un peuple distinct, ou
une nation au sein du Canada, ou une société unique en son genre, ou une
nationalité, pour reprendre un terme utilisé dans votre Constitution. Ce qui
compte pour moi, c’est que les sept millions d’individus qui résident au Québec
trouvent dans leur pays, le Canada, un appui pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Je veux que les Québécois, en retour, forts de leur identité spécifique, de
leur culture propre, de leur amour du Québec, aient toutes les possibilités
d’aider pleinement les autres Canadiens.
Passons en revue les
principales mesures que le Canada a prises qui répondent aux besoins
particuliers des Québécois. Le français est, avec l’anglais, l’une des
deux langues officielles du Canada. Le Parlement fédéral se doit de
fonctionner aussi bien en français qu’en anglais. Le gouvernement fédéral
se doit d’offrir des services en français partout où le nombre le justifie,
ce qui inclut l’ensemble du Québec. Il déploie des efforts particuliers pour
la promotion de la culture d’expression française au Canada, au point qu’il
investit plus dans ce secteur au Québec que le gouvernement provincial et
toutes les municipalités réunis. Le gouvernement du Québec, lui, a mis en
place sa propre politique linguistique. La Loi constitutionnelle de 1982
prévoit que le gouvernement du Québec a le droit constitutionnel de limiter
l’accès à l’école anglaise aussi longtemps qu’il le jugera souhaitable,
afin de mieux protéger la langue française dans le contexte nord-américain.
Le Québec et le Nouveau-Brunswick ont le statut de gouvernement participant au
sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce qui n’est pas
le cas des autres provinces canadiennes.
La tradition juridique du
Québec est différente de celle du reste du pays : le Québec utilise le droit
civil alors qu’ailleurs, c’est la common law qui prévaut. Cette spécificité
juridique québécoise est reconnue dans la Constitution canadienne. C’est
pourquoi d’ailleurs trois des neuf juges de la Cour suprême sont des
avocats de droit civil du Québec.
Le Québec dispose
d’une large autonomie, à titre de province canadienne, car le Canada est une
fédération décentralisée si on en juge par la force de son deuxième ordre
de gouvernement. Comparativement à la Constitution d’autres fédérations,
celle du Canada reconnaît peu de pouvoirs concurrents et nos provinces ont
d’importantes compétences législatives qui leur sont propres. Avec le temps,
les provinces ont aussi accru leurs recettes fiscales en comparaison de celles
du gouvernement fédéral. Par ailleurs, les transferts de fonds du gouvernement
fédéral aux provinces sont assortis de peu de conditions.
De plus, le Québec
s’est prévalu davantage que les autres provinces des possibilités
qu’offrent la Constitution canadienne ou les ententes fédérales-provinciales
en termes d’autonomie provinciale. Ainsi, au niveau des impôts sur le revenu
des particuliers, tandis que toutes les autres provinces ont des accords de
perception fiscale avec le gouvernement fédéral, le Québec est seul à s’être
doté d’un régime distinct. En matière de pension, le Québec a son propre régime
tandis que les autres provinces ont préféré adhérer au régime fédéral. Le
Québec et l’Ontario ont leurs propres forces policières, alors que les
autres provinces font appel à la Gendarmerie royale du Canada pour obtenir des
services de police à contrat. Au Québec, le système d’immigration est différent
de celui des autres provinces car le gouvernement du Québec a conclu une
entente bilatérale avec le gouvernement fédéral dans ce domaine de compétence
partagée. En matière de formation professionnelle, le Québec a choisi une
pleine marge d’autonomie alors que d’autres provinces ont préféré la
cogestion avec le gouvernement fédéral.
Cette large autonomie
dont dispose le Québec n’empêche aucunement les Québécois de jouer
pleinement leur rôle dans les institutions communes du Canada. D’ailleurs le
Premier ministre du Canada a presque toujours été un Québécois au cours des
35 dernières années.
Faut-il au Québec plus
d’autonomie au sein du Canada? Beaucoup de Québécois le pensent et ce sera
certainement un débat permanent au Canada, de la même façon que vous débattrez
toujours en Espagne des aménagements appropriés pour chacune de vos communautés
autonomes. Je fais simplement valoir ici que la bonne façon d’envisager les
choses est de toujours placer en priorité les besoins des citoyens, ceux qui
habitent le Québec comme ceux qui résident ailleurs au Canada. Mais ce n’est
pas ainsi que raisonnent certains nationalistes québécois qui font passer leur
conception de la nation avant les intérêts des citoyens. Ils affirment que,
puisque le Québec forme une nation, le gouvernement fédéral doit céder à
celui du Québec un grand nombre, sinon la totalité, de ses pouvoirs. Ils
revendiquent ces transferts de pouvoir sans examiner les conséquences qu’ils
auraient pour les citoyens du point de vue de la qualité du service public.
Par exemple, dans le
domaine de la politique de la santé, le gouvernement fédéral assortit son
assistance financière aux provinces de cinq conditions, qui se résument au
principe suivant : au Canada, l’accès aux soins de santé n’est pas
fonction de l’épaisseur du porte-monnaie du patient. Or, certains
nationalistes québécois exigent que ce transfert de fonds fédéraux soit
inconditionnel dans le cas du Québec, non pas parce qu’ils sont contre le
principe en question, mais parce qu’ils estiment que par définition, le Québec
formant une nation, le gouvernement du Québec n’a pas à respecter de normes
nationales canadiennes. Autrement dit, ils subordonnent les droits des patients
à leur conception de la nation. Pour ma part, je ne vois pas en quoi le fait
que les Québécois aient une identité collective qui leur soit propre devrait
signifier qu’ils aient moins de garantie d’accès aux soins de santé que
les autres Canadiens.
Certains nationalistes
veulent dépouiller le gouvernement fédéral de ses pouvoirs non pas pour améliorer
le service public, mais parce qu’ils souhaitent la séparation du Québec du
Canada. Ils veulent se détacher du Canada et non le renforcer. Je suis persuadé
qu’on ne calme pas le séparatisme à coups de transferts de pouvoirs. Ce que
les séparatistes veulent, ce ne sont pas des pouvoirs à la pièce, c’est un
État qui leur soit propre.
En somme, l’équilibre
entre la centralisation et la décentralisation doit être recherché en
fonction du strict intérêt des citoyens, dans une logique de service public.
Mais cet intérêt doit inclure les besoins variés des citoyens en fonction de
leurs appartenances collectives. L’approche que je préconise consiste à
mettre l’accent sur le besoin d’améliorer toujours davantage un pays dont
tous les citoyens puissent être fiers, un pays démocratique et prospère dont
les populations les plus diversifiées puissent s’épanouir avec leurs
cultures et leurs institutions propres tout en travaillant ensemble à des
objectifs communs. Telle est la meilleure façon, à mon avis, d’obtenir
l’unité dans la diversité.
Mais que faire si, malgré
tous ces efforts, une population devait exprimer clairement sa volonté de se séparer?
C’est la question à laquelle je vais maintenant tenter de répondre.
2. Démocratie
et sécession
Dans quelques États démocratiques,
il existe des partis politiques qui, de façon tout à fait pacifique, par la
voie démocratique, cherchent à faire sécession. Je vais traiter ici de ces
revendications sécessionnistes pacifiques qui appuient sans réserve un débat
démocratique libre de toute coercition. Dans une société démocratique, tout
acte terroriste, pour quelque cause politique que ce soit, réduit ceux qui
l’utilisent à de simples criminels de droit commun justiciables avec toute la
rigueur de la loi. Ce ne sont certes pas des héros ou des patriotes. La seule
question que je pose est la suivante : comment une démocratie doit-elle réagir
à une revendication sécessionniste parfaitement pacifique?
La réponse qu’il
convient de donner à cette question en Espagne ne concerne que les Espagnols,
tout comme l’unité canadienne ne concerne que les Canadiens. Le Canada se félicite
des relations fructueuses et d’amitié chaleureuse qu’il entretient avec une
Espagne forte et unie, mais il ne s’ingère ni n’intervient dans les
affaires internes espagnoles. La question qui se pose est plutôt de savoir
s’il existe des principes universels susceptibles de guider les démocraties
lorsqu’elles sont confrontées à des demandes sécessionnistes pacifiques.
Votre pays se considère
comme indivisible, caractère qui est enchâssé dans l’article 2 de votre
Constitution : « La Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de
la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions
qui la composent et la solidarité entre elles. » D’ailleurs, plusieurs
autres démocraties bien établies se déclarent indivisibles dans leur
Constitution, de manière explicite ou implicite. Citons par exemple la France,
les États-Unis, l’Italie, l’Australie et bien d’autres démocraties qui
affirment former des entités indissolubles.
Le principe sur lequel se
fonde cette indivisibilité est facile à comprendre. C’est celui-là même
qu’évoque l’article 2 de votre Constitution : la solidarité, celle qui lie
ensemble tous les citoyens et toutes les régions d’un pays. On peut tout à
fait convenir que les citoyens d’une démocratie sont liés par un principe de
solidarité ou de loyauté mutuelle. Ils se doivent tous assistance sans égard
à des considérations de race, de religion ou d’appartenance régionale. Pour
cette raison, tous les citoyens sont, en quelque sorte, propriétaires de
l’ensemble du pays, avec son potentiel de richesses et de solidarité humaine.
Aucun groupe de citoyens ne peut prendre sur lui de monopoliser la citoyenneté
sur une partie du territoire national, ni de retirer à des concitoyens, contre
leur volonté, leur droit de pleine appartenance à l’ensemble du pays. Ce
droit d’appartenance, chaque citoyen devrait être en mesure de le transmettre
à ses enfants. Idéalement, un tel droit ne devrait jamais être remis en cause
en démocratie. Voilà sans doute pourquoi tant de démocraties se considèrent
comme indivisibles.
Puisque la loyauté relie
tous les citoyens par-delà leurs différences, aucun groupe de citoyens dans un
État démocratique ne peut s’arroger de droit à la sécession sous prétexte
que ses attributs particuliers – langue, culture ou religion – le qualifient
au titre de nation ou de peuple distinct au sein de l’État. Comme l’a écrit
la Cour suprême du Canada à propos du Québec dans son avis sur le Renvoi
relatif à la sécession du Québec du 20 août 1998 : « Quelle que
soit la juste définition de peuple(s) à appliquer dans le présent contexte,
le droit à l’autodétermination ne peut, dans les circonstances présentes [celles
d’un État démocratique], constituer le fondement d’un droit de sécession
unilatérale. »1
Mais, en même temps, on
ne peut écarter la possibilité qu’en démocratie des circonstances se
produisent qui font de la négociation d’une sécession la moins mauvaise des
solutions envisageables. Cela pourrait être le cas advenant qu’une partie de
la population manifeste clairement, de façon pacifique mais résolue, sa volonté
de ne plus faire partie du pays. Il est en effet des moyens qu’un État démocratique
ne saurait envisager pour retenir contre sa volonté clairement exprimée une
population concentrée sur une partie de son territoire.
Autrement dit, la sécession
n’est pas un droit en démocratie, mais elle demeure une possibilité à
laquelle l’État existant peut consentir devant une volonté de séparation
clairement affirmée.
Telle est la position que
la Cour suprême du Canada a prise dans son avis du 20 août 1998.
Elle confirme que le gouvernement du Québec n’a pas le droit d’effectuer la
sécession unilatéralement. Il n’a pas le droit de se proclamer, unilatéralement,
gouvernement d’un État indépendant. Il n’a pas ce droit, ni en vertu du
droit canadien ni au regard du droit international.2 Comme vous le savez, en droit international, le droit à l’autodétermination des
peuples ne peut pas constituer le fondement d’un droit à l’autodétermination
externe, c’est-à-dire d’un droit de faire sécession unilatéralement, sauf
dans les situations coloniales, d’occupation militaire ou de violation grave
des droits humains. Outre ces cas extrêmes, le droit à l’autodétermination
s’applique dans les limites accordées à l’intégrité territoriale des États.3
La Cour suprême confirme
qu’une sécession, pour être légale au Canada, nécessiterait une
modification de la Constitution canadienne. Une telle modification exigerait la
négociation d’« une multitude de questions très difficiles et très
complexes », y compris, éventuellement, celle des frontières
territoriales.4 L’obligation
d’entreprendre une telle négociation sur la sécession n’existerait qu’à
la suite d’un appui clair à la sécession, exprimé au moyen d’une majorité
claire et en réponse à une question claire. Seul un tel appui clair donnerait
à la demande sécessionniste suffisamment de légitimité démocratique pour
justifier l’obligation d’une négociation sur la sécession. Le gouvernement
du Québec n’aurait toujours pas le droit d’effectuer unilatéralement la sécession
même après des négociations infructueuses de son point de vue. « En vertu
de la Constitution, la sécession exige la négociation d’une modification.
»5
Le Parlement du Canada a
adopté, le 29 juin 2000, la Loi donnant effet à l’exigence de clarté
formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi relatif à
la sécession du Québec. Cette loi, plus simplement appelée « loi sur la
clarté », que j’ai eu l’honneur de parrainer au Parlement canadien, a fait
du Canada le premier grand État démocratique à admettre sa divisibilité par
un texte législatif. Elle précise les circonstances dans lesquelles le
gouvernement du Canada pourrait entreprendre une négociation sur la sécession
de l’une de ses provinces. Elle interdit au gouvernement du Canada
d’entreprendre une négociation sur la sécession d’une province à moins
que la Chambre des communes ait constaté que la question référendaire a porté
clairement sur la sécession et qu’une majorité claire s’est prononcée en
faveur de la sécession.
Le gouvernement du Canada
affirme qu’il ne saurait s’engager dans une procédure de scission du pays
et abdiquer ses propres responsabilités constitutionnelles envers les Québécois
– ou envers la population de toute autre province canadienne – sans avoir
l’assurance que c’est ce qu’ils veulent clairement. En fait, aucun État démocratique
ne saurait cesser d’honorer ses responsabilités envers une partie de sa
population en l’absence d’un appui clair à la sécession.
Le gouvernement du Canada
n’accepterait d’entreprendre une négociation sur la sécession que dans
l’hypothèse où la population d’une province manifesterait clairement sa
volonté de ne plus faire partie du Canada. Cette volonté claire de sécession
devrait s’exprimer par une majorité claire appuyant une question portant
clairement sur la sécession et non sur un vague projet de partenariat politique.
S’il est exclu d’entreprendre une négociation sur la sécession à moins
qu’elle ne soit appuyée par une majorité claire, et non incertaine et
fragile, c’est que la sécession est un acte grave et probablement irréversible,
qui engage les générations futures et qui entraîne des conséquences majeures
pour tous les citoyens du pays qui se fait ainsi scinder. La question référendaire
aussi doit être claire, car il coule de source que seule une question portant
vraiment sur la sécession permet de savoir si les citoyens souhaitent la sécession.
La négociation sur la sécession
devrait se dérouler dans le cadre constitutionnel canadien et devrait être
guidée par la recherche réelle de la justice pour tous. Par exemple, dans
l’hypothèse où des populations territorialement concentrées au Québec
demanderaient clairement de rester rattachées au Canada, il faudrait envisager
la divisibilité du territoire québécois avec le même esprit d’ouverture
que celui qui a conduit à accepter la divisibilité du territoire canadien.
La loi sur la clarté précise
aussi les éléments qui devront obligatoirement figurer au menu de la négociation
: « Aucun ministre ne peut proposer de modification constitutionnelle
portant sécession d’une province du Canada, à moins que le gouvernement du
Canada n’ait traité, dans le cadre des négociations, des conditions de sécession
applicables dans les circonstances, notamment la répartition de l’actif et du
passif, toute modification des frontières de la province, les droits, intérêts
et revendications territoriales des peuples autochtones du Canada et la
protection des droits des minorités. »6
Telle est la façon
canadienne d’envisager la sécession en démocratie. Sa prémisse fondamentale
est qu’une sécession ne peut s’effectuer de façon unilatérale en démocratie.
Elle suppose forcément une négociation constitutionnelle. Un État démocratique
ne saurait entreprendre une telle négociation que si la sécession est appuyée
clairement. Un État démocratique ne saurait autoriser la sécession qu’après
qu’une telle négociation ait été dûment complétée, dans le respect du
droit établi et de la justice pour tous.
Conclusion
J’ai fait valoir
aujourd’hui que l’équilibre entre la centralisation et la décentralisation
doit être recherché en fonction de l’intérêt des citoyens. J’ai ajouté
que ceux-ci sont des êtres sociaux qui ont des attaches collectives dont on
doit tenir compte. Ainsi conçu, le nationalisme peut être une force positive
qui incite les concitoyens à mieux s’entraider au sein de leur pays, dans le
respect de leurs identités plurielles et de leur identité commune.
J’ai aussi examiné la
façon dont les revendications sécessionnistes pacifiques peuvent être traitées
en démocratie. Je ne suis pas sans savoir, de ce point de vue, que tant
l’avis de la Cour suprême du Canada sur la sécession du Québec que la loi
sur la clarté qui donne effet à cet avis sont connus en Espagne et qu’on y
fait référence de différentes façons dans votre débat national. Ils sont
d’ailleurs devenus une référence dans plusieurs autres démocraties.
Tout ce que je peux vous
dire, c’est que, dans le cas du Canada, cet exercice de clarification a eu un
effet bénéfique sur l’unité nationale. Car, justement, s’il y a une chose
qui ressort clairement, sondage après sondage, c’est qu’en réponse à une
question claire les Québécois choisissent le Canada uni. Les Québécois, dans
une grande majorité, désirent rester Canadiens et ne veulent pas briser les
liens de loyauté qui les rattachent à leurs concitoyens des autres parties du
Canada. Ils ne souhaitent pas être forcés de choisir entre leur identité québécoise
et leur identité canadienne. Ils rejettent les définitions exclusives des mots
« peuple » ou « nation » et veulent appartenir à la fois au
peuple québécois et au peuple canadien, dans ce monde global où le cumul des
identités sera plus que jamais un atout pour s’ouvrir aux autres.
C’est José Carreras
qui a dit :« Cuanto más catalán me dejan ser, más español me siento
».7 Eh bien!
plus Québécois nous sommes, plus nous nous sentons Canadiens.
- Avis
de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi relatif à la sécession duQuébec,
[1998] 2 R.C.S. 217, au par.125.
- Ibid, au par.155.
- Antonio Cassese, Self-determination of peoples: a legal reappraisal,Cambridge,
Cambridge University Press, 1995; James Crawford,La pratique des États
et le droit international relativement à la sécessionunilatérale, rapport
d’expert présenté à la Cour suprême du Canada,19 février 1997; voir
aussi : avis de la Cour suprême du Canada sur leRenvoi relatif à la sécession
du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217,aux par.113 à 139.
- Avis de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi relatif à la sécession duQuébec,
op. cit., au par. 96.
- Ibid., au par. 97.
- Loi de clarification, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée
parla Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi relatif à lasécession
du Québec, sanctionnée le 29 juin 2000, ch. 26, par. 3 (2).
- José Carreras, « Cuanto más catalán me dejan ser, más español mesiento »,
El Mundo, vol. VII, numéro 2, 26 août 1995, disponible àl’adresse
suivante :
http://www.el-mundo.es/papel/hemeroteca/1995/08/26/uve/

|