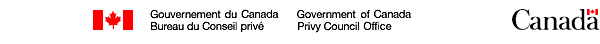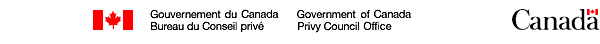|
« LE DÉFICIT ZÉRO : NOTRE OBJECTIF À TOUS »
NOTES POUR UNE
ALLOCUTION DEVANT
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
THÉRESE-DE BLAINVILLE
SAINTE -THÉRESE (QUÉBEC)
LE 20 MAI 1998
Les finances publiques : tel est mon sujet d'aujourd'hui. Oui, vous avez bien
compris, je n'ai pas dit : la Constitution, tel est mon sujet d'aujourd'hui.
Remarquez que vous n'y gagnez pas forcément au change, car les deux sujets
peuvent rivaliser d'aridité. Mais à l'époque pas si lointaine où
j'enseignais les finances publiques à l'université, mes étudiants trouvaient
que je savais rendre cette matière intéressante. Alors voyons si j'aurai le
même succès auprès d'un auditoire de gens d'affaires qui en connaissent long
sur le sujet.
Je ne suis pas que le ministre de la
Constitution. En fait, en tant que ministre des Affaires intergouvernementales,
j'épaule mes collègues du gouvernement pour tout ce qui touche le
fonctionnement de la fédération, y compris le fédéralisme fiscal. J'ai aussi
reçu du Premier ministre Jean Chrétien le mandat de conseiller le gouvernement
en matière d'unité canadienne. Or, justement, je crois qu'on n'a pas souligné
suffisamment le lien entre les finances publiques et l'unité canadienne.
Après vous avoir expliqué comment je vois ce
lien, j'en examinerai plus à fond un aspect précis, le moins agréable, soit
celui des coûts de l'incertitude politique. Mais auparavant, je vais planter le
décor en dressant l'état des finances publiques au Canada.
J'espère qu'à la suite de cet exposé il
apparaîtra clairement que le déficit zéro, ou du moins l'assainissement des
finances publiques, est notre objectif à tous au Canada et que nous y
parviendrons mieux si nous décidons résolument de rester ensemble.
1. Le redressement des finances publiques
Nous, Canadiens, voulons à la fois la liberté
et la douceur, allier l'initiative individuelle et la solidarité sociale,
combiner ce qu'il y a de meilleur des États-Unis et de l'Europe. Mais nous ne
sommes pas en Europe, nous sommes en Amérique du Nord, voisins d'un géant qui
nous soumet à une formidable concurrence culturelle, économique, fiscale et
monétaire. Dans ce contexte, et étant donné nos ambitions tant en termes de
qualité de vie que de justice sociale, une grande rigueur est de mise dans la
gestion de nos finances publiques. Sans cette discipline, nous n'aurons pas les
moyens de nos ambitions, et la pauvreté et la détresse sociale continueront de
faire des ravages.
Nous avons manqué de rigueur budgétaire lors de
notre histoire récente et nous en avons payé le prix. Nous avons dû procéder
à un difficile redressement financier. Bien qu'il soit trop tôt pour crier
victoire, le chemin déjà parcouru est impressionnant.
En 1993-1994, le déficit combiné des
gouvernements fédéral et provinciaux, tel qu'il a été calculé par le
ministère des Finances, représentait 62 milliards de dollars canadiens, soit
8,6 % de notre Produit intérieur brut (PIB). Selon l'OCDE, nous occupions le 7e
rang pour ce qui est du déficit le plus élevé parmi 22 pays industrialisés.
Telle était la situation il y a à peine quelques années. En comparaison, en
1998, le Canada est le seul pays à avoir atteint l'équilibre budgétaire selon
les projections de l'OCDE. On constate le progrès réalisé.
La réduction du déficit a été le fait des
deux ordres de gouvernement. Le déficit du gouvernement fédéral a
complètement fondu, tandis que cinq provinces sont parvenues à équilibrer
leur budget ou à dégager des surplus, trois ne sont que légèrement en
déficit, l'Ontario se permet des baisses d'impôt et le Québec poursuit son
avancée vers le déficit zéro. Toutes les dix étaient dans le rouge en
1993-1994.
Les Canadiens ont dû faire des sacrifices pour
atteindre ce résultat. Le plus formidable est que nous y sommes parvenus en
préservant l'essentiel de nos programmes sociaux, en contenant l'inflation, en
relançant l'emploi et la croissance et en gardant le poids du fardeau fiscal
dans l'économie sous la moyenne des pays de l'OCDE. L'efficacité de la lutte
au déficit a favorisé la baisse des taux d'intérêt sans laquelle la
croissance n'aurait pas été au rendez-vous.
De 1994 à 1997, le Canada a connu une croissance
annuelle moyenne de son PIB de 2,9 %, la plus forte du G-7 et au 14e rang des 29
pays de l'OCDE. La croissance annuelle moyenne de l'emploi a été de 1,8 %, la
meilleure performance (ex aequo avec les États-Unis) des pays du G-7 et au 9e
rang des pays de l'OCDE. Le taux de chômage est passé de 11,4 % en septembre
1993 à 8,4 % en avril 1998, soit le taux le plus bas au Canada depuis août
1990. Depuis le début de 1997, 543 000 emplois ont été créés. Dans
l'ensemble, c'est là une performance remarquable pour un pays qui, durant les
mêmes années, a éliminé l'un des pires déficits des pays industrialisés.
Maintenant que les finances sont assainies, les perspectives sont très
encourageantes : l'OCDE nous prédit la plus forte croissance économique des
pays du G-7 pour 1998 et 1999.
Par ce redressement financier, le Canada s'est
placé en meilleure position pour faire face aux grands défis économiques et
sociaux de cette fin de siècle. Et ces défis sont pressants, qu'il s'agisse de
la création d'emplois, de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration de
notre système de santé ou du renforcement de notre compétitivité. Le dernier
budget Martin témoigne du souci d'accroître nos efforts dans ces secteurs,
mais sans céder à la fringale dépensière.
Il nous faut maintenir notre discipline. Les
baisses d'impôt et les nouvelles mesures de dépenses doivent être bien
ciblées. N'oublions pas que l'endettement de l'ensemble du secteur public
canadien se chiffre à 806 milliards de dollars, dont 583 incombent au
gouvernement fédéral et 223 aux provinces. Cet endettement public total
équivaut à 97 % de notre PIB pour l'exercice 1997-1998. Il s'agit d'un ratio
dette totale-PIB parmi les plus élevés des pays de l'OCDE. Seules l'Italie, la
Belgique et la Grèce sont plus endettées que nous.
Cette année, sur un dollar d'impôt que vous
avez envoyé à Ottawa, 29 cents vont être consacrés au service de la dette.
Pour un dollar à Québec, c'est 18 cents. Si nous ne jugulons pas notre
endettement, ces ratios vont demeurer trop élevés et limiteront pendant trop
longtemps la marge de manoeuvre dont nous pourrions disposer pour financer nos
programmes et alléger le fardeau fiscal des citoyens.
Les surplus budgétaires qui se dégagent dans
certaines provinces et au gouvernement fédéral sont trop précieux pour qu'on
les dilapide selon une perspective à courte vue. Les perturbations économiques
en Asie nous rappellent qu'un ralentissement économique est toujours possible,
les catastrophes naturelles qui semblent plus fréquentes nous coûtent cher, le
Vérificateur général nous demande de mieux planifier nos finances en fonction
du vieillissement de la population. Nous aurons besoin de finances publiques
saines pour faire face à tous ces phénomènes de longue portée et à bien
d'autres encore. Et plus que jamais, nous aurons besoin d'un Canada uni.
2. Les finances publiques et l'unité
canadienne
Je suis persuadé que l'idée que les Québécois
se font de l'économie canadienne influence leur opinion sur l'unité canadienne.
Ce n'est pas le seul facteur qui influence leur jugement, mais c'en est un
assurément.
Les débats constitutionnels difficiles de
l'après-Lac Meech ont coïncidé avec la récession économique qui a frappé
l'est du continent nord-américain au début des années 1990. De nombreux
Québécois se sont mis à douter non seulement de leur place dans le Canada,
mais du Canada lui-même. Avec la montée du chômage, avec des finances
publiques qui s'enfonçaient de plus en plus dans le rouge, et tandis que le
Wall Street Journal nous déclarait candidats au tiers monde, plusieurs
Québécois en ont déduit que le Canada était un échec économique. «Le
Canada ne marche plus», entendait-on répéter.
On évoquait des «études» selon lesquelles la
fédération nous coûtait des «milliards de dollars» en dédoublements
inutiles entre ordres de gouvernement. Ces fameuses études étaient bien sûr
mythiques, mais nombreux étaient ceux de nos concitoyens qui y croyaient dur
comme fer. «Sortez-les, ces études», avait lancé Jacques Parizeau à Daniel
Johnson lors du débat télévisé de la campagne électorale de 1994. Une fois
au pouvoir, M. Parizeau n'a trouvé qu'une pile de documents qui ne prouvaient
rien.
Aujourd'hui que notre redressement économique et
financier nous vaut l'admiration des autres pays, maintenant qu'on le décrit
comme une sorte de miracle -- «the maple leaf miracle» selon l'expression du
Business Week, ou le «top dog» du G-7 selon le Financial Times -- les
Québécois, comme les autres Canadiens d'ailleurs, reprennent confiance dans le
Canada.
Il convient de relativiser les choses : le Canada
du début des années 1990 n'était pas en «faillite». Mais il prenait la
pente d'un dangereux déclin. Comme plusieurs autres pays, nous nous étions mis
en difficulté et il nous fallait trouver en nous-mêmes la capacité d'en
sortir. Nous avons su nous donner une nouvelle discipline et faire jouer les
atouts enviables que nous procure notre union.
Vous en connaissez beaucoup, vous, des pays qui
ont autant de potentiel que le Canada? Regardez notre ouverture sur le monde,
avec nos deux langues officielles qui sont des langues internationales, avec
notre population multiculturelle qui nous donne prise sur tous les continents,
avec notre position géographique qui nous place entre l'Europe, les États-Unis
et l'Asie. Comme gens d'affaires, vous savez à quel point votre appartenance au
Canada vous ouvre des portes.
Mais saviez-vous que le Forum économique mondial
place maintenant le Canada au 4e rang pour sa compétitivité sur 53 pays, qu'il
occupe le 3e rang sur 92 pays pour l'abondance de ses ressources naturelles
selon la Banque mondiale, que l'Institute for Management Development nous classe
2e sur 46 pays pour la qualité de nos ressources humaines et 6e pour la
qualité de notre infrastructure?
Un Québec indépendant n'aurait pas le même
potentiel. Il serait «viable», bien sûr. Mais nous, les Québécois, comme
les autres Canadiens, avons de grandes ambitions pour notre qualité de vie.
Nous aussi aspirons à rien de moins qu'au meilleur de l'Europe et au meilleur
des États-Unis. Pour nous rapprocher de cette aspiration, et faire reculer le
chômage et la pauvreté, il faut nous appuyer sur le potentiel de capacités et
de talents que le Canada réunit.
Ce pays nous appartient en entier comme à tous
les Canadiens. Nous y avons suffisamment contribué : il est le nôtre. Il faut
accepter l'aide des autres Canadiens et continuer de leur accorder la nôtre.
Eux non plus ne pourraient se passer de nous sans perdre beaucoup. Ainsi, par
exemple, le redressement financier des dernières années est l'oeuvre de tous
les Canadiens, mais s'il fallait nommer ses trois principaux artisans, ce
seraient trois Québécois : Jean Chrétien, Paul Martin et Marcel Massé.
Ce n'est aucunement déprécier le génie
québécois, la culture québécoise, l'identité québécoise que de soutenir
que nous nous en sortirions moins bien sans un Canada uni. J'avancerais la même
chose à propos de toutes les provinces canadiennes, y compris les plus riches.
Le professeur Roger Gibbins, président de la Canada West Foundation, a publié
récemment une étude qui montre à quel point l'Alberta serait affectée
négativement par la séparation du Québec. En fait, nous serions tous perdants.
M. Lucien Bouchard, c'est son droit, pense
différemment. Il affirme que le fédéralisme canadien nuit à l'économie
québécoise. En quoi au juste? Il a livré, ces dernières années, trois
réponses difficilement conciliables.
D'abord, lors de la campagne électorale
fédérale de 1993, ce fut la thèse du Canada au bord de la «faillite». Les
Québécois devaient sortir du train canadien avant le déraillement. «S'ils
(les Canadiens hors-Québec) ont l'intention de faire faillite, tant pis pour
eux. Mais nous allons sauver notre peau», affirmait-il le 14 août 1993.
Puis, premier virage : lors du référendum de
1995, c'est l'effort d'assainissement des finances publiques qui est devenu la
cible des critiques de M. Bouchard. Voter «Oui», expliquait-il, c'était se
protéger contre le «vent froid» des compressions qui soufflait en provenance
du Canada anglais.
Devenu premier ministre, M. Bouchard ne pouvait
plus dénoncer les compressions, puisqu'il était dans l'obligation d'en faire.
Il lui a donc fallu effectuer un autre virage : après le pays en faillite,
après le vent froid, voilà le déficit zéro. M. Bouchard s'est mis à
répéter que l'atteinte du déficit zéro, pour le gouvernement du Québec,
serait le signal que le Québec peut devenir souverain, la preuve qu'il nous
faut la souveraineté. Parmi une série de déclarations du genre, notons
celle-ci, rapportée dans Le Droit du 20 décembre 1996 : «Je suis assuré que
si l'objectif du déficit zéro est atteint et qu'on déclenche un référendum,
nous allons l'emporter».
En clair, selon M. Bouchard, il ne faut plus
faire la souveraineté pour échapper aux compressions, mais faire les
compressions pour parvenir à la souveraineté. Et on atteindra cette cible
exigeante, le déficit zéro, dans un pays qui aurait dû logiquement faire
faillite. M. Bouchard est vraiment le maître des virages. Mais il n'y a aucune
logique à son raisonnement. Si vraiment la fédération nous nuit, si elle est
injuste et inefficace, alors il faut en sortir au plus tôt pour mieux atteindre
le déficit zéro. Voilà ce que devrait dire M. Bouchard s'il était logique
avec lui-même. Mais il sait qu'à peu près personne ne le suivrait. Voilà
pourquoi il s'appuie aujourd'hui sur le Canada pour nous convaincre, demain,
d'en sortir. Belle contradiction.
Entre-temps, M. Bouchard tape sur le gouvernement
fédéral à tout propos. Quand les choses vont mal, c'est «la faute au
fédéral». Quand elles vont mieux, c'est malgré le fédéral. Sa principale
accusation est celle du pelletage : le gouvernement fédéral aurait pelleté
son déficit dans la cour des provinces. En toute justice, il faut admettre que
ce reproche est aussi lancé, avec plus ou moins d'insistance, par les autres
premiers ministres provinciaux. Permettez que je résume la réponse du
gouvernement fédéral à ces reproches qui lui sont faits :
° Le premier budget Martin a concentré les
compressions au niveau des dépenses fédérales directes et a même majoré les
transferts aux provinces. Mais, en même temps, M. Martin faisait connaître aux
provinces la baisse des transferts à laquelle elles devaient s'attendre pour
les années à venir. Il leur donnait le temps de s'ajuster et leur garantissait
une base de financement prévisible. Le gouvernement du Québec, lui, a non
seulement été prévenu à l'avance de la baisse des transferts fédéraux, il
en a même exagéré l'ampleur dans ses prévisions budgétaires. Le premier
budget Landry a comptabilisé des transferts fédéraux de 1,7 milliard de
dollars plus élevés au cours des exercices 1995-1996 à 1997-1998 que ceux qui
avaient été prévus dans le budget Campeau, à la veille du référendum.
° Une autre mesure qui a aidé les provinces fut
la réunion en une seule enveloppe des principaux transferts fédéraux en
matière de santé, d'aide sociale et d'éducation postsecondaire. Elles
obtenaient ainsi une marge de manoeuvre budgétaire additionnelle.
° Le gouvernement fédéral a pris soin de ne
pas soumettre la péréquation à ce plan de compressions, ce qui a grandement
aidé les provinces moins riches dont le Québec, qui reçoit actuellement 47 %
de ces paiements de péréquation -- soit 4 milliards de dollars pour l'exercice
1998-1999.
° En définitive, de 1993-1994 à 1998-1999, les
coupures auront été moins importantes dans les transferts aux provinces (7,4
%) que dans les dépenses de programmes directes du gouvernement fédéral (10,8
%). Les coupures les plus importantes ont été effectuées notamment dans les
domaines de la défense (30,2 %), de l'aide internationale (20,0 %) et des
transports (60,9 %). La fonction publique fédérale a subi une diminution de 51
000 postes et les salaires des fonctionnaires fédéraux ont été gelés
pendant six ans, de 1991 à 1997.
° Les finances des provinces ont par ailleurs
profité de la baisse des taux d'intérêt qui a été favorisée par le
redressement des finances fédérales. Le gouvernement du Québec, à lui seul,
a pu économiser un total d'un milliard cinquante millions de dollars au cours
des trois derniers exercices financiers, selon l'estimation du ministère des
Finances rendue publique dans le dernier budget Martin.
° Et maintenant que sa situation financière
s'améliore, le gouvernement fédéral se fait une priorité d'aider les
provinces : elles se voient directement attribuer 38 % des nouvelles initiatives
de dépenses (i.e. dépenses additionnelles ou compressions abandonnées)
prévues dans le dernier budget Martin.
° Le plan de compressions fédéral a été
équitable pour toutes les provinces, compte tenu de leur richesse respective.
Ainsi, le gouvernement du Québec continuera de recevoir, d'année en année,
environ 30 % des principaux transferts fédéraux aux provinces. Si le Québec
n'avait reçu que l'équivalent de sa part de la population en transferts
fédéraux, ceux-ci auraient été de 1,8 milliard de dollars moins élevés en
1998-1999. Ces transferts se chiffrent à 10,4 milliards de dollars pour
l'exercice 1998-1999, soit plus que ceux de toute autre province au Canada. Ils
représentent près de 3 360 $ par ménage québécois (1 400 $ par personne).
C'est 14 % de plus que la moyenne canadienne de 2 950 $ par ménage.
° Certaines provinces ont réduit leurs propres
transferts plus rapidement et plus fortement que le gouvernement fédéral. Par
exemple, la baisse des transferts fédéraux entre les années financières
1993-1994 et 1998-1999 représente 3,0 % de l'ensemble des dépenses de
programmes du gouvernement du Québec (soit une baisse de 1,1 milliard $ sur des
dépenses compressibles de 35,4 milliards $), alors que ce dernier exige de ses
municipalités, dans un délai beaucoup plus court, un effort qui correspond à
environ 5,8 % de leurs dépenses de programmes (pourcentage dont la source est
un communiqué du ministre des Affaires municipales du Québec, émis le 20
octobre 1997). � Tel est le point de vue du gouvernement fédéral sur
l'histoire récente de notre fédéralisme fiscal. Cela n'épuise pas le sujet,
je l'admets. Les provinces affirment, par exemple, que la comptabilité
fédérale est fautive puisqu'elle prend en compte la croissance de la valeur
des points d'impôt et non les seuls transferts de fonds. Elles ont oublié que
ce sont elles qui, en 1977, ont suggéré ce type de comptabilité. (Les
Arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux - Proposition des provinces,
réunion des ministres des Finances et trésoriers des provinces, les 6 et 7
décembre 1976.)
Ce sont là des questions que j'aimerais examiner
avec vous plus à fond si j'en avais le temps. Mais je me limiterai pour cette
fois-ci à souligner que de telles difficultés entre gouvernements se posent
inévitablement en période de réduction du déficit, que des difficultés
semblables se sont produites entre les États australiens et Canberra, pour
prendre comme exemple une autre fédération qui a accompli un redressement
financier, et que personne là-bas n'a vu la solution dans l'éclatement du
pays.
J'ajouterai que le gouvernement du Canada n'a pas
dû être aussi dur qu'on le prétend envers les provinces puisque cinq d'entre
elles ont atteint l'équilibre budgétaire avant lui. Seules les deux grandes
provinces prévoient toujours des déficits substantiels dans leurs budgets.
Mais le gouvernement de l'Ontario a choisi de baisser ses impôts de 4,6
milliards de dollars et de retarder l'atteinte du déficit zéro. Il reste le
cas du gouvernement du Québec. Comment expliquer que son redressement financier
soit à la traîne de celui des autres provinces?
3. L'hypothèque référendaire
Je viens de reprocher à M. Bouchard de faire du
fédéral le grand fautif, l'explication commode de toutes les difficultés du
Québec. Je ne vais pas tomber dans le manichéisme inverse et voir la source de
nos problèmes dans la seule incertitude politique engendrée par le projet
sécessionniste. Je ne nie pas que des causes structurelles expliquent en bonne
partie que le Québec présente l'un des pires bilans économiques et financiers
au Canada. En effet, selon les données les plus récentes, le Québec est la
province :
° qui, en général, impose le plus grand
fardeau d'impôts personnels sur ses habitants - et qui, après la Saskatchewan,
impose le plus important fardeau fiscal pour l'ensemble des impôts;
° dont le déficit par rapport à son Produit
provincial brut est le plus élevé après l'Ontario;
° qui, après trois provinces de l'Atlantique, a
accumulé la dette la plus lourde par rapport à son Produit provincial brut;
° qui consacre la plus grande part de ses
revenus au service de la dette après la Nouvelle-Écosse;
° qui paye les intérêts les plus élevés sur
ses emprunts : depuis le début de 1997, il doit notamment payer environ 50
points de base de plus que le gouvernement fédéral sur des obligations de 30
ans en dollars canadiens; même Terre-Neuve (avec des primes d'environ 40
points) paye moins cher;
° qui enregistre le taux de chômage le plus
élevé après les provinces de l'Atlantique (avril 1998);
° dont le revenu par habitant est le cinquième
plus faible de toutes les provinces -- de 13 % inférieur à la moyenne
canadienne;
° qui obtient la troisième plus mauvaise note
du point de vue de sa part des investissements canadiens (18,7 %) par rapport à
son poids démographique (24,7 %);
° qui a enregistré, tout comme Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, une croissance économique
inférieure à la moyenne canadienne durant chacune des trois dernières
années;
° qui a le taux de pauvreté -- ou plus
précisément de faible revenu -- le plus élevé de toutes les provinces : 21,6
% comparativement à une moyenne canadienne de 17,6 %.
Tout en admettant que d'autres causes de la
sous-performance de l'économie québécoise entrent en jeu -- telles le
vieillissement d'une partie de la structure industrielle et le déplacement de
l'activité économique vers l'ouest -- il m'apparaît clair que l'incertitude
politique est une entrave importante. Je ne vois pas comment l'incertitude
politique pourrait avoir des effets négatifs partout où elle se produit dans
le monde, sauf au Québec.
Les Québécois, eux, le perçoivent ce coût;
dans une proportion de huit sur dix (83 %), ils estiment que l'incertitude
politique nuit à l'économie (EKOS, avril 1998).
«Montréal est la seule grande ville du Canada
et des États-Unis qui doit composer avec l'incertitude politique, ce qui a un
impact important sur sa compétitivité», notait en octobre 1996 un comité de
dirigeants d'entreprise présidé par Brian Levitt.
«La levée provisoire de l'hypothèque
référendaire a, par ailleurs, permis une détente des taux d'intérêt
canadiens à court terme inférieurs aux taux américains», écrivait le
ministère de l'Économie de France dans un document publié lors d'une visite
de M. Bouchard dans ce pays, en septembre 1997.
Les efforts que M. Bouchard déploie cette
semaine aux États-Unis visent à calmer les inquiétudes que suscite son projet
indépendantiste, ce qui lui vaut de récolter quelques encouragements
diplomatiques. Mais au-delà, les commentaires des gens d'affaires américains
montrent à quel point cette inquiétude est persistante.
Par exemple, le président de la firme
d'investissement Palmer Partners, M. John A. Shane, a déclaré : «Ce qui
refroidit un peu les choses depuis 20 ans, c'est l'action séparatiste.» M.
Shane a ajouté que les choses seraient plus faciles si le premier ministre
Bouchard mettait de côté ses intentions quant à un autre référendum sur la
souveraineté. [Traduction libre]
M. Ken Rossano, président du New England-Canada
Business Council a pour sa part indiqué : «Le monde des affaires aime ce qui
peut être prédit. Avec ce genre de projet, rien ne garantit la stabilité de
votre investissement dans cinq ou 10 ans.» [Traduction libre]
M. Andre Danesh, un banquier investisseur de
Brooklyn, a dit : «Il y a beaucoup d'inquiétude parmi les investisseurs
américains [...]. Si jamais le Québec venait à se séparer, que se
passerait-il ensuite? Que personne ne le sache constitue un désavantage.»
[Traduction libre]
Le premier ministre Bouchard lui-même a admis
que l'incertitude politique entraînait un coût économique. Il déclarait à
l'émission Le Point, le 21 mars 1996 : «Ça se peut, je ne le nie pas, qu'il y
a des investisseurs étrangers qui disent, bien attendons que les choses soient
réglées à Montréal et au Québec». Il confiait, le 20 février 1997, que
«les financiers qui nous prêtent nous regardent avec un drôle d'air, parce
qu'ils n'ont pas tellement confiance».
M. Bouchard est cependant contredit par son
ministre des Finances, M. Bernard Landry, qui affirmait le 7 avril dernier, en
visant plutôt, il est vrai, M. Jean Charest : «Ceux qui commencent leur
carrière politique au Québec en disant que l'économie ne va pas bien parce
qu'on a des référendums font des affirmations grossièrement erronées et
qu'aucun chiffre ne soutient. Les chiffres soutiennent même le contraire». À
l'appui, M. Landry a cité notamment les données de Statistique Canada qui
annoncent une bonne année pour les investissements au Québec en 1998. Cette
bonne nouvelle ne saurait faire oublier que la part du Québec dans les
investissements canadiens n'est plus que de 18,7 % alors qu'elle représentait
22,3 % en 1990.
Récemment, Standard and Poor's a annulé son
avertissement négatif touchant la cote de crédit du gouvernement du Québec.
M. Landry en a attribué le mérite à son gouvernement, mais sans dire que l'un
des facteurs positifs mentionnés par Standard and Poor's est, et je cite,
«moderating support for the sovereignty option mitigates potential economic and
political uncertainty». Ma traduction : «L'appui de plus en plus modéré pour
l'option souverainiste a pour effet d'atténuer l'incertitude économique et
politique potentielle».
Ce n'est pas la première fois qu'une agence de
cotation se dit préoccupée par l'incertitude politique que nous nous
infligeons à nous-mêmes. Ainsi, en décembre 1997, Standard and Poor's
constatait que l'économie de Montréal était sérieusement ralentie par
l'incertitude politique. En juillet 1996, Standard and Poor's révisait à la
baisse la cote du Québec et invoquait, là encore, l'incertitude politique.
Moody's a également noté récemment (novembre 1997, mai 1997) non seulement
qu'il serait nécessaire de revoir la cote du Québec en cas d'éventuels
changements fondamentaux de son statut politique au sein du Canada, mais aussi
que l'impact de l'incertitude quant au statut du Québec s'étend jusqu'aux
autres provinces et au gouvernement fédéral.
L'incertitude politique est indéniablement
nuisible à l'économie. Partout dans le monde, la perspective d'une sécession
entraîne en elle-même un cortège d'incertitudes, une perturbation politique
et sociale majeure. Aucune loi sociologique ne nous prémunit contre cette
règle universelle.
Du reste, pensons à toute cette énergie
gaspillée par ces référendums à répétition. Rappelons-nous que par deux
fois, en 1980 et en 1995, le gouvernement péquiste a tenté d'acheter à grands
frais, à même nos impôts, le vote des employés du secteur public. S'étant
lui-même mis dans une situation financière impossible, il lui a fallu
reprendre sa mise après le référendum en affrontant ses alliés d'hier, les
chefs syndicaux, ce qui a aggravé les tensions sociales au Québec.
Certains indépendantistes admettent que
l'incertitude politique nuit à notre économie, mais ils ajoutent que le moyen
d'en faire disparaître les effets négatifs est de voter «Oui». Car après
une victoire du «Oui», disent-ils, il n'y aurait plus d'incertitude politique,
les Québécois ayant fait leur choix. Je ne comprends pas comment ils peuvent
prendre au sérieux leur propre raisonnement. Il est évident que ce n'est pas
tant l'indécision comme telle qui inquiète surtout les agents économiques, ce
sont les conséquences d'un après-Oui. On doit bien se rendre compte, pour peu
qu'on y réfléchisse, qu'elles nous précipiteraient dans un nouvel univers
d'incertitudes : fiscales, monétaires, commerciales et autres. Car enfin, si
les agents économiques voyaient d'un bon oeil la sécession, ou s'ils la
percevaient de façon neutre, il est évident que l'incertitude politique ne
nous nuirait pas. Les agents économiques se diraient qu'ils ont le choix entre
la situation actuelle et une situation équivalente ou améliorée après un
«Oui».
Alors soyons plus précis. Plutôt que
d'incertitude politique, parlons de possibilité de sécession et convenons que
cette possibilité nuit à notre économie. Sans elle, il y aurait moins de
chômage, moins de pauvreté, plus d'investissement, et la lutte au déficit
serait plus avancée et moins pénible.
En 1995, M. Parizeau savait très bien que la
victoire du «Oui» comportait de grands risques économiques. Il voulait
utiliser 17 milliards de dollars de nos épargnes pour tenter, bien en vain, de
calmer les marchés. Bien sûr, il nous avait caché l'existence de ce plan
«O».
t dire qu'aujourd'hui, M. Bouchard prétend que
c'est la déclaration de Calgary qui est dangereuse pour les Québécois. Il en
serait drôle s'il ne jouait pas avec leurs sous.
Conclusion
Il est vrai que l'économie québécoise a ses
faiblesses structurelles. Mais elle réunit aussi des forces enviables, comme en
témoigne la réorientation réussie des industries manufacturières en
direction de la haute technologie. Ce n'est pas au député de Saint-Laurent que
l'on peut faire douter de l'économie québécoise! Le gouvernement du Canada
est fier d'en être un partenaire majeur. D'une certaine façon, que l'économie
québécoise ait réussi à en accomplir autant, malgré l'incertitude
politique, montre à quel point elle a du ressort.
Incluse dans l'ensemble de l'économie
canadienne, elle représente un potentiel extraordinaire. Pensons à la synergie
que nous créerions si nous la libérions de la menace de sécession. Pour cela,
il nous faut à Québec un premier ministre et un gouvernement qui croient au
Canada. Un premier ministre et un gouvernement qui croient à la destinée du
Québec au sein d'un Canada uni. Un premier ministre et un gouvernement
déterminés à faire jouer à fond le génie québécois et l'entraide
canadienne.
Les Québécois, dans leur grande majorité, ne
veulent plus de référendum, paraît-il. Ils ont bien raison.
L'allocution prononcée fait foi

|