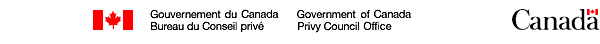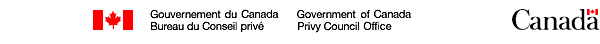|
«Tocqueville et les vertus
civiques du nationalisme»
Notes pour une allocution
de l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
lors d'une conférence
parrainée par la
Conférence pour l'étude des idées politiques
en collaboration avec
l'Association canadienne de science politique
Québec (Québec)
le 29 juillet 2000
L'allocution prononcée
fait foi
Entre 1988 et 1995, alors que j'étais professeur de science politique à
l'Université de Montréal, j'ai publié cinq études sur la pensée d'Alexis de
Tocqueville(1). J'ai cherché à mettre en
lumière comment ce grand esprit a tenté de concilier deux systèmes de pensée
qui interpellent la société québécoise à laquelle j'appartiens : le
libéralisme et le nationalisme.
En relisant Tocqueville, non seulement ses trois grandes oeuvres, soit les deux
tomes De la démocratie en Amérique et L'ancien régime et la
Révolution, mais aussi ses écrits sur le Canada français et sur
l'Algérie, j'ai recherché pour moi-même une façon d'être nationaliste
québécois et canadien qui soit en plein accord avec mes valeurs libérales.
Bien sûr, il n'est pas question de tirer à moi ce penseur du XIXe
siècle. Personne ne peut savoir ce qu'il dirait de notre question nationale
telle qu'elle se pose aujourd'hui. Je veux simplement partager avec vous ma
lecture de son oeuvre et les conclusions qu'elle m'inspire. En m'invitant à
cette conférence, le professeur James Moore m'en donne
l'occasion et je tiens à l'en remercier.
Je montrerai d'abord comment la conciliation que Tocqueville recherche entre le
libéralisme et le nationalisme débouche sur le thème même de votre
conférence : l'éducation civique. Ensuite, après avoir énuméré les dangers
que Tocqueville voit dans le nationalisme, j'indiquerai les vertus civiques
qu'il lui attribue, avant d'en venir aux conclusions que j'en tire du point de
vue de mon propre engagement politique.
1.
Libéralisme et nationalisme
Pour plusieurs libéraux, libéralisme et nationalisme sont incompatibles. Ils
voient dans le nationalisme un danger pour la liberté individuelle. Ils
font valoir que la finalité, l'investissement suprême de valeurs, doit être
l'individu en chair et en os, et non la nation conceptualisée comme un corps.
Un monde où les citoyens ne sont que les instruments de la nation, où ils
appartiennent à celle-ci avant de s'appartenir à eux-mêmes, un tel monde
répugne à l'esprit libéral.
Tocqueville, lui, a voulu concilier libéralisme et nationalisme. Comme l'a
écrit Raymond Aron : «Grandeur de la patrie, liberté des citoyens,
ce prince de l'esprit ne renonçait ni à l'une ni à l'autre(2)
.»
Libéral, Tocqueville veut que la finalité de l'ordre social soit la liberté
individuelle : «Je veux que les principes généraux du
gouvernement soient libéraux, que la part la plus large possible soit laissée
à l'action des individus, à l'initiative personnelle(3)
.» Nationaliste, Tocqueville poursuivra toute sa vie l'idéal
d'une nation française forte. Il sera un penseur, un député et un ministre
nationaliste, colonialiste aussi.
Tocqueville croit qu'à certaines conditions, le nationalisme peut être porteur
de vertus civiques nécessaires à la société démocratique et libérale. Il
est moins conscient que nous, témoins du XXe siècle, pouvons
l'être des dangers du nationalisme, des terribles dérives auxquelles il peut
donner cours, mais il les entrevoit tout de même. Malgré ces dangers, il croit
à la possibilité de ce que nous appelons un nationalisme civique.
C'est ici que nous rencontrons le thème même de votre conférence : «Citoyenneté,
conscience et éducation politique». Il convenait qu'une telle conférence
consacre l'une de ses séances à la pensée d'Alexis de Tocqueville. La
préoccupation majeure qui se dégage de l'oeuvre de Tocqueville est
précisément la citoyenneté en société démocratique.
Tocqueville recherche les moyens de renforcer l'engagement des individus envers
les sociétés dont ils font partie. Il craint que la démocratie ne dégénère
en égoïsme asocial. Pour contrer ce mal, parmi les remèdes qu'il préconise
figure, aux côtés de la religion et de la décentralisation administrative, le
patriotisme. À certaines conditions, pense-t-il, l'amour de la patrie, ou ce
que nous appelons le nationalisme - Tocqueville n'utilisait pas ce terme - peut
servir et non menacer l'éducation civique et la liberté
individuelle.
2. Les
dangers du nationalisme
Bien qu'il ne peut anticiper ni l'ampleur ni les formes exactes des dérives
autoritaires auxquelles le prétexte de l'impératif de la nation conduira,
Tocqueville perçoit certains vices auxquels peut mener l'idéalisation du
thème national.
«La volonté nationale est un des mots dont les intrigants de tous les
temps et les despotes de tous les âges ont le plus largement abusé(4)
.» La démocratie, estime Tocqueville, n'oppose pas un rempart
infranchissable à une exploitation démagogique de l'attachement national.
D'une certaine façon, elle la favorise en renforçant le sentiment d'appartenir
à une nation plutôt qu'à une classe sociale. En effet, explique-t-il,
l'évolution vers plus de mobilité sociale et d'égalité des conditions entre
les individus brise les castes et fait apparaître avec plus de netteté la
nation comme référent collectif. Les classes et les corps aristocratiques qui
reliaient comme une longue chaîne les paysans au roi étant disloqués, «c'est
toujours à la nation tout entière, et au nom de la nation tout entière que
l'on parle» (5) .
Le danger d'une manipulation démagogique du thème national en démocratie est
d'autant plus réel, selon Tocqueville, que l'orgueil national endort l'esprit
critique dont les démocraties ont tant besoin. Le nationaliste tend à rejeter
toute critique contre son pays comme une attaque personnelle, à ne plus voir
les failles de la société à laquelle il s'identifie(6)
.
De plus, fait-il valoir, l'amour de la patrie est naturellement conservateur,
confondu avec «le goût des coutumes anciennes»(7)
. Si ce préjugé pour la tradition et la conformité convient «quand
la société repose doucement sur un ordre des choses ancien»(8)
, il peut empêcher les peuples de voir où loge leur intérêt dans un
monde en bouleversement rapide. Ainsi, Tocqueville estime que les Américains
ont intérêt à préserver leur union fédérale, et il déplore que cette «nation
idéale qui n'existe pour ainsi dire que dans les esprits» soit
perpétuellement menacée d'éclatement par la poussée des habitudes, des
préjugés locaux, de «l'égoïsme de province et de famille»(9)
sur lesquels s'appuie la souveraineté des États américains.
Tocqueville pressent aussi que le nationalisme peut valoriser de façon
excessive les caractères distinctifs des peuples au point de diviser
artificiellement le genre humain. Si, dans ses premiers écrits, il se montre
convaincu de la force explicative des traits culturels des peuples, avec le
temps il accordera de moins en moins d'importance aux tempéraments nationaux,
allant jusqu'à manifester de l'agacement, dans son dernier livre, envers les
explications qui se rapportent trop systématiquement à «l'esprit
français»(10) . En marge de l'ébauche de
son dernier livre, il note : «La peinture d'un peuple est toujours une
image vague et indistincte, quand on veut la faire d'ensemble. Il y règne
toujours plus de prétention que de vérité(11) .»
Tocqueville est catégoriquement opposé à toute prétention nationale qui
s'appuierait sur la croyance à une supériorité raciale. Il fustige ces «fausses
et odieuses doctrines»(12) . Les nations
disposent au départ du même génie naturel, et s'il est possible que chacune
ait une identité biologique particulière, c'est là une explication que
Tocqueville entend refouler le plus loin possible dans l'ordre des causes du
comportement social. Mais il voit bien l'emprise des préjugés raciaux sur ses
contemporains. Parlementaire, il est l'un des champions de l'abolition de
l'esclavage et s'il croit à une colonisation éclairée, civilisatrice, qui
viendrait «porter la lumière dans les ténèbres»(13)
, il dénonce le fanatisme des officiers français brutaux aux coeurs
remplis de «mépris et de colère» pour qui «les Arabes sont des
bêtes malfaisantes»(14) .
Alors, puisque l'idéalisation de la nation, ce que nous appelons aujourd'hui le
nationalisme, peut déraper vers la démagogie, le despotisme et le racisme,
puisqu'elle peut diviser de façon artificielle les êtres humains,
puisque l'extraordinaire capacité mobilisatrice de la revendication nationale
risque tant de tourner au fanatisme, pourquoi ne pas tenter de s'en détourner
complètement? Pourquoi ne pas faire de l'humanité entière le référent
collectif? Après tout, la démocratie est porteuse d'une civilisation
universelle où les différences entre les nations vont tendre à s'effacer : «La
variété disparaît au sein de l'espèce humaine; les mêmes manières d'agir,
de penser et de sentir se retrouvent dans tous les coins du monde(15)
.»
Les nations tendent à perdre leur spécificité à mesure que les individus
abandonnent leurs vieilles traditions pour mieux tirer avantage de la liberté,
observe Tocqueville. D'eux-mêmes, les peuples démocratiques convergent vers
une similitude de valeurs, ils «semblent marcher vers l'unité»(16)
. «Cela met pour la première fois au grand jour la figure du genre
humain(17) ».
Tocqueville est d'avis que ce sentiment d'unité du genre humain procure un
grand bienfait : l'amour de la paix.
Pourtant, Tocqueville refuse de renoncer à la nation. Bien utilisée, la
référence à la nation peut contribuer au sens civique, pense-t-il.
3. Les
vertus civiques de l'attachement national
Tocqueville est très préoccupé par le civisme, défini comme le trait d'union
entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Il est persuadé que la
démocratie, parce qu'elle laisse les individus libres de refuser leur
participation aux affaires communes pour mieux vaquer à leurs affaires privées,
a terriblement besoin de civisme. C'est pourquoi il recommande que la
démocratie puise dans les vertus civiques de la religion, de la
décentralisation administrative et du patriotisme.
En théorie, le risque de l'apathie générale, de l'égoïsme asocial, ne
menace guère les démocraties, estime Tocqueville, puisque l'intérêt bien
entendu de chaque homme laissé responsable de lui-même devrait suffire à le
convaincre de s'associer à ses semblables : «[C]haque homme étant
également faible sentira un égal besoin de ses semblables; et connaissant
qu'il ne peut obtenir leur appui qu'à la condition de leur prêter son concours,
il découvrira sans peine que pour lui l'intérêt particulier se confond avec
l'intérêt général(18) .»
Mais la pratique peut être toute différente, en vient à penser Tocqueville.
Les hommes en démocratie sont moins clairvoyants que ne le veut la théorie
optimiste de l'intérêt bien entendu. Installés dans leurs droits, ils ont
trop tendance à ne se soucier que de leurs affaires privées et de leur confort
matériel, et à abandonner à l'État le soin des affaires publiques : «Ce
n'est donc jamais qu'avec effort que ces hommes s'arrachent à leurs affaires
particulières pour s'occuper des affaires communes; leur pente naturelle est
d'en abandonner le soin au seul représentant visible et permanent des
intérêts collectifs, qui est l'État. Non seulement ils n'ont pas
naturellement le goût de s'occuper du public, mais souvent le temps leur manque
pour le faire. La vie privée est si active dans les temps démocratiques, si
agitée, si remplie de désirs, de travaux, qu'il ne reste presque plus
d'énergie ni de loisir à chaque homme pour la vie politique(19)
.»
Selon Tocqueville, la conséquence de cet égoïsme asocial est la mollesse des
moeurs et le matérialisme à courte vue, penchants qui peuvent être
suicidaires pour la liberté, à mesure que l'expansion de l'État comprime
l'initiative individuelle. Le patriotisme prend place aux côtés de la religion
et de la décentralisation administrative parmi les moyens de combattre d'aussi
funestes penchants.
En effet, le partage d'un même attachement national jette un pont entre les
hommes libres qui n'ont que trop tendance à se replier sur eux-mêmes : «On
ne rencontrera jamais, quoi qu'on fasse, de véritable puissance parmi les
hommes, que dans le concours libre des volontés. Or, il n'y a au monde que le
patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant longtemps vers un
même but l'universalité des citoyens(20) .»
L'attachement national est une «vertu» qui lutte contre les «passions
destructrices» liées à «l'ambition des particuliers» et à «la
force des partis»(21) .
Si Tocqueville insiste surtout sur les vertus civiques de la religion, bien
davantage que sur celles du patriotisme, c'est parce qu'il observe que ses
contemporains contestent les valeurs religieuses. Mais si convaincu soit-il des
bienfaits de l'esprit religieux, il n'estime pas moins nécessaire de le
compléter par l'esprit patriotique : «Les devoirs des hommes entre eux en
tant que citoyens, les obligations du citoyen envers sa patrie me paraissent mal
définis et assez négligés dans la morale du christianisme. C'est là, ce me
semble, le côté faible de cette admirable morale, de même que le seul côté
vraiment fort de la morale antique(22) .»
Avec le rapprochement des valeurs et l'effacement des différences nationales,
peut-être deviendra-t-il possible de mobiliser les hommes pour le bien-être de
l'humanité entière et de se passer du référent national. Mais Tocqueville en
doute, l'humanité lui paraissant une abstraction trop insaisissable pour
l'esprit humain. Il croit aux vertus de la proximité et de l'expérience
concrète. Il écrit : «Aux États-Unis, on pense avec raison que l'amour
de la patrie est une espèce de culte auquel les hommes s'attachent par les
pratiques(23) .» L'homme en
démocratie s'intéresse au bien-être de son pays comme à une chose qui lui
est utile et comme aux résultats de son propre ouvrage. C'est pourquoi il tire
orgueil des succès de la nation.
Tocqueville pensait que, pour mieux promouvoir ce patriotisme civique, un État
démocratique devait être fédéral ou décentralisé. «Ce que j'admire le
plus en Amérique, ce ne sont pas les effets administratifs de la
décentralisation, ce sont ses effets politiques. Aux États-Unis, la
patrie se fait sentir partout. Elle est un objet de sollicitude depuis le
village jusqu'à l'Union entière(24) .»
Car Tocqueville n'a aucun attrait pour l'uniformité. «Je regarderais comme
un grand malheur pour le genre humain que la liberté dût en tous lieux se
produire sous les mêmes traits(25) .»
Il s'inquiète de ce que la passion pour l'égalité pousse les démocraties à
voir dans l'uniformité législative la condition première d'un bon
gouvernement. «Leur esprit n'a jamais prévu qu'on pût ne pas appliquer
uniformément la même loi à toutes les parties d'un même État et à tous les
hommes qui l'habitent(26) .» Au
législateur moderne, Tocqueville assigne, entre autres missions, celle de
conserver à l'individu le peu d'originalité qui lui reste(27).
Le fédéralisme, la décentralisation, l'amour de la patrie, «du village
jusqu'à l'Union entière», devraient contribuer, selon Tocqueville, à
cette quête plurielle de la liberté et de la citoyenneté vraie.
Ainsi, le patriotisme en démocratie s'enracine dans les pratiques. «Il
croît avec l'exercice des droits et il finit, en quelque sorte, par se
confondre avec l'intérêt personnel»; il sera «plus rationnel, (...)
plus fécond» que le patriotisme ancien, qui, lui, était «irréfléchi,(...)
instinctif»(28).
Cependant, Tocqueville doute que ce patriotisme intéressé, «extension de
l'égoïsme individuel»(29) , suffise à
lui seul à mobiliser les citoyens pour le bien commun et à enrayer les risques
d'apathie générale. «(...) je ne me fie point, explique-t-il, à
ce patriotisme réfléchi qui se fonde sur l'intérêt et que l'intérêt, en
changeant d'objet, peut détruire(30) .»
Le législateur doit intervenir pour le stimuler : «Il dépend des lois de
réveiller et de diriger cet instinct vague de la patrie qui n'abandonne jamais
le coeur de l'homme(31) .»
Selon Tocqueville, le législateur doit lui-même être habité de sentiments
patriotiques. Il blâme les politiciens qui remplacent le patriotisme par
l'habileté électorale. Admirateur des premiers législateurs de l'Union
américaine, Tocqueville écrit qu'ils ont «presque tous été remarquables
par leurs lumières, plus remarquables encore par leur patriotisme» (32)
.
Les dirigeants des démocraties doivent régénérer la discipline morale de
leurs citoyens en leur donnant des objets de fierté nationale et de grands
défis, estime-t-il. «Je voudrais qu'on s'efforçât de leur donner une
idée plus vaste d'eux-mêmes et de leur espèce (33)
.»
Les grands défis en question peuvent prendre la forme d'entreprises militaires
et colonisatrices, va jusqu'à penser Tocqueville : «La guerre agrandit
presque toujours la pensée d'un peuple et lui élève le coeur. Il y a des cas
où seule elle peut arrêter le développement excessif de certains penchants
que fait naturellement naître l'égalité, et où il faut la considérer comme
nécessaire à certaines maladies invétérées auxquelles les sociétés
démocratiques sont sujettes(34) .»
Il salue avec enthousiasme la conquête de l'Algérie et s'inquiète du peu
d'engouement des Français pour ces entreprises éloignées. L'Algérie est «un
grand monument à la gloire de notre patrie»(35)
tout comme l'Inde «un éclat qui rejaillit sur toute la nation»(36)
anglaise.
Renoncer à cette discipline morale qui naît du sentiment national, c'est
s'exposer à être soi-même conquis, fait valoir Tocqueville. Car
l'indifférence pour les affaires communes entrave aussi l'action pour une
défense commune, danger mortel dans le jeu des puissances. «Qu'importe
qu'un peuple présente l'image de l'aisance et de la liberté s'il se voit
exposé chaque jour à être ravagé et conquis(37)
?» demande celui qui a grandi au temps des guerres
napoléoniennes et qui est profondément heurté dans son propre nationalisme
par l'abaissement de la France vaincue.
Ainsi, selon Tocqueville, l'entretien du sentiment national est la condition de
la sécurité nationale et, au-delà, d'une élévation morale qui étend la vue
du citoyen au-delà de ses intérêts étroits.
Conclusion
Le nationalisme moderne sera plus «plus rationnel, (...) plus fécond»,
moins «instinctif, (...) irréfléchi» que le nationalisme ancien,
pensait Tocqueville. Nous, qui connaissons l'ampleur des crimes commis au nom de
la nation durant les deux derniers siècles, n'avons pas le droit de partager
son optimisme.
Nous devons retenir de Tocqueville son pressentiment des dérapages
démagogiques, despotiques, réactionnaires et racistes auxquels l'exacerbation
du sentiment national peut conduire. Nous devons être sensibles au fait que
même un démocrate et un libéral comme lui n'a pas su se prémunir contre
l'engouement colonialiste de son époque et qu'au contraire, il l'encourageait
comme une valeur civique, un stimulant à la participation aux affaires
communes.
Mais en même temps, je persiste à croire que Tocqueville a eu raison de voir
dans le sentiment national une source potentielle de vertu civique. Là où sa
pensée tourne court, c'est en ne précisant pas les moyens par lesquels le
nationalisme pourrait être cela, un patriotisme civique, au lieu de
dégénérer en principe d'exclusion raciste et totalitaire. Le même reproche
peut être adressé aux vues de Tocqueville sur la religion : il ne dit pas
comment en conserver la morale civique tout en écartant les risques de
l'intégrisme et de l'intransigeance religieuse. Du moins esquisse-t-il une
réponse à propos du pouvoir religieux en conseillant de le détacher autant
que possible du pouvoir séculier. Il n'a pas la même prudence avec le
nationalisme qu'il érige au contraire en idéologie d'État.
Mon opinion à ce propos est qu'il y a des valeurs universelles bien plus
importantes que les nationalismes; elles les dépassent de beaucoup. Je pense
aux valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité, de partage, de tolérance,
d'acception des autres, de recherche de la prospérité pour tous. Voilà ce que
nous devons tous rechercher, en tant qu'êtres humains, au-delà de ce qui nous
distingue.
Mais pour mieux vivre ces valeurs universelles, nous devons nous appuyer sur les
expériences de chaque individu, de chaque groupe humain. Nous devons partager
la méfiance de Tocqueville à l'égard de l'uniformité et miser plutôt sur la
pluralité des expériences.
Il me semble que c'est ce que nous essayons de faire au Canada. Je ne sais pas
si mon pays est vraiment celui où il fait le mieux vivre, mais tel est bien le
meilleur objectif qu'un pays puisse se donner : être le pays où les valeurs de
liberté, de prospérité, de partage et de tolérance sont les mieux
respectées. Dans les mots de Tocqueville : «C'est à l'humanité que sont
dus les grands efforts que le patriotisme suggère(38)
.»
La recherche de l'universel, tel est le sens du nationalisme canadien. Nous
devons tirer notre fierté nationale de nos efforts pour ériger ici un pays où
chaque être humain aura les meilleures chances de s'épanouir en tant qu'être
humain, quelles que soient son origine et la couleur de sa peau. C'est vers
cette cible que nous devons orienter et stimuler la participation civique des
Canadiens.
Pour cela, nous devons miser sur la pluralité des expériences, sur la
diversité de notre pays et la forme fédérative de notre système de
gouvernement. C'est ici que mon nationalisme canadien rejoint mon nationalisme
québécois. C'est en misant sur ma culture propre, ma langue, en m'appuyant sur
de tels atouts, en les partageant avec les autres Canadiens, en acceptant en
retour leur aide et leur contribution que je me donne à moi-même et que je
donne aux autres les moyens de vivre les valeurs que nous recherchons tous.
En aucune façon une contradiction, les appartenances au Québec et au Canada
m'apparaissent une formidable complémentarité, peut-être la meilleure
combinaison qui soit pour mieux vivre les valeurs universelles recherchées par
tous les êtres humains.
J'aime trop mon pays pour être nationaliste, disait Camus. Tout le problème
est là : dans notre capacité à tirer de nos sentiments d'appartenance, «du
village à l'Union entière», quelque chose de meilleur et de plus grand que le
nationalisme, quelque chose qui nous arrime à l'universel, à ce que
Tocqueville appelait «la mise au grand jour de la figure du genre humain».
Notes
1. Stéphane
Dion, «La pensée de Tocqueville - L'épreuve du Canada français», Revue
d'histoire de l'Amérique française, vol.41, no 4, 1988, pp. 537-552.
Id,
«Tocqueville, le Canada français et la question nationale», Revue
française de science politique, vol.40, no 4, 1990, pp. 501-519.
Id, «Durham
et Tocqueville sur la colonisation libérale», Revue d'études
canadiennes/Journal of Canadian Studies, vol.25, no 1, 1990, pp. 60-77.
Id, «Le
nationalisme dans la convergence culturelle: Le Québec contemporain
et le paradoxe de Tocqueville», sous la direction de Raymond Hudon et Réjean
Pelletier, L'engagement intellectuel : Mélanges en l'honneur de Léon Dion,
Québec, Presse de L'Université Laval, 1991, pp. 289-311.
Id, «La
conciliation du libéralisme et du nationalisme chez Tocqueville», La Revue
Tocqueville/The Tocqueville Review, vol. XVI, no 1, 1995, pp. 219-227.
2. Raymond Aron,
«Discours lors de la réception du prix Tocqueville», La Revue Tocqueville/The
Tocqueville Review, vol. II, no 1, 1980, p.120.
3.
Alexis de Tocqueville, «Lettre à Charles Stoffels», 5 octobre 1836 (Oeuvres
complètes, édition de 1836, tome V, pp. 436-438), citée dans Jean-Claude
Lamberti, Tocqueville et les deux démocraties, Paris, PUF, 1983,
pp.160-161.
4. Alexis de
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I (D1), §1, chap. 4,
p. 106 (la pagination correspond à l'édition Gallimard «Folio», Paris,
1986).
5. Alexis de
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome II (D2), chap. 21, p.
115 (la pagination correspond à l'édition Flammarion, Paris, 1981).
6. D2, § 3,
chap. 16, p. 278.
7. D1, § 2,
chap. 6, p. 353.
8. D1, § 2,
chap. 6, p. 354.
9. D1, §1,
chap. 8, p. 254 et p. 257.
10. Alexis de
Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, livre 3, chapitre
2, p. 241 (la pagination correspond à l'édition Gallimard «Folio», Paris,
1967).
11. Cité dans
Françoise Mélonio, «Nations et nationalismes», La Revue
Tocqueville/The Tocqueville Review, vol. XVIII, no 1,
1997, p. 63.
12. Alexis de
Tocqueville, «Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner
la proposition de M. De Tracy relative aux esclaves des colonies»,
23 juillet 1839, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1962 (O.C.),
tome III (Écrits et discours politiques), vol. 3, p. 42.
13. «Intervention
à la Chambre à l'occasion du vote du budget général de l'Algérie pour
1848», 9 juillet 1847, ibid., p. 420.
14. «Lettre à
Francisque de Corcelle», 1er décembre 1846, O.C., tome XV
(Correspondance Tocqueville-Corcelle et Tocqueville-Madame Swetchine),
vol. 1,
p. 224.
15. D2, § 3,
chap. 17, p. 282.
16. D1,
Conclusion, p. 596.
17. D2, § 2,
chap. 17, p. 95.
18. D1,
Introduction, p. 46.
19. D2, § 4,
chap. 3, p. 359.
20. D1, § 1,
chap. 5, p. 159.
21. D1, § 1,
chap. 8, pp. 246-247.
22. «Lettre à
Arthur de Gobineau», 5 septembre 1848, O.C., tome IX (Correspondance
Tocqueville-Gobineau), p. 46.
23. D1, § 1,
chap. 5, p. 123.
24. D1, § 1,
chap. 4, p. 159.
25. D1, § 2,
chap. 10, p. 465.
26. D2, § 4,
chap. 2, p. 356.
27. D2, § 4,
chap. 7, p. 396.
28. D1, § 2,
chap. 6, pp. 353-354.
29. D1, § 2,
chap. 10, p. 535.
30. D1, § 2,
chap. 10, p. 543.
31. D1, § 1,
chap. 5, p. 159.
32. D1, § 1,
chap. 8. p. 236.
33. D2, § 3,
chap. 19, p. 304. La même idée est exprimée dans «Lettre à John
Stuart Mill», 18 mars 1841, O.C, tome VI (Correspondances
anglaises), vol. 1, p. 335.
34. D2, § 3,
chap. 22, p.329.
35. «Seconde
lettre sur l'Algérie», parue dans La Presse de Seine-et-Oise, 22
août 1837, OC, tome III (Écrits et discours politiques),
vol.1, p. 151.
36. «Ébauche
d'un ouvrage sur l'Inde», ibid., p. 478.
37. D1, § 1,
chap. 8, pp. 248-249.
38. «Réflexions
diverses», Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1953, tome II (L'Ancien
Régime et la Révolution), vol. 2, p. 346.

|