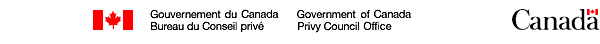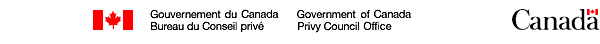|
« Du référendum de 1980 au Canada de 2020 »
Notes pour une allocution
de l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
devant
l'Association d'études canadiennes
Montréal (Québec)
le 19 mai 2000
L'allocution prononcée fait foi
« Une vraie fraude! » Nous avons souvent entendu, lors du
référendum de 1995, cette juste dénonciation de la question alambiquée qui
avait alors été posée. Mais je viens de citer ce que le leader du Non lors du
référendum de 1980, M. Claude Ryan, avait dit de la question
référendaire durant la campagne (cité dans Maurice Lamontagne, La
réponse au Livre blanc du PQ, 1980, p. 86). « Trompeuse et
malhonnête », « camouflage en vue d’élargir au maximum l’assiette
du Oui », avait-il ajouté (Le Devoir, 5 mars 1980,
pp. 1 et 10). Les éditorialistes n’avaient pas été en reste : « un
pas de côté », selon Michel Roy (Maurice Lamontagne,
ibid). Et écoutez bien : « beaucoup d’astuce », avait
écrit feu Marcel Pépin, le journaliste (Maurice Lamontagne, ibid).
Des astuces en 1980, des astuces en 1995. Eh bien, Mesdames et Messieurs, on
ne peut pas perdre un pays par des astuces. Ce serait contraire au droit,
contraire à la justice.
En mai 1980, un sondage montrait que seulement 46 % des électeurs
comprenaient qu’un Québec souverain ne ferait plus partie du Canada. En
octobre 1995, un sondage indiquait que le même pourcentage, soit seulement
46 % des électeurs, avaient compris que la question signifiait que le
Québec deviendrait indépendant même si les négociations sur le partenariat
politique et économique devaient échouer (Maurice Pinard, « Confusion
et incompréhension entourant l’option souverainiste », mémoire
présenté devant le comité parlementaire chargé d’étudier le projet de loi
C-20, février 2000).
Les chefs indépendantistes prétendent voir dans le taux élevé de
participation au référendum de 1995 la preuve que les électeurs avaient
compris l’enjeu. Cette prétention est bien sûr erronée. Il est évident que
quantité d’électeurs se sont présentés aux urnes en croyant de bonne foi
que la souveraineté était liée à la conclusion d’une entente de
partenariat politique et économique.
Toute bonne démarche référendaire exige une question claire. C’est vrai
partout, au Québec comme ailleurs. En 1980 comme en 1995, la question n’a pas
été claire. Ce fut l’avis des électeurs eux-mêmes d’ailleurs. « À
la veille du référendum de 1995 », a écrit le sociologue
Maurice Pinard, « seulement 46 % [encore 46 %!]
des électeurs interrogés [ont] déclaré que la question
référendaire, qu’on venait de leur lire, était "très" ou
"assez" claire; en fait, 53 % disaient au contraire qu’elle
était "plutôt" ou "très" ambiguë ».
On ne peut pas perdre un pays à coup d’astuces. Voilà pourquoi tant en
1980 qu’en 1995, le Premier ministre du Canada s’est refusé à négocier la
sécession advenant un « Oui ». Voilà pourquoi M. Ryan avait
déclaré en 1980, l’avant-veille du scrutin référendaire : « Si
les Québécois votaient « oui » à 52 p. cent mardi soir,
on ne saurait pas ce que cela voudrait dire parce qu’il n’ y aurait pas de
négociations et l’on serait plongé dans un deuxième référendum d’ici
six mois ou un an. » (La Presse, 20 mai 1980,
p. A9)
Et voilà pourquoi le Premier ministre Jean Chrétien a voulu que le
projet de loi sur la clarté soit rédigé dans la foulée de l’avis de la
Cour suprême du 20 août 1998. Ce projet de loi ne dit que cette
évidence : si vous voulez faire l’indépendance, posez une question sur
l’indépendance. Demandez aux Québécois s’ils veulent cesser de faire
partie du Canada pour faire du Québec un pays indépendant. Et ils vous
donneront leur réponse.
C’est seulement si, en réponse à une telle question claire, se dégageait
une majorité claire en faveur de la sécession, et non une majorité de
circonstance, qu’on pourrait entreprendre cette difficile tâche que serait la
négociation de la sécession, conformément au droit et avec une recherche
sincère de justice pour tous.
La vérité commande de dire qu’aucun pays démocratique au monde n’accepterait
de négocier sa scission à partir des questions confuses de 1980 et 1995. Pas
plus le Canada qu’une autre démocratie.
« Il faut mettre plus de chair sur le squelette du partenariat »,
avouait Lucien Bouchard le 19 juin 1997. Outre qu’il aurait dû
prévenir le peuple québécois durant le référendum de 1995 qu’il lui
proposait la souveraineté avec offre de « squelette », il faut bien
constater que son projet de partenariat est plus squelettique que jamais aujourd’hui.
Il oscille entre les arrangements habituels qui se font entre pays voisins et
quelque chose d’aussi exigeant et élaboré que l’Union européenne.
L’Europe? Comme si l’Europe pouvait fonctionner à deux partenaires.
Comme si on pouvait s’attendre à ce que le Canada accepte de voir ses
politiques importantes soumises au veto d’un Québec indépendant trois fois
plus petit que lui. Comme si la mention d’une structure paritaire aussi
improbable, qui, même si par miracle elle devait être négociée, n’en
serait pas moins résiliable au gré de l’un des deux pays, avait sa place
dans une question référendaire aux côtés d’un enjeu aussi irréversible qu’une
sécession, laquelle engagerait non seulement nous-mêmes mais aussi nos
enfants, nos petits-enfants et les générations futures.
« Il ne faut pas rêver et demander la lune. Demander la lune, c’est
imaginer qu’à l’occasion de la déclaration de la souveraineté du Québec,
nous allons pouvoir négocier une foule de changements économiques et
politiques avec le Canada (...) Et, déjà pas très contents que le Québec
devienne souverain, ces Canadiens-anglais, pour nos beaux yeux, pour nous faire
plaisir, pour imiter vaguement ce que certains croient qu’il se passe, en
Europe de l’Ouest acceptaient ainsi de chambarder leur vie
politique... » déclarait M. Parizeau en décembre 1993 (La
Presse, 3 décembre 1993, p. B3) bien avant de se rallier au
virage tactique de M. Bouchard.
Alors la question se pose : pourquoi les dirigeants péquistes
persistent-ils à faire miroiter la lune aux Québécois? Pourquoi tant de
constance à laisser entendre aux Québécois, en quelque sorte, qu’ils
pourraient garder le Canada par la porte d’en arrière? Pourquoi les
péquistes s’enfoncent-ils toujours plus dans la confusion avec un projet d’association-partenariat
qu’ils n’ont jamais pu définir en 35 ans? Pourquoi « emballer
ça dans le fla-fla du partenariat », (RDI, nouvelles de 17h00, 6
mars 2000) pour reprendre l’expression d’un jeune militant péquiste
dépité par le manque de franchise de ses dirigeants?
Vous la connaissez la réponse. Tout le monde la connaît, y compris
M. Bouchard qui avouait le 19 octobre 1999 que « le
partenariat ça représente 7 à 8 % de plus d’appuis dans la
population », estimation, au demeurant, bien conservatrice.
La réponse, c’est que les Québécois, dans leur grande majorité, ont une
étrange idée : ils sont attachés au Canada. Nous voulons demeurer
Canadiens. Nous préférons être Québécois et Canadiens plutôt que
Québécois sans le Canada.
Sondage après sondage, les trois quart des Québécois se disent attachés
au Canada. Entre le cinquième et le quart ne se reconnaissent aucune identité
canadienne. C’est beaucoup trop, mais beaucoup moins que 49,4 %.
Bien sûr, nous les Québécois avons différentes idées sur la façon d’améliorer
le Canada et la place du Québec dans le Canada. Mais ce Canada, nous voulons l’améliorer
de l’intérieur, car nous sentons bien qu’il nous appartient en son entier,
autant qu’il appartient aux autres Canadiens.
Et pourquoi ne serions-nous pas attachés au Canada? Pourquoi ne
voudrions-nous pas le garder? Nous voyons bien que le pays que nous avons bâti
dans l’entraide, avec les autres Canadiens, est une réalisation humaine
extraordinaire. Nous savons qu’ils sont des centaines de millions, sinon des
milliards d’êtres humains, qui rêveraient de devenir Canadiens. Alors il est
bien difficile de nous convaincre de cesser de l’être.
Mais cette difficulté dans laquelle les chefs indépendantistes se trouvent
de gagner dans la clarté ne les autorise pas à rechercher la victoire dans la
confusion. À eux le fardeau de la preuve. À eux de démontrer que nous serions
plus heureux si nous cessions d’être Canadiens. La commande est élevée,
certes, mais ce n’est pas la faute du Canada.
C’est plutôt qu’il doit être bien difficile de renoncer au Canada, ce « pays
bien connu pour sa générosité d’esprit (...) où chaque citoyen et chaque
groupe peut s’affirmer, s’exprimer et réaliser ses aspirations »,
a déclaré M. Bouchard le 1er juillet 1988. Je ne lui
ferai pas l’injure de croire que ses paroles si vraies à propos du Canada lui
ont été inspirées par un manque de confiance envers le Québec. Telle est
pourtant son interprétation de sa défaite référendaire de 1995 : ce
serait un manque de confiance envers l’économie québécoise qui expliquerait
la défaite du Oui. Maintenant que le déficit budgétaire du gouvernement du
Québec est effacé, l’appui à l’option péquiste devrait monter, prédit
M. Bouchard.
Pourquoi est-il si difficile d’admettre que plutôt qu’un prétendu
manque de confiance en eux-même, c’est un attachement sincère au Canada qui
inspire aux Québécois cette fierté d’être Canadiens que M. Bouchard
avait si bien exprimée dans sa déclaration de 1988?
Bien sûr que la séparation serait coûteuse. Le Parti québécois lui-même
vient d’en refaire involontairement la démonstration. Dans un document
récent, il prévoit que le solde budgétaire d’un Québec indépendant
dégagerait un surplus de 41 millions $. Mais pour parvenir à ce
chiffre, il prend pour hypothèse que la part du Québec du service de la dette
fédérale ne serait que de 17,7 %. Si l’on reprend les propres calculs
du Parti québécois, mais que l’on suppose un partage plus normal, soit le
poids démographique (24,1 %), le Québec replongerait dans un déficit de
3,1 milliards $. Et cela dans l’hypothèse d’une sécession sans
problème qui ne provoquerait ni ralentissement économique, ni hausse des taux
d’intérêts, ni fuite de capitaux, ni exode de main-d’oeuvre.
Mais ce n’est pas la crainte de cette perte de niveau de vie économique
qui nous donne le goût du Canada. Je suis persuadé que nous les Québécois
tenons au principe d’entraide qui fait la force du Canada, qui fait sa vraie
grandeur. Que le jour où nous aurons renforcé notre économie suffisamment
pour aider les autres provinces de la même façon que les provinces plus riches
nous aident aujourd’hui, nous le ferons avec la même générosité qu’elles.
Car cet esprit de partage est le nôtre, ce pays solidaire est le nôtre.
Tous les arguments qu’on a avancés pour nous faire renoncer au Canada se
sont avérés erronés. Lors de la campagne référendaire de 1980,
Claude Charron avait prédit que la victoire du « Non »
équivaudrait à « s’éteindre » (Journal de Montréal,
4 mai 1980). Aujourd’hui, vingt ans plus tard, la culture
québécoise, l’identité québécoise sont pleines de vie et le Conseil de la
langue française établit à 87 % la proportion des Québécois qui
parlent principalement le français dans leurs activités publiques.
Encore en 1980, un autre Claude, Claude Morin, avait déclaré que « la
signification véritable d’un Non au référendum [serait] la perte
complète des pouvoirs du Québec au profit du fédéral » (Le
Soleil, 1er mai 1980, p. B4). En fait, le Canada s’est
plutôt décentralisé depuis 1980. Par exemple, le poids des dépenses directes
du gouvernement fédéral par rapport au produit intérieur brut a diminué
(passant de 12,0 % en 1980 à 10,9 % en 1998, dernière statistique
disponible), alors que le poids des dépenses provinciales directes a augmenté
(passant de 14,5 % à 15,2 %).
Depuis trente-cinq ans, les chefs indépendantistes, tels des prophètes de
malheur, nous annoncent une dangereuse centralisation du Canada. En 1967 déjà,
Jacques Parizeau prédisait que le Canada allait se centraliser car les
modèles de planification économique à la mode à l’époque l’exigeaient :
« Nul pays ne devrait être autorisé à fragmenter son pouvoir de
décision comme nous l’avons fait » [Traduction], a-t-il déclaré
dans son fameux discours présenté à Banff le 17 octobre 1967. La
centralisation annoncée s’est-elle produite? Mais non, puisque même
M. Parizeau reconnaissait à Québec le 28 février 1999 que « le
fédéralisme canadien est à peu près le plus décentralisé au monde, avec la
Suisse. »
Mais qu’à cela ne tienne, la centralisation est toujours à venir nous
prévient encore et toujours M. Parizeau avec une constance qui, ma foi,
force l’admiration. Lors de cette conférence de Québec du
28 février 1999, il affirmait : « Il est absolument
impératif et essentiel que le gouvernement fédéral (...) centralise ce qui
est une fédération extraordinairement décentralisée. » Les
pressions de la mondialisation l’y oblige, nous assure cet incorrigible
jacobin.
Les chefs indépendantistes trouveront toujours un concept à la mode pour
tenter de nous convaincre de renoncer au Canada, hier la planification
économique, aujourd’hui la mondialisation. Encore là, pourquoi est-il si
difficile de convenir que cet équilibre toujours mouvant entre le caractère
décentralisé de notre fédération et sa capacité d’action commune, cette
combinaison de diversité et d’unité, sont le contraire d’un problème, une
force fondamentale qui nous a puissamment aidés dans le passé et le fera
encore davantage dans l’avenir?
Que sera le Canada dans vingt ans? Eh bien, ça dépendra de nous. Mais notre
pays nous donne tout un levier. Il en est peu de pays mieux placés que le
nôtre pour réussir face à la mondialisation, avec nos provinces et
territoires dont les forces se complètent, avec deux langues officielles qui
sont des langues internationales, avec notre droit civil et notre common law qui
nous permettent de parler le langage juridique de la grande majorité des pays,
avec notre immense territoire qui nous ouvre aux Amériques, à l’Europe et à
l’Asie, avec une population multiculturelle qui donne prise sur tous les
continents.
Face à la puissance américaine, de plus en plus notre principal partenaire
commercial, il nous faudra nous appuyer sur un Canada uni. Alors que les accords
internationaux touchent nos vies toujours davantage, il faut pouvoir compter sur
le prestige et l’influence de notre pays. Face aux enjeux de la nouvelle
économie, l’entraide de tous les Canadiens sera une force essentielle.
Ce n’est pas la lassitude référendaire qui, fondamentalement, explique le
désintérêt croissant des Québécois pour le projet indépendantiste. C’est
plutôt le sentiment qu’avec les autres Canadiens nous avons su faire de notre
diversité une force dont nous aurons besoin plus que jamais.

|