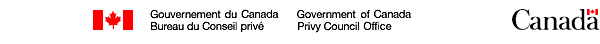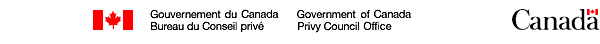|
Histoire de l'évolution constitutionnelle du Canada
Table des matières
Introduction
L'évolution constitutionnelle du Canada reflète l'histoire même du Canada,
son cheminement vers une démocratie autonome et l'évolution constante des idées
et des événements. La Constitution, tout comme le pays,
s'est transformée avec les années. Elle porte fortement l'empreinte du passé
et elle doit aussi pouvoir s'adapter à des situations nouvelles et permettre
aux Canadiens d'affronter les exigences du XXIe siècle.
Au Canada, certaines dispositions constitutionnelles sont écrites et
d'autres ne le sont pas. Ensemble, elles forment l'assise fondamentale
nécessaire au fonctionnement du gouvernement, présidant à la définition et
à l'élaboration des principales institutions de celui-ci et de leurs relations
mutuelles. De plus, c'est dans ces dispositions que sont énoncés les droits,
tant collectifs qu'individuels, des Canadiens par rapport à l'État.
Le bref survol que nous ferons de l'évolution constitutionnelle
canadienne vise à donner une perspective historique et à préciser le contexte
relatif aux efforts consacrés à la réforme constitutionelle.
Faits antérieurs à la Constitution
L'évolution politique et constitutionnelle du Canada n'a pas commencé à
l'arrivée des premiers colons européens. Les peuples autochtones du pays
avaient diverses langues et cultures et de multiples régimes de gouvernement,
et ils négociaient des alliances et des traités. La Constitution du Canada
confirme les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones de
notre pays et les reconnaît. Les questions qui concernent les Autochtones, dont
celle de leur autonomie gouvernementale, demeurent un élement clé des efforts du
Canada en vue de renouveler la Constitution.
L'élaboration de la Constitution canadienne a débuté au Canada en 1663 à
la proclamation de l'Édit de création du Conseil souverain de Québec dans
lequel les Français firent de la Nouvelle-France une province royale et
prévoyèrent l'établissement d'un gouvernement civil. À la suite de la
cession du Canada à l'autorité britannique, la Proclamation royale de 1763
établit, entre autres choses, certains principes relatifs au gouvernement civil
du Québec et aux relations avec les peuples autochtones.
Dans les années qui précédèrent la Révolution américaine, le
gouvernement britannique se préoccupa de plus en plus de la façon de conserver
la loyauté de ses nouveaux sujets canadiens. Soucieux des profondes
différences culturelles qui distinguaient le Québec du reste de l'Amérique du
Nord britannique, le Parlement de Westminster adopta en 1774 l'Acte de Québec,
dans lequel il autorisait l'utilisation du droit civil français et le libre
exercice de la religion catholique romaine. C'est cette loi que le Québec
invoquera par la suite comme source légale première de ses revendications en
faveur du maintien de la reconnaissance de la société distincte qu'il forme en
Amérique du Nord.
À la suite de la Révolution américaine et de la venue au Canada de
nombreux Loyalistes, l'Acte constitutionnel, en 1791, divisa le Québec en deux
provinces, le Haut et le Bas-Canada, toutes deux dotées d'une assemblée élue.
Ces deux assemblées permettaient pour la première fois aux Canadiens de se
donner un gouvernement représentatif et de contrôler la levée de nouveaux
impôts. Cependant, le pouvoir exécutif du gouvernement n'était aucunement
comptable, devant l'assemblée élue, de ses politiques, programmes et
activités, ce qui suscita avec le temps un profond mécontentement au sein des
dirigeants élus.
En 1837 et 1838, des soulèvements secouèrent le Haut et le Bas-Canada et
l'on réclama un régime de gouvernement responsable. Le gouvernement
constitutionnel fut suspendu et lord Durham, dépêché au Canada afin d'y faire
enquête sur la situation et de formuler des recommandations. Deux
recommandations clés ressortent du Rapport Durham :
-
que le Haut et les Bas-Canada soient réunis en une seule union
législative, que l'usage du français soit interdit et que l'on favorise
l'assimilation de la population francophone par son pendant anglophone;
-
que soit établi un régime de gouvernement responsable.
Par l'Acte d'Union, en 1840, on tenta en vain de réaliser le premier
objectif. Huit ans plus tard, anglophones et francophones étaient placés sur
un pied d'égalité à toutes fins officielles. Même si le régime de
gouvernement responsable n'était pas prévu dans l'Acte d'Union, ce second
objectif fut atteint au Canada aux termes de la constitution «non écrite» --
soit les traditions, coutumes, usages et lois d'importance plus ou moins grande
qui viennent presque inévitablement compléter la constitution écrite d'un
État.
La constitution non écrite
Le principe du gouvernement responsable, l'un des principaux éléments
fondamentaux de la Constitution du Canada, ne se retrouve pas dans la
constitution écrite, mais plutôt dans les coutumes établies et les
précédents. Ce principe et diverses autres caractéristiques de la démocratie
canadienne s'inspirèrent du modèle britannique de gouvernement qui, en raison
de l'absence de constitution écrite officielle, demeure fondé sur les
conventions constitutionnelles non écrites qui fournissent les assises de la
démocratie parlementaire.
La formule de gouvernement responsable suppose un régime selon lequel les
membres du Cabinet sont collectivement comptables à la Chambre élue des
actions de l'exécutif. S'ils en perdent la confiance ou l'appui, ils doivent
démissionner ou chercher à obtenir un nouveau mandat.
Le régime canadien de gouvernement parlementaire responsable tire ses
origines des instructions données en 1846 par le Colonial Office aux
gouverneurs de l'Amérique du Nord britannique. À la suite des élections
générales tenues en Nouvelle-Écosse, l'assemblée se prononça par un vote de
blâme contre le gouvernement le 25 janvier 1848. Le conseil exécutif
démissionna deux jours plus tard et, le 28 janvier, J.B. Uniacke forma le
premier gouvernement responsable en Amérique du Nord britannique.
Les coutumes et les précédents demeurent encore aujourd'hui le fondement du
gouvernement responsable au Canada.
La Confédération
L'union législative des deux Canadas, en 1840, ne fut pas un système
stable. Leur représentation égale au sein de l'assemblée élue ne reflétait
pas fidèlement leurs différences du point de vue de la population, de la
richesse, des contributions aux recettes de l'État et des besoins budgétaires.
L'union législative existait bel et bien, mais elle devait régir deux
sociétés fondamentalement différentes : le droit civil français s'appliquait
dans le Canada-Est tandis que la common law britannique était pratiquée dans
le Canada-Ouest; l'enseignement se faisait principalement en français et était
surtout de confession catholique dans le Canada-Est tandis qu'il se faisait
principalement en anglais et était surtout de confession protestante dans le
Canada-Ouest.
D'entrée de jeu, la coexistence de deux régimes juridiques nécessita la
nomination de deux procureurs généraux au sein du gouvernement. La dualité se
traduisit également dans le fait que, pendant près des deux tiers de la durée
de l'Union des deux Canada, même la charge de premier ministre fut partagée
par un représentant de chacun des deux Canada, Est et Ouest (par exemple,
Baldwin et Lafontaine, Cartier et Macdonald).
Dès les années 1850, diverses considérations culturelles, sociologiques,
démographiques et politiques favorisèrent un relâchement de l'union de la
manière suivante :
-
les questions litigieuses, telles que l'éducation, l'administration de
la justice, la propriété et les droits civils, pouvaient être retirées
à l'assemblée législative de l'union et confiées aux gouvernements
locaux;
-
les grandes questions d'intérêt commun, comme le commerce, la défense
et l'activité bancaire, pouvaient continuer de relever de l'autorité
centrale.
Cependant, si certains facteurs laissaient entrevoir la nécessité de
relâcher les liens de l'union, il y en avait d'autres qui plaidaient en faveur
d'une autorité centrale forte :
-
le déclin du commerce du bois, la perte de la préférence
impériale en Grande-Bretagne et celle de la réciprocité avec les
Américains menacèrent le bien-être économique des colonies de
l'Amérique du Nord britannique;
-
la guerre civile américaine encore récente avait montré la fragilité
d'un régime fédéral décentralisé;
-
la présence de soldats américains démobilisés dans les États du Nord
et les incursions répétées des Féniens en sol canadien ajoutèrent au
débat un élément de crainte d'une intervention militaire;
-
l'élan principal vers le fédéralisme vint non pas de la volonté
d'États séparés de renoncer à une partie de leur souveraineté en faveur
d'une nouvelle union, mais plutôt de la nécessité d'adapter l'union
existante.
Entre 1864 et 1867, les dirigeants politiques de la Province du Canada et des
provinces de l'Atlantique se réunirent à Charlottetown, à Québec et,
finalement, à Londres afin d'examiner la possibilité de créer une nouvelle
union fédérale et d'en proposer les conditions d'établissement. Finalement,
celles-ci ne furent discutées que par le Parlement de l'Union; les assemblées
législatives de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se bornèrent à se
demander s'il y avait lieu d'envoyer des délégués à la Conférence de
Londres, où les dernières négociations eurent lieu.
L'union fédérale qui vit le jour le 1er juillet 1867 était fortement
centralisée, non seulement pour les raisons mentionnées ci-dessus, mais
également parce que le gouvernement fédéral assumait certains des pouvoirs
qui relevaient auparavant du Parlement britannique. La Constitution de 1867
prévoyait ce qui suit :
-
les lieutenants-gouverneurs des provinces étaient nommés et
rémunérés par le gouvernement fédéral et pouvaient, à la demande de ce
dernier, assujettir toute loi provinciale à l'approbation ou au rejet du
gouverneur général en conseil;
-
le gouverneur général en conseil pouvait annuler ou désavouer toute
toi provinciale dans un délai d'un an suivant réception du texte de la
loi;
-
le gouvernement fédéral possédait des pouvoirs d'imposition
illimités, tandis que les provinces devaient se contenter de lever des
impôts directs à l'intérieur de leur territoire;
-
le Parlement pouvait déclarer d'intérêt général pour le Canada, ou
pour deux ou plusieurs provinces, et donc faire relever de la compétence
législative du Parlement, les ouvrages locaux, même si, ces structures
étaient situées entièrement dans une province;
-
aux termes de l'article 91 de la Constitution, le gouvernement fédéral
jouissait de plus de pouvoirs exclusifs que les fédérations existant aux
États-Unis et en Suisse;
-
le gouvernement fédéral jouissait de pleins pouvoirs résiduels en
raison de son habilitation à légiférer en matière de paix, d'ordre et de
bon gouvernement du Canada, contrairement au modèle américain et, par la
suite, au modèle australien selon lesquels les pouvoirs résiduels étaient
attribués aux États.
L'autorité fédérale se trouva encore renforcée du fait que les sénateurs
étaient nommés à vie par le gouverneur général en conseil, tandis qu'en
1867 leurs homologues américains étaient élus indirectement par les
assemblées législatives des États qui les chargeaient de veiller à leurs
intérêts au sein de la législature fédérale. De plus, la Constitution donna
au Parlement l'autorité de créer une cour d'appel générale pour le Canada,
la Cour suprême du Canada, créée par le Parlement en 1875, à qui il revient
aujourd'hui de trancher en dernier ressort les différends constitutionnels
entre les gouvernements fédéral et provinciaux, et dont les juges sont nommés
par le gouvernement fédéral.
Néanmoins, même si le pacte de 1867 donna naissance à une fédération
hautement centralisée, certaines parties de ce pacte reconnaissaient
expressément le caractère distinctif du Québec dans le droit fil de la
tradition de l'Acte de Québec de 1774 -- dont le statut officiel du français
au Québec et le droit civil propre à cette province.
La Confédération même était une solution innovatrice aux grands
problèmes constitutionnels et économiques de l'heure. Ainsi, le nouveau
régime combinait le gouvernement parlementaire responsable et le fédéralisme
d'une façon tout à fait originale, contrairement aux modèles américain ou
suisse de fédération qui n'étaient pas parlementaires. Le modèle canadien a
par la suite inspiré l'Australie et plusieurs autres fédérations.
L'évolution depuis la Confédération
Lorsque la colonie canadienne s'affranchit de la Grande-Bretagne, par suite
de l'adoption en 1931 du Statut de Westminster, le gouvernement fédéral se vit
conférer la compétence touchant les affaires extérieures du Canada et
d'autres domaines relevant antérieurement du gouvernement britannique.
La répartition des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement ne fut
modifiée officiellement que quatre fois depuis 1867 :
-
en 1940 : attribution au Parlement de la compétence exclusive en
matière d'assurance-chômage;
-
en 1951 : habilitation du Parlement à légiférer à l'égard des
pensions de vieillesse, sous réserve de la primauté des provinces;
-
en 1964 : élargissement du pouvoir conféré au Parlement en matière de
pensions de vieillesse de manière à englober les prestations
supplémentaires, sous réserve de la primauté des provinces;
-
en 1982 : confirmation et renforcement des pouvoirs provinciaux touchant
les richesses naturelles.
Il faut également mentionner que, même si la promulgation de la Charte
canadienne des droits et libertés n'a amené la cession à Ottawa d'aucun
domaine de compétence législative des provinces, ou vice versa, elle a imposé
de nouvelles limites aux deux ordres de gouvernement. Exception faite de
certains cas où la «clause nonobstant» permet de déroger à la Charte, les
lois fédérales et provinciales doivent désormais y être conformes.
Les modifications apportées officiellement à la Constitution n'ont donc pas
joué de rôle important dans le changement de l'équilibre des pouvoirs entre
les gouvernements fédéral et provinciaux. Cependant, elles ne sont pas
l'unique moyen d'infléchir cet équilibre. Les circonstances -- et la manière
dont les gouvernements y font face -- peuvent en effet influer profondément,
dans la pratique, sur l'importance des pouvoirs que chaque ordre de gouvernement
peut exercer. Ainsi, dans les années 30, les bouleversements socio-économiques
provoqués par la Dépression suscitèrent de nouvelles initiatives provinciales
dans le domaine de la politique sociale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le
gouvernement fédéral exerça pleinement ses pouvoirs afin de diriger l'effort
de guerre, et la fédération s'en retrouva de nouveau hautement centralisée.
La conscientisation sociale qui s'opéra à la suite de ce conflit suscita
plus d'intérêt pour certains domaines de compétence provinciale, tels
l'éducation, la santé et le bien-être social. L'intérêt pour les nouveaux
programmes sociaux prit souvent naissance dans les provinces mêmes -- surtout
en Saskatchewan. Mais le gouvernement fédéral y prit part lui aussi, utilisant
parfois son pouvoir de dépenser pour verser à des établissements et à des
particuliers des paiements directs touchant des domaines de compétence
provinciale, et attribuer, par exemple, des subventions aux universités et des
bourses aux étudiants qui les fréquentaient.
En 1957, certains critiques en vue du fédéralisme canadien s'élevèrent
contre les subventions fédérales accordées aux universités, alléguant que
ces paiements estompaient la ligne de démarcation des responsabilités
politiques respectives des deux ordres de gouvernement : si les provinces
détenaient la compétence exclusive en matière d'éducation, elles seules
devaient déterminer le niveau de financement des universités par l'État, et
elles seules devaient rendre compte à la population des décisions prises en la
matière.
Le gouvernement fédéral utilisa encore son pouvoir de dépenser pour mettre
sur pied des programmes nationaux cofinancés dans des domaines de compétence
provinciale exclusive. Ainsi, il offrit sa participation financière aux
provinces qui instaureraient des régimes d'assurance-maladie. Celles-ci
détiendraient le pouvoir exclusif de passer les lois concernant ces régimes,
de les réglementer et d'en fixer les normes. Pour sa part, le gouvernement
fédéral verserait sa contribution financière uniquement si les régimes
provinciaux satisfaisaient à certaines conditions ou normes : les régimes
devraient être gérés par une autorité publique, être complets et être
applicables et accessibles à tous, et cette accessibilité devrait être
transférable quelle que soit la province de domicile des bénéficiaires. Selon
certains critiques, de telles initiatives fédérales ont bouleversé les
priorités des provinces et la responsabilité politique de l'action
gouvernementale.
Le gouvernement fédéral instaura également un programme de péréquation
à l'intention des provinces dont les recettes étaient inférieures à la
moyenne de l'ensemble des provinces. Ces paiements inconditionnels visaient à
améliorer la capacité budgétaire des provinces moins bien nanties de façon
à leur permettre de fournir une gamme convenable de services publics sans
devoir soumettre leurs habitants à un niveau de taxation trop élevé.
Ces nouvelles formes d'exercice du pouvoir de dépenser eurent des effets
paradoxaux. D'une part, elles donnèrent lieu à une décentralisation fiscale
plus poussée de la fédération. D'autre part, les conditions dont étaient
assortis certains paiements de transfert renforcèrent les pouvoirs d'Ottawa en
matière d'élaboration des politiques sociales.
Néanmoins, le gouvernement fédéral n'a pas utilisé pendant plusieurs
années certains pouvoirs exceptionnels qui lui avaient été conférés en 1867
et qui lui permettaient de passer outre à la compétence des provinces. Ainsi,
il n'a pas exercé ses pouvoirs de réserve et de désaveu depuis la Seconde
Guerre mondiale, et il a rarement eu recours à son pouvoir déclaratoire à
l'égard de nouvelles questions au cours des dernières années.
L'interprétation judiciaire, autre moyen de modifier l'équilibre des
pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement, mérite une attention spéciale.
L'interprétation juridique de la
Constitution
En interprétant les dispositions générales de la Constitution et en les
appliquant à des différends particuliers, les tribunaux ont joué un rôle de
premier plan dans l'adaptation de la Constitution aux conditions et idées
nouvelles. En effet, pour reprendre l'expression d'un éminent
constitutionnaliste, ils ont ainsi réussi à «parachever l'esquisse» de ce
document.
Les décisions judiciaires ont, de façon incommensurable, façonné la
Constitution et le pays.
Même si la Cour suprême du Canada a été créée en 1875, c'est le Comité
judiciaire du Conseil privé de Londres qui, jusqu'en 1949, était encore au
Canada le tribunal de dernière instance.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et
libertés, en 1982, la majorité des affaires constitutionnelles examinées
par les tribunaux portaient sur les articles 91 et 92 et articles connexes de la
Loi constitutionnelle de 1867, où sont énumérées et réparties les
compétences gouvernementales du Parlement et des législatures provinciales.
Le Comité judiciaire était vivement conscient des revendications
contradictoires des autorités centrales et provinciales du Canada, et de la
nécessité de trouver un point d'équilibre entre ces deux ordres de
gouvernement. L'héritage qu'il nous a laissé -- à savoir le principe que les
gouvernements fédéral et provinciaux ont tous deux primauté dans les domaines
respectifs où ils détiennent le pouvoir de légiférer -- est l'un des thèmes
centraux de l'histoire canadienne.
Non seulement le Comité judiciaire s'est-il opposé aux tendances
centralisatrices inscrites dans la Constitution, mais, au fil des ans, il a su
façonner de manière fondamentale la répartition des pouvoirs dans la
Constitution.
Le Comité a créé des précédents selon lesquels, par exemple, les
principaux pouvoirs fédéraux, tels les pouvoirs «résiduels» et celui qui
touche le commerce, ont été interprétés de façon stricte, et selon lesquels
également la compétence des provinces touchant «la propriété et les droits
civils», s'est vu attribuer une acception large, ce qui donnera naissance à
toutes fins pratiques à un nouveau pouvoir résiduel.
En 1949, le Canada cessa d'en appeler au Comité judiciaire et la Cour
suprême devint le tribunal de dernière instance.
Depuis 1949, la Cour suprême a présidé à un renforcement général des
pouvoirs gouvernementaux aux niveaux tant fédéral que provincial à mesure que
la société et l'économie canadiennes devenaient plus complexes et plus
difficiles à gérer. Cependant, elle a pris soin de ne pas faire pencher
indûment la balance des pouvoirs d'un côté ou de l'autre.
Si un gouvernement est insatisfait de la décision judiciaire concernant une
affaire, quelle qu'elle soit, il peut tenter de faire modifier la Constitution,
bien que ce ne soit pas une démarche facile. La Saskatchewan et l'Alberta ont
cependant réussi, dans l'Accord de 1981, à faire modifier l'article 92 de
manière à renforcer la compétence des provinces en matière de richesses
naturelles en ce qui a trait aux impôts et aux exportations interprovinciales.
La Charte des droits, adoptée en 1982, a sensiblement élargi la portée de
l'examen judiciaire au Canada. Maintenant, non seulement les lois d'un
gouvernement doivent-elles relever de sa compétence législative, mais elles
doivent en outre être conformes aux dispositions de la Charte.
Même si la Charte habilite davantage les tribunaux à prescrire, à la
lumière des droits et libertés fondamentaux, des normes constitutionnelles
régissant les rapports entre l'État et la société et, partant, à
transformer la société canadienne, la Charte ne régit pas directement la
répartition des pouvoirs entre Ottawa et les provinces, laquelle tombe encore
le plus souvent sous les articles 91 à 95.
Le rapatriement, la formule de
modification et le renouvellement de la Constitution
Lorsque l'indépendance du Canada fut reconnue en principe, en 1926, dans le
Rapport Balfour, les Canadiens se retrouvèrent devant la nécessité de mettre
au point, à l'égard de la Constitution (alors une loi britannique), une
formule de modification qui leur permettrait de la rapatrier et de veiller à
son évolution future sans devoir faire appel à un Parlement étranger.
Avant 1968, on a toujours discuté de la formule de modification en
elle-même -- en 1927, 1931, 1935-1936, 1950, 1960-1961, et 1964 -- sans faire
de liens avec d'autres questions susceptibles d'être modifiées en profondeur.
Finalement, ces discussions échouèrent toutes et les modifications formelles
à la Constitution canadienne demeurèrent par conséquent soumises au pouvoir
législatif britannique lorsque le Statut de Westminster fut adopté en 1931 et
l'indépendance du Canada fut reconnue en droit.
En 1968, le Premier ministre du Canada et tous ses homologues provinciaux
décidèrent d'amorcer, pour la première fois dans l'histoire du Canada, un
vaste processus de renouvellement constitutionnel qui devait comprendre non
seulement le rapatriement et une formule de modification, mais également des
changements aux institutions nationales et à la répartition des pouvoirs, de
même que la consécration des droits dans la Constitution.
À la Conférence de Victoria, en 1971, une série limitée de propositions
firent l'objet d'une entente de principe, mais elles ne furent finalement pas
adoptées et la Constitution demeura une loi britannique. Une tentative de moins
grande envergure eut lieu en 1975-1976 en vue de procéder au rapatriement et
d'établir du même coup une formule de modification, sans toutefois apporter de
changements de fond à la Constitution; mais elle échoua, elle aussi.
En 1976, comme le Québec réclamait déjà depuis des années un
renforcement des pouvoirs des provinces, l'élection du Parti Québécois, sur
la base d'un programme préconisant que la province prenne de bonnes distances
face au reste de la fédération canadienne, sembla rendre encore plus
impérieux le renouvellement de la Constitution. Le gouvernement fédéral
répondit en juin 1978 en publiant Le temps d'agir dans lequel il
exposait sa vision du renouveau constitutionnel. Entre octobre 1978 et février
1979, les gouvernements s'employèrent activement à discuter d'un programme en
douze points visant à modifier la Constitution, mais la Conférence des
premiers ministres tenue en février aboutit encore une fois à une impasse : on
ne s'était entendu sur aucun changement.
À la fin de 1979, le gouvernement du Parti Québécois publia sur le
fédéralisme canadien un document dans lequel il réclamait une modification en
profondeur des rapports entre le Québec et le Canada. Dans ce document, on ne
préconise pas le retrait complet du Québec des institutions canadiennes, mais
on prône plutôt l'établissement, entre Québec et Ottawa, d'un
«partenariat» très souple appelé «souveraineté-association». On fixa au
20 mai 1980 la date d'un référendum visant à obtenir le mandat de négocier
une telle entente. Le 14 mai, le Premier ministre du Canada promit aux
Québécois un «fédéralisme renouvelé» s'ils votaient non au référendum.
«Je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel, déclara-t-il,
qu'à la suite d'un non, nous allons mettre en marche immédiatement le
mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant
que ça soit fait.» Six jours plus tard, les Québécois décidaient de ne pas
accorder à leur gouvernement le mandat sollicité.
Les résultats du référendum et l'engagement pris par le Premier ministre
du Canada et par la majorité de ses homologues provinciaux au cours de la
campagne référendaire suscitèrent des tentatives vigoureuses en vue de
rapatrier la Constitution. Une série de réunions ministérielles
fédérales-provinciales eurent lieu durant l'été en préparation de la
Conférence des premiers ministres, tenue en septembre 1980.
Certaines des grandes questions discutées au cours des réunions de l'été
reflétaient les priorités que le gouvernement fédéral s'était lui-même
fixées : rapatriement de la Constitution assorti d'une formule de modification
proprement canadienne, énoncé de principes, charte des droits, engagement
constitutionnel à atténuer les inégalités économiques régionales (parfois
appelé «péréquation»), et renforcement des pouvoirs fédéraux sur
l'économie nationale.
D'autres difficultés surgirent du fait que les provinces réclamaient depuis
longtemps un renforcement de leurs pouvoirs dans certains domaines : richesses
naturelles, communications et radiodiffusion, droit de la famille, ressources
marines et pêches. Les provinces réclamèrent également la réforme du Sénat
et de la Cour suprême du Canada afin que ces institutions reflètent mieux le
caractère fédéral du Canada.
Les priorités des provinces reprenaient des questions qui avaient été
soulevées au cours des discussions de 1978-1979 et avaient une orientation
similaire à celle des positions prises par l'Association du Barreau canadien
(1978), par le groupe de travail Pepin-Robarts (1979) et par le Parti libéral
du Québec dans son Livre beige (1980).
À la conférence de septembre, cependant, les premiers ministres ne purent
faire l'unanimité sur aucun point. Aussi, le 6 octobre 1980, le gouvernement
fédéral exprima-t-il son intention de rapatrier la Constitution de façon
unilatérale, sans l'assentiment des premiers ministres provinciaux, en
présentant à la Chambre une adresse commune à la Reine.
Huit provinces s'élevèrent immédiatement contre cette action unilatérale.
Le Manitoba, le Québec et Terre-Neuve soumirent la question à leurs tribunaux,
question que le gouvernement fédéral renvoya finalement à la Cour suprême du
Canada. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada statua qu'un
rapatriement « unilatéral » de la Constitution étal légal, mais
qu'un « degré appréciable » de consentement provincial était conventionnellement nécessaire
pour que les rapports fédéraux-provinciaux puissent être modifiés en
profondeur par une modification constitutionnelle demandée à la
Grande-Bretagne.
Dans la foulée de la décision de la Cour suprême, le gouvernement
fédéral convoqua une autre Conférence des premiers ministres pour le 2
novembre 1981. Ottawa et les provinces, à l'exception du Québec, arrêtèrent
finalement un train de mesures de réforme constitutionnelle, comprenant entre
autres le rapatriement de la Constitution assorti d'une formule de modification
et d'une charte des droits, un engagement face au principe de la péréquation,
le renforcement de la compétence des provinces à l'égard des richesses
naturelles, et la reconnaissance et la confirmation des droits existants des
peuples autochtones du Canada.
Cette entente représentait un compromis entre neuf provinces et le
gouvernement fédéral. Ces provinces acceptaient en effet la proposition
d'Ottawa d'adopter une charte des droits en échange du pouvoir de passer outre
à certaines parties de celle-ci en invoquant la« clause nonobstant », et de
l'inclusion d'une formule de modification mise au point par elles.
Cependant, le gouvernement du Québec demeura en dissidence, alléguant qu'il
n'avait pas été tenu compte des revendications du Québec, qu'une entente
avait été conclue à son insu et que le Premier ministre du Canada avait
manqué à sa promesse de «renouveler le fédéralisme». Le 1er décembre
1981, l'Assemblée nationale adopta une résolution rejetant la formule de
rapatriement. En effet, partout au Québec, nombreux furent ceux qui
ressortirent meurtris de l'expérience du rapatriement qui les laissa avec un
sentiment d'isolement.
L'Accord du lac Meech - 1987
Après la proclamation, le 17 avril, de la Loi constitutionnelle de 1982,
la Cour suprême du Canada statua que le Québec ne possédait pas de droit de
veto sur le rapatriement de la Constitution, ni en vertu d'une loi ni par
convention. Par conséquent, le Québec était lié légalement par la Loi
constitutionnelle de 1982.
Cependant, tant le gouvernement que l'Assemblée nationale du Québec
refusaient d'accepter les conditions sur lesquelles le Premier ministre et les
neuf premiers ministres provinciaux s'étaient entendus le 5 novembre 1981 pour
le rapatriement et dénonçaient la légitimité politique de la Loi
constitutionnelle de 1982 qui, en vertu de la Charte, réduisait les
pouvoirs de l'Assemblée nationale sans l'assentiment de celle-ci. Pour signaler
son rejet de la légitimité politique de la loi, le Québec entreprit
d'invoquer la «clause nonobstant» (ou de retrait) de la Charte automatiquement
et systématiquement dans toutes ses lois.
En mai 1985, le Parti Québécois rendit public son Projet d'accord
constitutionnel qui comprenait 22 conditions à l'acceptation de la légitimité
de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces conditions auraient modifié
en profondeur la répartition constitutionnelle des pouvoirs et auraient
soustrait le Québec à l'application de la plus grande partie de la Charte
canadienne des droits et libertés. Il n'y eut aucune discussion
intergouvernementale sur cette proposition.
En décembre 1985, le Parti libéral du Québec fut porté au pouvoir et,
quelques mois plus tard, exprima son désir de réintégrer le giron
constitutionnel aux cinq conditions qui sont énoncées dans sa plate-forme
politique intitulée Maîtriser l'avenir. Le nouveau gouvernement du Québec a
également cessé d'invoquer automatiquement la « clause nonobstant » dans
toutes ses nouvelles lois.
Le retour du Québec devint la priorité de tous les premiers ministres à
leur réunion annuelle, tenue en août 1986, et ils s'entendirent pour
approfondir davantage les discussions en novembre 1986. Le 30 avril 1987, au lac
Meech,
une entente de principe fut conclue sur une série de modifications et, le 3
juin de la même année, à l'édifice Langevin, les premiers ministres
s'entendirent sur le texte juridique de l'entente. Les cinq principaux
éléments de l'entente étaient les suivants : une clause d'interprétation
constitutionnelle touchant la dualité linguistique du Canada et le caractère
distinct du Québec, un droit de veto constitutionnel à toutes les provinces
applicable aux questions institutionnelles, la participation des provinces à la
nomination des juges de la Cour suprême, la compensation versée aux provinces
qui exerçaient leur droit de retrait de tout nouveau programme national à
frais partagés à certaines conditions et le renforcement des pouvoirs
provinciaux en matière d'immigration.
Comme l'Accord du lac Meech comportait des modifications requérant une
approbation unanime sur le plan législatif - aucun délai n'était prescrit à
cet égard - de même que des modifications requérant l'autorisation du
Parlement et des deux tiers des assemblées législatives représentant au moins
50 p. 100 de la population - auquel cas un délai de trois ans était prévu -
il fut décidé
que la résolution constitutionnelle promulguant l'accord devait être
adoptée par toutes les assemblées législatives ainsi que le Parlement;
qu'elle devait être ratifiée à l'unanimité dans une période maximale
de trois ans.
Cependant, l'Accord du lac Meech ne put finalement être ratifié dans le
délai de trois ans et avorta le 23 juin 1990.
L'Accord de Charlottetown
L'Accord du lac Meech a échoué parce qu'il n'avait pas pu être adopté par
les Assemblées législatives de Terre-Neuve et du Manitoba dans le délai de
trois ans prévu. Même s'il avait été adopté par la Chambre des communes -
à deux reprises - et par toutes les autres assemblées législatives
provinciales, l'échec de l'Accord laissait chez beaucoup de Québécois
francophones le sentiment d'avoir été «rejetés» par le Canada anglais. Le
nationalisme battait son plein et, le 24 juin, le jour de la
Saint-Jean-Baptiste, les rues de Montréal grouillaient de drapeaux
fleurdelisés.
Les sondages indiquaient que plus de 60 p. 100 des Québécois auraient voté
en faveur de la souveraineté si un référendum avait été tenu à ce
moment-là. Et les souverainiste ont réclamé justement la tenue immédiate d'un
référendum.
Partout ailleurs au Canada, l'émotion était forte aussi. Dans certains
milieux, on invitait le Québec à accepter d'être une province au même titre
que les autres ou de se retirer - ce qui ne se ferait pas nécessairement dans
les conditions les plus généreuses. Certains groupes ne dissimulaient pas non
plus le ressentiment qu'ils éprouvaient d'avoir été exclus de la «ronde
Québec» et voulaient que soient entendues et réglées leurs revendications
constitutionnelles.
Face à cette situation, tous les gouvernements eurent recours à des
mécanismes de consultation pour se faire une idée de l'opinion de la
population, pour étendre la portée du débat, pour répondre aux
préoccupations de la population canadienne et pour rétablir le calme. Le
gouvernement fédéral créa le Forum des citoyens sur l'avenir du Canada pour
étudier les valeurs communes aux Canadiens et un comité mixte spécial, le
Comité Beaudoin-Edwards, qu'il chargea d'examiner la formule de modification.
Une Commission royale sur les peuples autochtones fut également établie.
Le 28 septembre 1991, le gouvernement du Canada publia Bâtir ensemble
l'avenir du Canada, une série de propositions constitutionnelles très
étendues portant, entre autres, sur les sujets suivants : l'identité
canadienne, le caractère distinct du Québec, les peuples autochtones, la
réforme des institutions nationales, l'union économique, la clarification de
la répartition des pouvoirs, y compris le pouvoir de dépenser, pour mieux
servir les Canadiens et la rationalisation des services gouvernementaux. Le
gouvernement fédéral publia également, pour faciliter le débat public, une
série de documents de fond sur les questions constitutionnelles.
Les propositions mises de l'avant dans Bâtir ensemble l'avenir du Canada
furent confiées à un comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada -
plus tard connu sous le nom de Comité Beaudoin-Dobbie. Le gouvernement du
Canada convoqua une série de cinq conférences nationales pour discuter des
divers aspects des propositions de renouvellement constitutionnel. En février
1992, après la dernière des cinq conférences, le Comité Beaudoin-Dobbie
publia son rapport intitulé Un Canada renouvelé. Le rapport du
Comité servit en partie de point de départ à des négociations
multilatérales d'envergure entre le gouvernement du Canada, les gouvernements
provinciaux (y compris le Québec aux dernières phases des négociations), les
gouvernements territoriaux et les représentants des peuples autochtones. Ces
négociations, auxquelles participaient 17 délégations, débouchèrent sur un
accord constitutionnel unanime à Charlottetown
le 28 août 1992.
L'Accord de Charlottetown prévoyait le droit inhérent des Autochtones à
l'autonomie gouvernementale, la reconnaissance du caractère distinct du
Québec, une clause Canada, un Sénat fondé sur le principe de la
représentation égale, un droit de veto pour toutes les provinces sur toute
réforme ultérieure des institutions à l'exception de la création de
nouvelles provinces dans les territoires, le renforcement de l'autorité
législative des provinces, un meilleur reflet de la représentation selon le
chiffre de la population à la Chambre des communes et une garantie à
perpétuité pour le Québec d'obtenir au moins 25 p. 100 des sièges à la
Chambre des communes.
Les premiers ministres avaient également convenu à Charlottetown de tenir
deux référendums le 26 octobre : un référendum fédéral dans tout le
Canada, sauf au Québec, et un référendum au Québec, tenu par cette province.
Pour des raisons d'ordre politique, les dirigeants avaient convenu que le oui
devrait l'emporter dans toutes les provinces pour que l'accord soit adopté,
même si la loi ne l'exigeait pas. Le 26 octobre, l'accord était rejeté par la
majorité des Canadiens dans la majorité des provinces, y compris la majorité
des Québécois et la majorité des Indiens vivant dans des réserves.
Cependant, les résultats obtenus étaient un pis-aller : les Québécois
n'avaient pas été rejetés par le reste du Canada, le reste du Canada n'avait
pas été rejeté par le Québec, et les peuples autochtones n'avaient pas non
plus été rejetés. Ce climat contribua au calme qui suivit le référendum,
calme qui contrastait avec ce qui s'était passé après l'échec de l'Accord du
lac Meech.
Modifications proclamées depuis 1982
Les échecs frappants qu'ont connus les tentatives de modifier la
Constitution en vertu des Accords du lac Meech et de Charlottetown ont
peut-être donné l'impression qu'il est impossible de modifier la Constitution.
Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, depuis l'adoption de la formule de
modification en 1982, sept modifications y ont été apportées par
proclamation.
La première, dite « Proclamation de 1983 modifiant la Constitution », a
pris effet en 1984 et avait trait aux droits des Autochtones. La deuxième,
intitulée « Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) »,
portait sur l'inscription dans la Constitution des droits des écoles
confessionnelles des Assemblées de la Pentecôte à Terre-Neuve. La troisième,
dite « Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick) », a
consacré l'égalité des communautés francophone et anglophone du
Nouveau-Brunswick. La quatrième, intitulée « Modification constitutionnelle
de 1994 (Île-du-Prince-Édouard) », a dégagé le Canada de l'obligation
d'assurer un service de bateau à vapeur à l'Île-du-Prince-Édouard une fois
que serait achevée la construction d'un « raccordement permanent » entre
l'île et le Nouveau-Brunswick. La cinquième, désignée « Modification
constitutionnelle de 1997 (Loi de Terre-Neuve) », a élargi les pouvoirs de la
législature de Terre-Neuve en matière d'organisation et d'administration du
système provincial d'écoles confessionnelles. La sixième, dite «
Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) », a dégagé le Québec de
l'obligation d'offrir des écoles confessionnelles, facilitant ainsi
l'établissement d'un système scolaire linguistique. La septième, «
Modification constitutionnelle de 1998 (Terre-Neuve) », a dégagé la province
de l'obligation d'offrir des écoles confessionnelles, lui permettant ainsi de
moderniser son système scolaire. La huitième modifie la Loi sur Terre-Neuve de
1949. Le terme province de Terre-Neuve est remplacé par celui de Terre-Neuve et
Labrador.
Évolution récente sans modification
constitutionnelle
En plus des modifications constitutionnelles formelles, la fédération
canadienne a connu une évolution graduelle grâce à une réforme non
constitutionnelle. Certains de ces changements font suite à des promesses
faites par le Premier ministre Jean Chrétien aux Québécois dans un discours
prononcé à Verdun le 24 octobre 1995, lorsque la campagne référendaire du
Québec sur la souveraineté tirait à sa fin. Le Premier ministre avait promis
de reconnaître le Québec comme société distincte au sein du Canada, de
n'apporter aucune modification constitutionnelle touchant le Québec sans
l'assentiment de celui-ci et de prendre des décisions et d'offrir des services
qui répondent davantage aux besoins des citoyens.
Le référendum du Québec s'est déroulé le 30 octobre 1995, et le mandat
pour la souveraineté a été rejeté par un vote de 50,6 p. 100 pour le
non contre 49,4 p. 100 pour le oui.
En décembre 1995, à la suite du référendum, la Chambre des communes et le
Sénat ont adopté une résolution reconnaissant que le Québec est une
société distincte au sein du Canada. Plus précisément, la résolution
proclamait le caractère distinct du Québec de par sa culture, sa tradition de
droit civil et sa majorité francophone. En vertu de la résolution, la Chambre
des communes et le Sénat « s'engagent à se laisser guider par cette réalité
» et « incitent tous les organismes des pouvoirs législatif et exécutif (du
gouvernement du Canada) à prendre note de cette reconnaissance et à se
comporter en conséquence. »
En outre, une forme de droit de veto fut accordée au Québec sur toute
modification constitutionnelle. Le 2 février 1996, le projet de loi C-110, la
loi sur les vetos régionaux, est entrée en vigueur. Le projet de loi stipule
que le gouvernement du Canada ne peut déposer au Parlement une motion de
résolution autorisant une modification de la Constitution que si le Québec,
l'Ontario, la Colombie-Britannique, les Prairies et la région de l'Atlantique y
ont préalablement consenti.
Dans le discours du Trône du 27 février 1996, le gouvernement fédéral a
consenti à un troisième élément d'évolution non constitutionnelle en
s'engageant à ne pas utiliser son pouvoir de dépenser pour créer de nouveaux
programmes cofinancés dans des domaines de compétence provinciale exclusive
sans le consentement de la majorité des provinces. Le gouvernement fédéral a
promis que tout nouveau programme serait conçu de telle sorte que les provinces
qui s'en dissocieraient seraient indemnisées, à condition qu'elles adoptent un
programme équivalent ou comparable.
Le gouvernement fédéral s'est aussi efforcé de clarifier son rôle par
rapport aux provinces dans des secteurs comme les mines, les forêts, les
loisirs, le logement social, le tourisme et la formation de la main-d'oeuvre.
En outre, le discours du Trône de 1996 proposait une nouvelle approche en
matière de mesures touchant la main-d'oeuvre selon lesquelles chaque ordre de
gouvernement assumerait ses responsabilités de la façon la plus efficace
possible. Depuis, des ententes sur la main-d'oeuvre ont été conclues avec neuf
provinces, dont le Québec, et deux territoires.
Le gouvernement du Canada est toujours déterminé à moderniser la
fédération et à travailler en partenariat avec les provinces. C'est pourquoi
il a adhéré au souhait des provinces de donner suite à la déclaration de
Calgary, qui poursuit le travail accompli après le référendum du Québec de
1995. Le gouvernement fédéral estime qu'une telle démarche de collaboration
renforcera l'unité nationale et contribuera à la reconnaissance pleine et
entière de la diversité du Canada, y compris du caractère unique du Québec.
(Texte préparé par les Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil
privé)

|