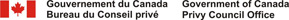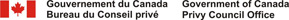|
Discours du Premier ministre Paul Martin à l’occasion de sa visite à Washington, D.C.
Avril 29, 2004
Washington, D.C.
DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
Seul le texte prononcé fait foi
Merci, Lee, de cette présentation fort aimable.
J’aimerais également vous remercier, de même que le Woodrow Wilson Center, et Nancy Birdsall et le Center for Global Development, de coparrainer cet événement.
C’est un privilège de discuter avec vous et avec cet auditoire distingué du regard que pose le Canada sur quelques unes des questions les plus importantes auxquelles fait face la communauté internationale.
Demain, je rencontre le Président Bush. Nous allons évoquer des dossiers bilatéraux liés au commerce, comme nos exportations de bois d’œuvre, où nos producteurs et vos consommateurs continuent de subir les contrecoups de notre inacapacité de résoudre ce conflit une fois pour toutes. Nous discuterons de l’ESB, la maladie de la vache folle. L’industrie nord américaine de l’élevage bovin est fortement intégrée, et elle exige l’ouverture sans délai de la frontière de manière à accroître la confiance à son égard dans nos pays et à l’étranger, une confiance fondée sur de solides connaissances scientifiques.
Bien franchement, nous sommes toujours étonnés de constater la rapidité avec laquelle la frontière peut être fermée lorsque des pressions sont exercées aux États Unis. Quinze ans après la conclusion de l’Accord de libre échange entre le Canada et les États Unis, dix ans après son élargissement pour inclure le Mexique dans le cadre de l’ALENA, nous devrions pouvoir faire mieux. Il nous faut reconnaître que notre économie est effectivement nord américaine; le Canada représente le marché extérieur le plus important pour 37 de vos États. Vous êtes le plus grand marché extérieur du Canada. Le protectionnisme ne rend service à personne.
Nous allons nous pencher aussi sur d’autres secteurs où une optique nord américaine sert les deux pays. Par exemple le réseau de distribution de l’électricité et l’environnement, où nous examinerons des façons d’intensifier la coopération bilatérale afin que nos deux pays puissent maintenir la salubrité de l’air et de l’eau.
Nous allons nous entretenir aussi de questions internationales, notamment notre engagement commun à promouvoir la démocratie et la dignité humaine, notre détermination à lutter contre l’abomination qu’est le trafic de personnes, et les mesures prises par nos deux pays pour renforcer notre sécurité intérieure, de même que la sécurité sur le continent et ailleurs dans le monde. C’est sur ce dernier sujet que je souhaite m’étendre aujourd’hui – du point de vue canadien sur la façon d’accroître notre sécurité à tous.
Le droit suprême de tout individu est le droit à la sécurité personnelle. Par conséquent, le premier devoir d’un gouvernement doit être de protéger ses citoyens. Cette responsabilité est mise à l’épreuve de nos jours par toute une série de menaces inédites : les États voyous, les États déliquescents ou en voie de l’être, les organisations criminelles internationales, la prolifération des armes et les terroristes prêts à agir au mépris des coûts humains, y compris leur propre vie.
S’il était protégé autrefois par les océans, le front s’étend de nos jours des rues de Kaboul aux villes américaines, des voies ferrées de Madrid aux villes canadiennes. Notre adversaire pourrait mener ses opérations dans les montagnes de l’Afghanistan, dans les villes d’Europe ou à l’intérieur de nos propres frontières. Il n’y a pas de front intérieur. Le conflit n’est pas « là bas ». Notre approche de la sécurité doit donc refléter cette réalité.
Au Canada, nous travaillons dans trois secteurs connexes, mais distincts – les mesures à prendre en territoire canadien, les mesures à mettre en œuvre avec le concours des États-Unis, et nos politiques extérieures visant à favoriser la sécurité dans le monde.
Nous venons de déposer au Parlement la toute première politique de sécurité nationale du Canada. Cette politique énonce les nombreuses mesures que nous avons adoptées depuis les événements du 11 septembre, et celles que nous prendrons, en vue de renforcer nos capacités en matière de sécurité, notamment la somme de 8 milliards $ qui sera dépensée pour combler les lacunes à cet égard.
En décembre dernier, le premier jour de mon entrée en fonction à titre de Premier ministre, nous avons créé le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. J’ai demandé à la vice-première ministre de diriger ce nouveau ministère pour signifier clairement notre détermination à assurer son bon fonctionnement dans l’ensemble de l’administration fédérale.
Nous procédons à l’amélioration et à l’intégration de nos capacités aux chapitres du maintien de l’ordre, du renseignement, des transports, de la santé publique, de la planification en cas d’urgence, et d’autres secteurs semblables. Nous renforçons également la coordination entre les divers paliers de gouvernement – ce qui pose un défi particulier dans un État fédéral décentralisé comme le Canada – et nous faisons participer le secteur privé à ces efforts.
Nous travaillons de près avec Tom Ridge pour que la frontière reste à la fois ouverte aux activités commerciales et touristiques légitimes, et sécuritaire. Le plan d’action pour la frontière intelligente porte fruit : les entreprises des deux côtés de la frontière ont pu constater les bienfaits qu’entraîne la réduction du temps d’attente et de la paperasserie, tandis que de nouvelles technologies et une coopération accrue ont amélioré notre capacité de détecter les déplacements à haut risque. Dans l’avenir, nous espérons, de concert avec le Mexique et les États Unis, appliquer le plan d’action à des secteurs comme la biosécurité, la sécurité des aliments et la sécurité maritime.
Pour le Canada et les États Unis, une collaboration plus poussée en matière de sécurité est chose naturelle. Notre sécurité est indivisible. Comme l’a démontré l’horreur des événements du 11 septembre, il est impossible d’imaginer un attentat ciblé contre le Canada ou les États Unis qui ne frapperait pas au plein cœur de nos valeurs communes, de notre amitié profonde et de nos intérêts nationaux vitaux.
Nous reconnaissons depuis longtemps que la défense de l’Amérique du Nord est aussi la défense du Canada. Pendant près de 50 ans, nous avons partagé avec notre voisin du Sud la responsabilité de la défense aérienne de l’Amérique du Nord par l’entremise du traité de NORAD. En 2002, nous avons mis sur pied un groupe binational de planification de la défense dans le but d’examiner les types d’attentat pouvant être perpétrés contre nous, de même que les mesures que nous pourrions adopter pour renforcer la sécurité de l’Amérique du Nord. Par exemple, des arrangements en vue du commandement conjoint de la défense maritime et l’aide militaire aux autorités civiles dans l’éventualité d’une urgence.
Une bonne défense signifie aussi que l’on intervient là où le besoin se fait sentir. Les soldats canadiens sont présents dans certains des points chauds les plus névralgiques de la planète. Presque 2000 troupes sont déployées en Afghanistan, et c’est un Canadien qui commande actuellement la Force internationale d’assistance à la sécurité (ISAF). Nous venons de renouveler notre engagement en Afghanistan; notre mission se prolongera donc au-delà de la date d’août 2004 fixée pour notre départ. De plus, un grand nombre de soldats sont encore déployés dans les Balkans, dans le golfe Persique et en Haïti.
Le fait demeure que le Canada se classe actuellement deuxième parmi les pays membres de l’OTAN en ce qui concerne le pourcentage de troupes déployées à l’étranger dans le cadre d’opérations multinationales. Nous devançons les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, et tous les autres sauf les Américains. Nous ne prévoyons pas non plus la disparition prochaine du genre de défis en matière de sécurité qui se pose. C’est pourquoi nous avons annoncé récemment des décisions majeures au chapitre de l’approvisionnement pour faire en sorte que nos militaires aient l’équipement nécessaire pour faire leur travail.
La description de notre approche fait aussitôt, et clairement, ressortir de nombreux secteurs où il y a cause commune avec les politiques américaines. On peut constater également des divergences par rapport à d’autres secteurs. Ça toujours été le cas, et c’est l’un des aspects remarquables – sinon le plus remarquable – de la relation entre le Canada et les États Unis, le fait qu’au fil des ans, nos differences nous ont distingué l’un de l’autre, mais sans jamais nous diviser. Dans le cas de l’Iraq, nous ne nous sommes pas joints aux forces de la coalition. Je crois qu’il s’agissait d’une bonne décision pour le Canada, et les Canadiens l’ont appuyée.
Cela dit, il n’y a pas de désaccord quant au travail à faire. À cette fin, le Canada s’est engagé à verser 300 millions $ pour aider le peuple irakien à reconstruire son pays et à établir une gouvernance responsable et démocratique. Nous offrons déjà en Jordanie de la formation aux forces policières irakiennes, et à mesure que le permettra la situation, nous intensifierons nos efforts à ce chapitre et dans d’autres secteurs liés au renforcement des institutions.
Nous sommes prêts aussi, conjointement avec nos partenaires du Club de Paris, à faire grâce des dettes de l’Irak à l’égard du Canada, qui sont de l’ordre d’environ 750 millions $. Nous convenons du fait que plus tôt l’ONU pourra retourner en Irak, mieux ce sera. Jusqu’à présent, les politiques que je vous ai décrites, y compris le besoin d’envoyer des troupes à l’étranger, sont surtout de nature défensives, conçues pour contrer les menaces qui pèsent contre nous.
Ce débat revêt cependant une autre dimension, issue du besoin de gérer en même temps et sur beaucoup de fronts les défis posés par la mondialisation. Sur le plan économique, les bienfaits de la mondialisation ont été énormes. Mais ils sont loin d’être répartis également, et beaucoup trop de pays sont laissés pour compte. Même si un plus grand nombre de personnes jouissent d’une meilleure qualité de vie qu’auparavant, l’écart absolu entre riches et pauvres s’accroît.
Nous sommes tous d’accord que cela ne peut continuer. Beaucoup d’encre a coulé dans les tentatives de remédier à cette situation, qui constitue le plus grand dilemme moral du monde. On a moins analysé toutefois un autre aspect de la mondialisation, qui touche directement à notre besoin de sécurité accrue.
La révolution informationnelle a permis de répandre des idées sur les droits de la personne et la liberté politique qui ont transformé des régions entières, mais qui ont aussi créé des tensions – ethniques, religieuses ou culturelles – dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Ces tensions au sein d’États déliquescents ou en voie de l’être, ou dans les pays qui ne peuvent soutenir le rythme du changement dans le monde, sont l’équivalent d’une poudrière qui attend une allumette.
Une vraie sécurité va bien au delà de la simple défense contre des attaques. Elle passe par la conviction que nous serons véritablement en sécurité le jour où les citoyens dans tous les pays pourront participer pleinement à la vie nationale, lorsqu’ils verront clairement que leur propre bien être et leur liberté exigent l’existence d’un État fonctionnel qui les écoute et qui, en dernière analyse, leur rend des comptes. Les mots clés ici sont « fonctionnel » et « rend des comptes ».
Si nous avons appris une seule chose après avoir versé de l’aide à l’étranger pendant des décennies, c’est qu’un pays ne réussira pas – ne peut réussir – s’il ne se dote pas d’institutions publiques qui fonctionnent bien; et le meilleur moyen de s’assurer que ces institutions fonctionnent bien est de les obliger à rendre des comptes aux populations qu’elles servent. L’aide étrangère est importante, certes, mais ses bienfaits sont manifestement limités en l’absence d’institutions fonctionnelles et responsables.
Nous en avons été témoins en Haïti. Il y a près de 10 ans, le Canada, les États-Unis et d’autres pays intervenaient pour aider à ramener le président démocratiquement élu au pouvoir. Nous n’avons pas lésiné sur l’aide, et nous sommes engagés solennellement à aller jusqu’au bout. Le problème, c’est que nous n’avons pas réussi à édifier les structures institutionnelles dont Haïti avait besoin pour pouvoir se tenir debout tout seul. Aujourd’hui, nous sommes de retour là-bas. De fait, le Canada a été le premier pays à y dépêcher ses troupes. Cette fois-ci, la communauté internationale doit rester jusqu’à ce que la tâche soit bien accomplie.
Le Canada en a fermement l’intention. En effet, l’un des volets particuliers de notre rôle dans le monde consistera à cibler davantage nos efforts de manière à permettre aux pays qui ont besoin de notre aide à bâtir les institutions gouvernementales modernes qu’il leur faut pour assurer la sécurité de leurs citoyens et pour donner à ces derniers les moyens de mener une vie décente.
Au Canada, nous faisons référence aux trois D – défense, diplomatie et développement. Cela veut dire que nous intégrons rigoureusement nos instruments de politique étrangère traditionnels, surtout lorsqu’il s’agit de répondre au besoin des États vulnérables de renforcer leur propre capacité de se gouverner. Comme il a été démontré en Afghanistan, même la présence de troupes étrangères ne peut garantir la sécurité à moins que l’on parvienne à une entente sur le plan politique. De la même façon, il n’y aura pas d’entente politique sans sécurité. Et un développement économique convenable nécessite les deux – sécurité et stabilité politique – pour pouvoir porter fruit.
L’élément commun aux trois « D » est le renforcement des moyens dans tous les aspects de la gouvernance. Trop souvent, les gens ne prêtent attention qu’à un seul élément, au détriment des autres. Nous constatons cette approche lors de débats sur la sécurité publique. Les experts nous recommandent de donner un peu de formation aux policiers, de construire une prison ou deux, et puis, quand la situation revient à la normale, de quitter.
À notre avis, c’est insuffisant. L’approche « 3 D » englobe l’édification d’institutions publiques qui fonctionnent bien et qui rendent compte de leurs actions à la population. « Non seulement en ce qui concerne le maintien de l’ordre », mais les ministères, le système juridique, les tribunaux, les commissions des droits de la personne, les écoles, les hôpitaux, les réseaux d’énergie, d’eau et de transports. Cela signifie qu’il faut déployer des efforts à plusieurs niveaux et en même temps, d’une façon qui permet aux différents éléments de se renforcer les uns les autres. Cela suppose aussi l’existence d’un secteur privé dynamique.
L’an passé, Ernesto Zedillo et moi même avons coprésidé la Commission des Nations Unies pour le secteur privé et le développement. Notre rapport contenait un certain nombre de recommandations, mais un message ressortait clairement de nos reflexions. L’économie d’aucun pays ne peut évoluer à moins que soient créées les conditions dans lesquelles la population peut avec confiance investir dans son propre avenir. Et cela ne se produira pas sans la mise en place des institutions qui assurent la stabilité et qui mettent un frein à la corruption.
Si on se fie aux manchettes d’aujourd’hui, le besoin de renforcer les institutions dont je vous parle est le plus criant en Irak. Mais c’est vrai aussi de pays où, même s’il n’y a pas eu de conflit dernièrement, on a besoin de notre aide pour créer les institutions nécessaires ou pour éviter l’érosion des institutions gouvernementales en place. L’Afrique est un exemple où des dirigeants prennent des mesures décisives pour renforcer leurs institutions, tant sur le plan national que régional. Et ils le font par l’entremise du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) – une initiative que soutiennent le Canada, les États Unis et les autres partenaires du G8 par la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique.
Le renforcement des institutions peut paraître une tâche simple, mais dans la réalité, c’est très difficile. La ligne de démarcation entre aide et ingérence est ténue. Il faut promouvoir des méthodes de gestion modernes sans rejeter les traditions locales qui sont valorisées.
Il n’existe aucun plan détaillé, mais, comme dans tant d’autres domaines, ce bon vieux conseil est toujours valable : tirez parti de vos atouts, et c’est pourquoi nous croyons que le Canada peut jouer, et jouera, un rôle important, à mesure que les pays en proie à des difficultés saisissent la nécessité d’édifier les institutions d’une gouvernance moderne. Lorsque je pense aux atouts canadiens, j’ai à l’esprit les premiers rudiments de notre pays.
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, notre première constitution, accordait au Parlement le pouvoir de légiférer pour assurer « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » au Canada. Ce n’est pas là une expression qui nous fait palpiter d’émotion, mais elle n’est pas loin d’être la recette quand on veut construire pour le long terme. Les temps ont changé, et ce que les Canadiens attendent de leur gouvernement a changé également, mais « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » ont toujours été la formule juste d’après laquelle mesurer la performance de nos institutions.
Nous avons, à mon avis, un autre atout dans cette entreprise, un atout qui remonte à la fondation du Canada. Lorsque nous avons débuté comme pays, nous avons réussi à regrouper en une seule communauté politique deux groupes linguistiques et deux grandes confessions religieuses. Au fil des ans, nous avons ajouté une riche mosaïque de langues, d’ethnies et de religions, et nous nous sommes efforcés de répondre aux préoccupations et aux revendications de nos peuples autochtones. Certains aiment dire que le Canada a été le premier État « post-moderne », le premier pays à rejeter expressément l’idée selon laquelle un État signifie un seul peuple, un seul groupe ethnique, avec une seule langue et une seule culture. Le Canada ne s’est jamais présenté comme un « creuset »; nous nous sommes toujours considérés comme une « mosaïque ».
C’est peut-être la raison pour laquelle le Sri Lanka s’est adressé à des spécialistes canadiens pour qu’ils l’aident à développer une solution fédérale à ses querelles interethniques. Ainsi, en tant que grande nation industrialisée, mais jamais à titre de puissance coloniale ou de superpuissance, le Canada jouit de certains avantages particuliers, car il se focalise aujourd’hui beaucoup plus qu’il ne l’a fait dans le passé sur le renforcement des institutions, fondement essentiel selon lui d’un État moderne et sûr. Ces avantages qui serviront de lignes de force dans notre politique étrangère.
Jusqu’à maintenant, j’ai parlé de renforcement des institutions et de meilleure gouvernance dans les pays, mais ce n’est là qu’un côté de la médaille. Il y a aussi l’urgent besoin de faire en sorte que les systèmes internationaux et les institutions multilatérales fonctionnent plus efficacement. Il se trouve que nous avons besoin d’une meilleure gouvernance internationale afin que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement et que les pays moins pourvus soient dispensés de certains des coûts inévitables de cette mondialisation. Il nous faut des institutions multilatérales qui fonctionnent parce que, malgré leurs nombreux défauts, elles portent en elles une légitimité qu’aucun pays ne peut à lui seul revendiquer. Elles défendent le principe selon lequel chaque pays mérite de siéger à la table, car il a des intérêts légitimes à faire valoir et des valeurs à faire respecter. Bien sûr, il est facile de déplorer que telle ou telle institution ne fonctionne pas, mais cessons de rejeter la responsabilité sur les autres. Les institutions multilatérales, ce sont nous, les États membres souverains. Nous sommes responsables de leur fonctionnement, qu’il soit bon ou mauvais. La plupart d’entre nous admettront que la réforme de nombreuses institutions internationales, qu’elles soient ou non de la famille des Nations Unies, est nécessaire, et je n’entends pas aujourd’hui m’appesantir sur de telles évidences.
Il y a cependant une proposition que j’aimerais faire. La responsabilité d’une bonne gouvernance internationale retombe principalement sur les épaules des dirigeants politiques des États souverains. Mais il y a ici un réel problème; nombre des organisations internationales d’aujourd’hui ne sont pas conçues pour faciliter les débats politiques informels qui s’imposent entre politiciens.
En bref, les dirigeants ne peuvent prendre les décisions hardies qui sont nécessaires si les tribunes internationales continuent de se limiter strictement à ratifier les résultats de négociations d’ordre administratif. Les échanges les plus fructueux entre dirigeants ont souvent lieu dans les coulisses de grandes réunions, en tête-à-tête, très loin du programme officiel. Quand des dirigeants se rencontrent à la faveur de tribunes internationales, il est difficile pour eux de se libérer du syndrome du « dossier d’information » et d’en venir aux choses sérieuses, à une réflexion qui sorte des sentiers battus. Le débat que peuvent engager des fonctionnaires ou des diplomates a nécessairement ses limites : seuls des dirigeants politiques peuvent faire le saut qui est si souvent nécessaire pour rompre une impasse intellectuelle, émotionnelle ou historique.
Les séances de photos ne sauraient remplacer la volonté politique. Il nous faut trouver le moyen pour que les dirigeants politiques travaillent les uns avec les autres sur le plan international, comme ils travaillent chez eux avec divers groupes intéressés – en débattant, en explorant et en cherchant des solutions axées sur des valeurs qui unissent au lieu de diviser, qui stabilisent au lieu de détruire, qui soient pragmatiques plutôt qu’idéologiques.
Comment faire pour y arriver? Une approche que je crois judicieuse consisterait à examiner les enseignements reçus des ministres des Finances du Groupe des 20, un groupe qui a été formé dans le sillage de la crise financière asiatique survenue en 1997. Nous présagions un regroupement informel de ministres des Finances, représentant des centres d’influence établis ou nouveaux, et venant d’horizons politiques, économiques, culturels et religieux très divers. Nous voulions en finir avec la mentalité « nous contre eux » dont souffrent de nombreuses réunions internationales, et cela a fonctionné remarquablement bien – parce que la pression des pairs est souvent un moyen très efficace de forcer des décisions.
Nous croyons qu’une approche semblable parmi les dirigeants pourrait contribuer à résoudre certains des problèmes les plus difficiles auxquels le monde est confronté. Nous devons réunir dans la même salle la bonne combinaison de pays, pour qu’ils échangent leurs idées sans scénario préétabli. Nous ne proposons pas une nouvelle institution faite de briques et de mortier, mais nous croyons vraiment qu’une nouvelle approche faisant intervenir directement les dirigeants politiques pourrait contribuer à rompre de nombreuses impasses. Je proposerais que nous convoquions un groupe de pays du Nord et du Sud pour qu’ils s’attaquent seulement à un problème, et que nous voyions où cela nous mène – ce pourrait être le terrorisme ou la santé publique à l’échelle mondiale. Dans le contexte du débat d’aujourd’hui, la santé publique est tout autant un problème de sécurité que l’est le terrorisme. Par exemple, les États-Unis, le Canada et les autres pays du G8, par leur travail au sein des Nations Unies, ont fait beaucoup pour élaborer une réponse pleine d’humanité à la crise du SIDA qui sévit en Afrique.
Au Canada, notre Parlement adopte des modifications législatives pour permettre aux entreprises canadiennes de fournir aux pays d’Afrique, pour un coût modeste, des médicaments antirétroviraux génériques. Nous sommes le premier pays industrialisé à présenter un texte de loi avant gardiste de cette nature. J’en suis très fier.
Toutefois, le besoin de médicaments bon marché dépasse le problème du SIDA et l’Afrique. N’est-il pas possible de parvenir à un équilibre entre le besoin incontestable de droits de propriété intellectuelle, qui financent en grande partie la recherche médicale, et la nécessité tout aussi évidente d’aider à soulager la souffrance des personnes qui n’ont pas les moyens d’acquérir les fruits de cette recherche? Les dirigeants d’un G-20 pourraient aussi traiter d’autres questions, par exemple sauver la ronde actuelle de négociations commerciales multilatérales, dont le principal obstacle est l’agriculture. En effet, l’agriculture ne se résume pas à un simple enjeu commercial de nature purement économique.
Dans des pays comme la France, le Japon et les États-Unis, il constitue avant tout une question politique que seuls les dirigeants politiques du plus haut niveau peuvent régler. Tout le monde convient qu’un échec de la série de pourparlers de Doha ne profiterait à personne, mais cette possibilité se profile pourtant à l’horizon. Si les négociations échouent, de nombreux pays considéreront à tort ou à raison que les mécanismes internationaux que nous avons établis au fil du temps ne fonctionnent pas pour eux, même s’ils sont utiles pour certains.
Ce projet étant de la plus haute importance pour notre sécurité, nous enverrions ainsi un mauvais signal, alors même que nous tentons de rassurer certains pays que nous nous préoccupons de leur avenir et que nous désirons les voir profiter de la mondialisation et prospérer.
Il est clair que nos institutions multilatérales ont besoin d’aide. Nous devons réaliser des réformes institutionnelles majeures, et agir dans ce sens sans tarder. Cela dit, la réforme prendra du temps, mais nous ne devons pas permettre qu’elle serve de prétexte à l’inaction.
Nous devons suivre une démarche à deux voies : entreprendre en premier lieu une réforme institutionnelle multilatérale; traiter en deuxième lieu des dossiers urgents comme l’assainissement de l’air, l’eau, les maladies contagieuses, l’accès au marché des produits agricoles et le terrorisme mondial.
Je pense d’ailleurs que le fait de commencer à répondre sérieusement à ces dilemmes pressants faciliterait une réforme institutionnelle attendue depuis longtemps. Bref, que le fonds passe avant la forme. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes complexes. Permettez moi donc de vous en donner un autre exemple illustrant le fait que la réforme institutionnelle et la résolution de problèmes particuliers sont des objectifs qui se renforcent mutuellement, toujours dans le contexte d’une sécurité accrue pour tous.
Dans la plupart des débats sur la saine gouvernance, tant à l’intérieur de chaque pays qu’à l’échelon international, nous partons du principe selon lequel la plupart des gouvernements préfèrent bien travailler pour le compte de leurs citoyens plutôt que de demeurer dans un isolement malsain. Malheureusement, nous savons que ce n’est pas toujours le cas.
Comment réagir face aux pays qui refusent de faire les premiers pas vers une citoyenneté nationale ou mondiale responsable? Que devons-nous faire quand leur population est confrontée à une catastrophe humanitaire? Que devons-nous faire lorsque les gens baignent dans une culture de haine ou de violence alimentée par leur propre gouvernement, comme cela a été le cas au Rwanda?
Si un gouvernement viole toutes les normes associées à ce qu’on appelle une conduite responsable, avons-nous, en tant que communauté internationale, la responsabilité de protéger (comme, dans cet exemple, de protéger la population d’un pays de son propre gouvernement)? Récemment, une Commission d’experts internationaux mandatée par l’ONU a répondu par l’affirmative à cette question et a énoncé diverses sortes d’interventions acceptables, par exemple l’imposition de sanctions ou, dans certaines conditions, l’intervention militaire – avec l’approbation des « autorités compétentes ».
Au Canada, nous sommes largement d’accord avec Kofi Annan lorsqu’il déclare : « ... ce qui est certain, c’est qu’aucun principe juridique – même pas celui de la souveraineté – ne saurait excuser des crimes contre l’humanité ». Lorsque les circonstances l’exigent, comme ce fut le cas au Rwanda ou au Kosovo, des interventions humanitaires sont justifiables. Nous ne souscrivons pas à la thèse voulant que les États jouissent d’une immunité absolue en vertu du principe de la souveraineté étatique. Comme l’a souligné Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, « la neutralité aide toujours l’oppresseur, jamais l’opprimé ».
En fait, il faudrait amorcer un débat ouvert sur la nécessité d’intervenir dans les cas où sont bafoués les préceptes les plus fondamentaux de notre humanité à tous. Nous devons convenir clairement de principes qui nous aideront à déterminer quand il est approprié de recourir à la force pour appuyer des objectifs humanitaires.
Certains pourraient penser que tout cela nous éloigne du plan d’action en matière de sécurité que nous devons mettre en place en Amérique du Nord pour protéger nos propres citoyens. Je ne crois pas que cela soit le cas, et j’imagine que vous serez d’accord avec moi. Les points que je soulignerai ici sont très simples.
Tout d’abord, pour ce qui est de l’Amérique du Nord, nous devons protéger nos frontières. Je tiens à vous assurer que le Canada fera plus que sa part dans ce domaine.
Ensuite, la meilleure protection pour notre territoire est un monde qui fonctionne bien. À cet égard, nos deux pays n’ont pas la même capacité ni, par conséquent, la même responsabilité. Certes, nous ne sommes pas une superpuissance. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué, cela peut aussi être un avantage. Envisagées dans leur ensemble plutôt qu’isolément, les décisions que nous prenons collectivement détermineront si tous les progrès réalisés ces dernières décennies profiteront à tout le monde ou si des centaines de millions, voire des milliards de personnes, seront laissées pour compte à jamais.
Nous devons démontrer aux peuples partout dans le monde que les mécanismes internationaux peuvent fonctionner pour tous. Nous devons intéresser chaque personne à la saine gouvernance, tant à l’échelon national que sur le plan international.
Notre devoir est de protéger nos citoyens. Jour après jour, il est de plus en plus clair que notre sécurité à long terme passe par la propagation de la liberté partout dans le monde, que ce soit à l’égard de l’oppression, de la corruption, de la faim ou de l’ignorance et du désespoir – la liberté de jouir d’une vie sûre, prospère et productive pour tous.
Nous ne pouvons fermer les yeux devant les menaces très réelles que représentent pour notre sécurité les terroristes et les tyrans qui sont motivés non par la pauvreté, mais par la haine. Toutefois, nous ne pouvons pas non plus négliger le fait que la sécurité à long terme passe par l’édification d’un monde plus équitable et plus sûr pour tous les habitants de notre planète.
Je vous remercie.
|